Mme H., apatride d’origine palestinienne née le 25 juin 1978, résidait à Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza. À la suite de l’attaque du Hamas contre des civils israéliens, le 7 octobre 2023, peu après le déclenchement des représailles par Israël sur Gaza, sa maison fut partiellement détruite lors d’un bombardement de l’armée israélienne et son fils H., né le 26 août 2013, blessé aux jambes, fut soigné à Gaza puis en Egypte.
Pris en charge par l’ambassade de France au Caire, Mme H et son fils mineur avaient pu entrer en France grâce à deux laissez-passer consulaires délivrés au Caire par les autorités françaises le 18 janvier 2024.
 Par une décision du 9 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Mme H et son fils s’étaient vu accorder une protection subsidiaire [3] prévue par le droit européen compte tenu de la situation de violence aveugle et d’une intensité exceptionnelle résultant du conflit armé entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes conformément à une jurisprudence de la Cour Nationale du Droit d’Asile du 13 septembre 2024, N° 23042517 et 23042541 (sur laquelle nous reviendrons).
Par une décision du 9 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Mme H et son fils s’étaient vu accorder une protection subsidiaire [3] prévue par le droit européen compte tenu de la situation de violence aveugle et d’une intensité exceptionnelle résultant du conflit armé entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes conformément à une jurisprudence de la Cour Nationale du Droit d’Asile du 13 septembre 2024, N° 23042517 et 23042541 (sur laquelle nous reviendrons).
Mme H. forma alors un recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) contre cette décision de l’OFPRA le 6 août 2024 avec dépôt de mémoires – enregistrés les 6 et 22 août 2024, les 30 octobre et 3 novembre 2024 et le 3 février 2025 – aux fins d’obtenir l’annulation de cette décision qui leur avait seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, alors qu’elle avait demandé la reconnaissance de la qualité de « réfugiés » pour elle et son fils [4].
Mme H soutenait que, contrairement à d’autres ressortissants palestiniens, elle-même et son fils n’étaient pas juridiquement protégés par l’agence de l’ONU pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) et que, dans le cadre du conflit armé en cours dans la bande de Gaza, elle craignait d’être persécutée avec son fils, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors que les motifs pour lesquels l’armée israélienne avait recours à des techniques de guerre indiscriminées contre les populations civiles reposaient sur leur nationalité palestinienne, leur appartenance au groupe social des personnes palestiniennes et les opinions politiques qui leur étaient imputées.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, l’OFPRA demanda à la Cour d’étudier l’applicabilité de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève à l’égard de Mme H. et de son fils mais de rejeter les conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens.
L’OFPRA convenait également que :
– la situation de la requérante n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 1er, D de la convention de Genève [5] ;
– au regard du caractère grave et systématique des atteintes qui étaient portées à la population civile de la bande de Gaza, il semblait à craindre que les Palestiniens de Gaza se voient imputer des opinions politiques favorables au Hamas en raison de leur nationalité et de leur provenance et qu’ils pouvaient redouter des persécutions à ce titre en cas de retour dans leur pays d’origine.
Trois associations humanitaires – l’association ELENA France, la Cimade et le GISTI – ainsi que la Ligue des droits de l’Homme intervinrent et déposèrent des mémoires demandant tous à la CNDA de faire droit aux conclusions de Mme H. Leurs interventions furent jugées recevables eu égard à l’objet et à la nature du litige, ainsi qu’à l’existence d’un intérêt suffisant pour intervenir dans l’instance.
La Cour devait rechercher dans quelles conditions peut être attribué le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 afin de trancher le point de savoir s’il pouvait ensuite en être fait ou non application à la demande de la requérante.
À ces textes internationaux, la Cour ajouta l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, ou accéder à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes susceptibles de bénéficier de la protection subsidiaire. [6]
Il est à souligner que cet article venait lui-même après l’écriture de l’article 3 de cette même directive européenne qui, faisant explicitement référence à la Convention de Genève, affirmait le principe de non-refoulement et disposait clairement :
« Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 (ci-après dénommée «convention de Genève») relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommé «protocole»), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement.» (Journal officiel de l’Union européenne, 20.12.2011, L 337/9).
I/ Le statut de réfugié selon les textes internationaux précités
Ainsi la Convention de Genève précitée de 1951 précise, dans son article 1er, § A, 2, qui peut être considéré comme un « réfugié » mais aussi énumère, au § D de ce même article 1er, les personnes ne pouvant se prévaloir du bénéfice de cette même convention.
A/ la définition positive du réfugié selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
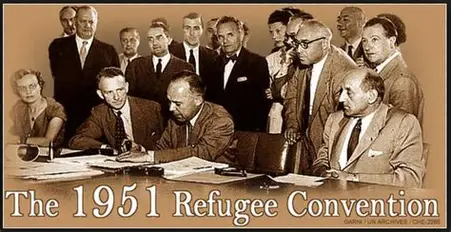 Selon l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle (…), ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. / (…) ».
Selon l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle (…), ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. / (…) ».
B/ L’exclusion du bénéfice de la Convention
Aux termes de l’article 1er, D de la même convention :
« Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. / Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ».
II/ Le constat de la CNDA
La Cour examina la requête de Mme H. formulée pour elle-même et son fils mineur, en tenant compte de la situation actuelle dans la bande de Gaza à la suite de la fin du cessez-le-feu en mars 2025.
A/ La méthode de la Cour
Elle s’appuya sur les sources documentaires publiques disponibles, en particulier les rapports d’organismes des Nations Unies : Comité spécial des Nations unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés, Secrétaire général des Nations unies, Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) et UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East = Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient).
Elle intégra également à son enquête la résolution de l’assemblée générale des Nations Unies du 12 juin 2025 exigeant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza [7], après l’échec du Conseil de sécurité à adopter le 4 juin une résolution sur la même question.
B/ Les données factuelles : des actes de persécution
 La Cour relève les faits suivants :
La Cour relève les faits suivants :
– les forces israéliennes contrôlent une partie substantielle du territoire de la bande de Gaza.
– les méthodes de guerre employées par les forces israéliennes dans la bande de Gaza, comme l’a d’ailleurs relevé l’OFPRA lui-même dans ses appréciations, conduisent : à un nombre important de victimes et de blessés civils dont une majorité de femmes et d’enfants ; à une destruction à grande échelle d’infrastructures essentielles à la population civile, comme des points d’approvisionnement et de distribution d’eau et d’électricité, d’hôpitaux ou des écoles ; à des déplacements forcés de population ; à la création d’un niveau de crise d’insécurité alimentaire pour l’ensemble de la population gazaouie du fait des entraves et blocages à l’acheminement de l’aide humanitaire.
– la qualification de ces méthodes de guerre affectant directement et indistinctement l’ensemble de la population civile de Gaza : depuis la rupture de l’accord de cessez-le-feu du 19 janvier 2025, elles sont suffisamment graves du fait de leur nature et de leur caractère répété pour pouvoir être regardés, en application de la directive européenne du 13 décembre 2011 sur le droit d’asile, comme des actes de persécution.
III/ La décision de la Cour
A/ La qualification des palestiniens de Gaza
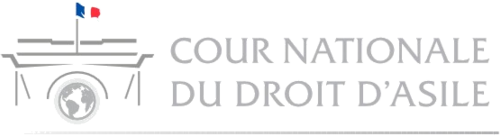 S’agissant de la qualité de « réfugié », la Cour souligne que ces persécutions sont liées à un motif de la convention de Genève. En effet, la Cour juge que les apatrides palestiniens de Gaza possèdent les caractéristiques liées à une « nationalité » qui, au sens et pour l’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, recouvre « l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre État ».
S’agissant de la qualité de « réfugié », la Cour souligne que ces persécutions sont liées à un motif de la convention de Genève. En effet, la Cour juge que les apatrides palestiniens de Gaza possèdent les caractéristiques liées à une « nationalité » qui, au sens et pour l’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, recouvre « l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre État ».
B/ L’octroi de la qualité de réfugié
Considérant qu’en cas de retour dans le territoire de Gaza cette mère et son fils mineur craignent, avec raison, d’être personnellement persécutés, du fait de cette « nationalité », par les forces armées israéliennes qui contrôlent une partie substantielle de ce territoire, la Cour annula la décision du directeur général de l’OFPRA du 9 juillet 2024 et reconnut la qualité de réfugiés à Mme H. et à l’enfant H.
IV/ Portée de la décision de la Cour
La portée de cette décision est large et importante. La CNDA analyse de manière aussi réaliste que lucide et saine la situation à Gaza au regard du droit international et du droit interne français. Par rapport aux conditions d’attribution du droit d’asile, cette décision ne manque pas de pertinence juridique et surtout de justice au regard du respect des droits de l’Homme, et notamment de l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui garantit à toute personne, en cas de persécution, le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile dans d’autres pays.
A/ La confirmation d’un régime de protection des réfugiés palestiniens propre à la France dans le cadre de la Convention de Genève dont la France et de nombreux Etats européens sont signataires
1/ Le caractère historiquement limité de la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
 Aussi saine et utile qu’elle ait été et le demeure encore, l’existence de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) – créé par la résolution n° 302 (IV) de l’assemblée générale des Nations unies en date du 8 décembre 1949 afin d’apporter un secours direct aux « réfugiés de Palestine » – pouvait faire douter de la mise en œuvre directe de l’attribution du droit d’asile au profit de ceux-ci par les Etats signataires de la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés définissant les conditions dans lesquelles le statut de réfugié pouvait être appliqué aux personnes en faisant la demande.
Aussi saine et utile qu’elle ait été et le demeure encore, l’existence de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) – créé par la résolution n° 302 (IV) de l’assemblée générale des Nations unies en date du 8 décembre 1949 afin d’apporter un secours direct aux « réfugiés de Palestine » – pouvait faire douter de la mise en œuvre directe de l’attribution du droit d’asile au profit de ceux-ci par les Etats signataires de la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés définissant les conditions dans lesquelles le statut de réfugié pouvait être appliqué aux personnes en faisant la demande.
Si le mandat de l’UNRWA a été prolongé successivement jusqu’en 2023 puis jusqu’au 30 juin 2026 « au regard du bien-être, de la protection et du développement humain des réfugiés de Palestine » afin de « subvenir à leurs besoins essentiels en matière de santé, d’éducation et de subsistance », la CNDA relève qu’il résulte des instructions d’éligibilité et d’enregistrement consolidées adoptées par cet organisme en 2009 que ces prestations sont délivrées, d’une part, aux personnes, enregistrées auprès de lui, qui résidaient habituellement en Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance en raison du conflit de 1948, ainsi qu’à leurs descendants et, d’autre part, aux autres personnes éligibles mentionnées au point B. du III de ces instructions qui en font la demande sans faire l’objet d’un enregistrement par l’UNRWA.
2/ La jurisprudence de la CNDA du 13 septembre 2024
La CNDA, dans une affaire jugée le 13 septembre 2024, N° 23042517 et 23042541, s’était déjà prononcée sur la compatibilité de la qualité de « réfugié », reconnu dans le cadre de l’URWA, avec celle résultant de l’application de la Convention de Genève de 1951.
En septembre 2024, un couple de ressortissants palestiniens habitants de la bande de Gaza (Monsieur et Madame S.) s’était vu reconnaître le statut de réfugiés en France par la Cour nationale du droit d’asile. Cette décision de la Cour ouvrit la voie à la reconnaissance de la protection internationale aux Gazaouis arrivés en France qui dépendaient de la protection de l’UNRWA, cette agence étant considérée comme n’ayant plus la capacité de les protéger de manière effective en Palestine et notamment sur le territoire de Gaza.
Selon le droit français résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aux termes de l’article L. 511-6, « Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / (…) ».
Il résulte en effet des stipulations du D de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu’en raison du statut spécifique dont ils jouissent, la convention de Genève du 28 juillet 1951 n’est pas applicable aux réfugiés palestiniens, au moins tant qu’ils bénéficient effectivement de l’assistance ou de la protection de l’UNRWA.
Mais la Cour considéra que les requérants (M. et Mme S.) – qui étaient effectivement d’origine palestinienne – n’avaient pas de nationalité au sens de la convention de Genève. Cette appréciation fut confirmée par la production des originaux des cartes d’identité et des passeports délivrés par l’Autorité palestinienne. De plus, M. et Mme S. résidaient respectivement depuis 2000 et 1997 dans la bande de Gaza, territoire compris dans la zone d’opération de l’UNRWA. Ils produisirent utilement la copie d’un certificat de l’UNRWA, en date du 9 mars 2023, leur carte familiale d’enregistrement en date du 17 avril 2023 ainsi que des attestations du 14 mai 2023 et du 23 juillet 2023, confirmant ainsi leur enregistrement auprès de cet office. Devant la Cour, les requérants précisèrent avoir reçu de l’aide sur les plans alimentaire et médical, y compris peu de temps avant leur départ de Gaza. A priori les requérants entraient donc dans le champ d’application personnel du D de l’article 1er de la convention de Genève.
Mais, comme l’avait déjà relevé elle-même la Cour de justice de l’Union européenne au point 82 de son arrêt du 13 juin 2024, C-563/22, tant les conditions de vie dans la bande de Gaza que la capacité de l’UNRWA à remplir sa mission avaient connu une dégradation sans précédent en raison des conséquences des évènements du 7 octobre 2023 [8].
Or l’UNRWA dans son 127ème rapport relatif à sa propre situation dans la bande de Gaza, daté du 9 août 2024, faisait état de la mort de 205 de ses agents, ce qui constituait le plus grand nombre de morts de travailleurs humanitaires de l’histoire de l’ONU tandis que près de 190 installations de l’UNRWA avaient été endommagées.
La Cour releva que dans un communiqué du 24 avril 2024, l’UNRWA formula une demande de 1,21 milliard de dollars pour faire face à l’ampleur de la crise humanitaire à Gaza, ce qui montrait que cette organisation humanitaire ne pouvait plus assurer, en septembre 2024, à aucun apatride d’origine palestinienne séjournant dans le secteur de sa zone d’opération où il avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. Son assistance ou sa protection devait donc être regardée comme ayant cessé à l’égard de ces apatrides d’origine palestinienne dans la bande de Gaza.
Par suite, la CNDA estima que M. et Mme S. – dont il ne résultait pas de l’instruction et n’était même pas allégué qu’ils relèveraient d’une autre clause d’exclusion – entraient bien dans le champ d’application du 2ème alinéa du D de l’article 1er de la convention de Genève qui dispose :
« Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention. »
Par suite, la Cour en avait conclu que la qualité de réfugiés devait être reconnue à M. S et à Mme S.
3/ La nature de l’UNRWA et l’absence de liens entre cet organisme et la requérante
Si, relève la Cour, dans son arrêt du 11 juillet 2025 concernant Mme H. et son fils mineur, « l’UNRWA doit être regardé comme un organisme des Nations unies, autre que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les Réfugiés, offrant une assistance à ces personnes », il est constant que la requérante et son fils mineur ne sont ni enregistrés auprès de l’UNRWA ni éligibles en application du point B. du III des instructions d’éligibilité et d’enregistrement consolidées adoptées par cet organisme en 2009. Ils n’entrent donc pas dans le champ des stipulations édictées au § D (1er alinéa) de l’article 1er de la convention de Genève [9].
B/ La genèse d’un conflit qui dure entre le Hamas et Israël ayant fait de nombreuses victimes palestiniennes sans protection de l’ONU et d’une violence exceptionnelle au mépris des droits de l’Homme en raison des méthodes de guerre utilisées par Israël
L’Unrwa, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens,
affirme que 800.000 personnes ont fui Rafah où Israël
dit mener des « opérations » pour éliminer le Hamas.
 Comme elle l’avait fait dans sa décision précitée du 13 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le statut de réfugié aux ressortissants palestiniens originaires de la bande de Gaza, non protégés par l’ONU, en raison des méthodes de guerre utilisées par les forces israéliennes.
Comme elle l’avait fait dans sa décision précitée du 13 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le statut de réfugié aux ressortissants palestiniens originaires de la bande de Gaza, non protégés par l’ONU, en raison des méthodes de guerre utilisées par les forces israéliennes.
Comme en 2024, cette décision a été prise en raison de la violence aveugle et d’une intensité exceptionnelle résultant du conflit armé entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes.
La Cour a examiné la situation actuelle dans la bande de Gaza et s’est appuyé sur les rapports d’organismes des Nations-Unies et sur les ordonnances de la Cour internationale de justice des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024 dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël, relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza [10].
Retraçant la genèse du conflit, la Cour nationale du droit d’asile met en avant les points suivants :
- Le 7 octobre 2023, l’attaque contre le territoire d’Israël, par la branche armée du Hamas depuis la Bande de Gaza entraîne la mort de plus de 1 200 Israéliens et la prise d’otages d’au moins 252 personnes ;
- En représailles, le même jour, Israël, avec son armée Tsahal, lance l’opération dite « Glaives de fer », en mobilisant, ses forces aériennes, terrestres et maritimes et assiège le territoire de la bande de Gaza. Le conflit sanglant va se poursuivre longuement par l’offensive terrestre de l’armée israélienne avec des frappes de grande ampleur dans la bande de Gaza, à l’exception de la période de trêve conclue entre le 22 novembre et le 1er décembre 2023, et de l’accord de cessez-le-feu mis en œuvre le 19 janvier 2025, mais rompu unilatéralement par les forces de défense israéliennes dans la nuit du 17 au 18 mars 2025. La Cour souligne que l’opération militaire conduite par Israël a fait de très nombreux morts et blessés et causé la destruction massive d’habitations, le déplacement forcé de l’écrasante majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures civiles;
- C’est dans ce contexte que la Cour internationale de justice a, par trois ordonnances rendues les 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024 dans l’affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), enjoint aux autorités israéliennes de prendre les mesures conservatoires en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en particulier du meurtre, de l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe, de la soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle des membres du groupe et des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice, a considéré, au point 45, que « les Palestiniens semblent constituer un « groupe national, ethnique, racial ou religieux » distinct, et, partant, un groupe protégé au sens de l’article II de la convention sur le génocide » ;
- Après la rupture de l’accord de cessez-le-feu – mis en œuvre le 19 janvier 2025 -, la Cour relève que les forces israéliennes ont mis en œuvre l’opération « les Chariots de Gédéon », se traduisant par l’intensification des bombardements, l’élargissement de la zone tampon et le renforcement de la présence israélienne dans la bande de Gaza. Dans son rapport de situation du 18 juin 2025, l’OCHA [11] constate que 82,4% de la bande de Gaza se trouve soit sous contrôle militaire israélien, soit sous ordre d’évacuation, soit les deux. Le Comité spécial des Nations unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés a relevé que l’armée israélienne a assoupli les critères de détermination des cibles tout en augmentant le ratio entre victimes civiles et victimes combattantes, permettant aux militaires israéliens d’utiliser des systèmes d’intelligence artificielle pour identifier rapidement des dizaines de milliers de cibles humaines, accélérant ainsi la prise de décision et entraînant une augmentation significative du ratio entre personnes ciblées et nombre de victimes civiles. Ce même rapport de situation de l’OCHA [12] du 18 juin 2025 rapporte qu’au 22 mars 2025, 55 647 morts, dont 8 304 femmes et 15 613 enfants, et 129 880 blessés ont été comptabilisés dans la bande de Gaza. Ce rapport pointe également la destruction à grande échelle d’infrastructures essentielles à la population civile, précisant que 89 % des installations d’eau et d’assainissement ont été détruites ou partiellement endommagées. De même, une vingtaine d’hôpitaux, parmi les 36 que compte le territoire, ne sont plus opérationnels tandis que les autres ne sont que partiellement opérationnels. 38 % des centres de soins de santé primaires fonctionnent dont seulement 5 totalement et 57 en partie. Le rapport de la commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien du 6 mai 2025 relève que les attaques israéliennes ont endommagé 70 % des bâtiments scolaires de Gaza, menant, de fait, à la destruction du système éducatif gazaoui. 62 % des bâtiments scolaires utilisés comme refuges ont été directement touchés, ce qui s’est traduit par de nombreuses victimes. Sur ce point, la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé a relevé qu’elle n’avait pu trouver le moindre objectif militaire derrière la démolition des établissements scolaires.
CONCLUSIONS
Comme nous l’avons rappelé, en septembre 2024, la CNDA avait déjà reconnu que les Palestiniens protégés par l’UNRWA pouvaient obtenir le statut de réfugié en France, dès lors que leur protection par cet organisme de l’ONU ne pouvait plus être assurée de manière effective dans la bande de Gaza livrée à une destruction massive.
Avec sa décision du 11 juillet 2025, la Cour va plus loin en étendant plus largement la reconnaissance du statut de réfugié aux Palestiniens de Gaza non pris en charge par l’UNRWA.
Elle juge que ces personnes peuvent être persécutées du fait de leur « nationalité », au sens de la convention de Genève, par les méthodes de guerre utilisées par les forces israéliennes ; les déplacements forcés de populations et l’obstruction à l’aide humanitaire ; le niveau extrême d’insécurité alimentaire dans l’ensemble de la bande de Gaza.
Cette jurisprudence présente l’incontestable mérite de donner une réalité au respect des droits de l’Homme en ouvrant la voie à une reconnaissance plus large du statut de réfugié pour les Palestiniens de Gaza non couverts par l’UNRWA. Elle clarifie également les conditions d’application de la Convention de Genève dans un contexte de conflit armé inégalitaire et durable.
Louis SAISI
Paris, le 3 septembre 2025
NOTES
[1] Voir cette décision : CNDA, N° 24035619, 11 juillet 2025. CNDA, 11 juillet 2025, Mme H., n° 24035619, R (5).pdf
[2] Source : Cour nationale du droit d’asile : Décision de justice 11 juillet 2025 : « La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait déjà jugé, par une décision du 13 septembre 2024, que les ressortissants palestiniens originaires de la bande de Gaza protégés par l’ONU pouvaient demander le statut de réfugié en France compte tenu du fait que leur protection sur place ne pouvait plus être assurée ».
[3] La protection subsidiaire est attribuée à l’étranger qui ne remplit pas les conditions d’obtention du statut de réfugié mais qui prouve qu’il est exposé dans son pays à l’un des risques suivants :
- Peine de mort ou exécution
- Torture ou peines ou traitements inhumains ou dégradants
- Menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
[4] Le titre de séjour délivré dans le cadre de la protection subsidiaire est d’une durée maximale de 4 ans (éventuellement renouvelable sous certaines conditions), alors que la durée du statut de réfugié est accordée pour 10 ans, éventuellement renouvelable.
[5] § D : « Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention. »
[6] Cet article 9 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 dispose : « Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme, conformément à l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, d’ici à 2012 au plus tard. » (Journal officiel de l’Union européenne, 20.12.2011, L 337/9).
[7] Cette résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies fut adoptée après l’échec du Conseil de sécurité à adopter le 4 juin une résolution sur la même question. Adoptée par 149 voix pour, 12 contre et 19 abstentions, la résolution appelait à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, ainsi qu’à la libération de tous les otages. Le texte exhortait également à prendre « toutes les mesures nécessaires » pour faire pression sur l’État occupant, afin qu’il respecte le droit international et mette fin aux violations commises dans les territoires palestiniens.
Il était exigé de la puissance occupante qu’elle lève immédiatement le blocus, ouvre tous les points de passage et permette la distribution de l’aide humanitaire en quantité suffisante dans l’ensemble du territoire palestinien, où la situation humanitaire est jugée catastrophique après plus de 20 mois d’agression.
La résolution condamnait fermement l’utilisation de la famine comme méthode de guerre, ainsi que le refus illégal de l’accès humanitaire aux civils. Dans le but d’assurer le respect du droit international, le texte appelle tous les États membres à prendre, individuellement et collectivement, « toutes les mesures nécessaires » pour garantir que l’État occupant s’acquitte de ses obligations internationales.
À quelques jours de la tenue d’une conférence internationale sur la question palestinienne au siège des Nations Unies, la résolution réaffirme également l’attachement indéfectible de l’Assemblée générale à la solution à deux États.
[8] Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) : Arrêt de la Cour, SN et LN, representée par SN contre Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (vice-président de l’Agence nationale pour les réfugiés, Bulgarie), 13/06/2024, C-563/22 (4ème chambre), source : Juricaf, La jurisprudence francophone des Cours suprêmes.
[9] Voir supra note 3.
[10] Louis SAISI : « La décision du 26 janvier 2024 de la Cour Internationale de Justice statuant sur la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël pour génocide à l’encontre de la population palestinienne de GAZA » , 5 septembre 2024, https://ideesaisies.deploie.com/la-decision-du-2…on-palestinienne.
[11] Il s’agit du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH ou OCHA – acronyme anglais pour Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) qui est un département du Secrétariat de l’ONU, institué le 19 décembre 1991 par la Résolution A/RES/46/182 de l’Assemblée générale des Nations unies. Celle-ci s’était déclarée « profondément préoccupée par les souffrances des victimes de catastrophes et de situations d’urgence, les pertes en vies humaines, les flux de réfugiés, les déplacements massifs de populations et les destructions matérielles ». La résolution, intitulée « Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies », sert de cadre à l’aide humanitaire et en fixe les principes directeurs.
[12] Cf. supra, Note 11.

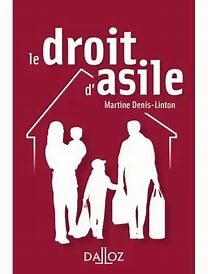


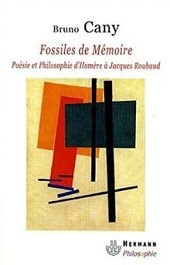
Commentaire sur “LA DÉCISION DU 11 JUILLET 2025 [1] DE LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE ACCORDANT LE STATUT DE « RÉFUGIÉ » À UNE PALESTINIENNE GAZAOUIE [2] ET À SON FILS MINEUR par Louis SAISI”