Ce que révèle le « discours de la méthode » de « Renaissance » (majorité présidentielle) sur sa manière de gouverner : une inquiétante conception restrictive de la souveraineté du peuple
par Louis SAISI

« Quand on veut accomplir un acte grave,
marqué au coin de la force et de l’autorité,
il faut savoir garder une attitude digne,
tenir un langage correct, constitutionnel et légal »
(Léon GAMBETTA, discours du 16 mai 1877
lors de la réunion des gauches) [1]
Ci-dessus, Léon GAMBETTA
(1838-1882)
Ci-dessous Logotype officiel
de « RENAISSANCE »
 Suite aux dernières élections législatives – qui firent apparaître une majorité présidentielle très vulnérable faute d’atteindre la majorité absolue des députés de l’hémicycle -, on attendait de la part de l’Exécutif et du parti majoritaire une attitude plus respectueuse et modeste vis-à-vis des autres composantes politiques de l’Assemblée nationale, et notamment un autre « discours de la méthode » sur la manière de gouverner du Président et de son indéfectible parti de soutien aujourd’hui hâtivement mais douloureusement rebaptisé « Renaissance ». Après tout, ce sont les Français qui se sont exprimés lors de ces Législatives et qui tirant les enseignements de l’expérience de la présidence macronienne de 2017-2022 et de la législature qui l’accompagna, ont manifesté leur volonté de ne pas reconduire un bloc présidentiel largement majoritaire à l’Assemblée nationale à l’identique de celui de 2017 qui, insensible aux problèmes quotidiens des citadins à la périphérie des centres urbains, mit les « Gilets jaunes » sur les ronds-points et dans la rue pendant un an … Situation jusqu’alors inédite mais qui devait un jour inévitablement arriver, compte tenu de la pratique autoritaire du pouvoir née des institutions de la 5ème République, cette Dame sexagénaire guindée et stable mais incurablement fermée aux aspirations populaires, comme au temps de sa jeunesse folle qui généra mai 68…
Suite aux dernières élections législatives – qui firent apparaître une majorité présidentielle très vulnérable faute d’atteindre la majorité absolue des députés de l’hémicycle -, on attendait de la part de l’Exécutif et du parti majoritaire une attitude plus respectueuse et modeste vis-à-vis des autres composantes politiques de l’Assemblée nationale, et notamment un autre « discours de la méthode » sur la manière de gouverner du Président et de son indéfectible parti de soutien aujourd’hui hâtivement mais douloureusement rebaptisé « Renaissance ». Après tout, ce sont les Français qui se sont exprimés lors de ces Législatives et qui tirant les enseignements de l’expérience de la présidence macronienne de 2017-2022 et de la législature qui l’accompagna, ont manifesté leur volonté de ne pas reconduire un bloc présidentiel largement majoritaire à l’Assemblée nationale à l’identique de celui de 2017 qui, insensible aux problèmes quotidiens des citadins à la périphérie des centres urbains, mit les « Gilets jaunes » sur les ronds-points et dans la rue pendant un an … Situation jusqu’alors inédite mais qui devait un jour inévitablement arriver, compte tenu de la pratique autoritaire du pouvoir née des institutions de la 5ème République, cette Dame sexagénaire guindée et stable mais incurablement fermée aux aspirations populaires, comme au temps de sa jeunesse folle qui généra mai 68…
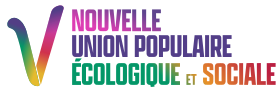 Au lieu d’une telle modestie, implicitement attendue par le corps électoral, ce fut, à l’inverse, depuis les dernières élections législatives de juin 2022, un débordement d’arrogance de la part de l’Exécutif et de la majorité présidentielle principalement dirigée contre l’alliance des partis de gauche, au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES). Il est de plus en plus clair qu’une telle alliance des gauches dérange la droite présidentielle dite « Renaissance » ainsi que l’autre partie de la droite parlementaire LR [2] qui, faute d’avoir apporté son soutien au parti présidentiel, abonde néanmoins avec celui-ci dans le même sens critique négatif à l’égard de LFI en particulier et de la NUPES en général. L’on peut penser que cela n’a rien d’étonnant ni même d’anormal mais relève du jeu politique habituel dès lors que l’alliance des gauches au sein de la NUPES recèle un danger politique pour les forces de droite car elle est riche d’une potentialité d’accéder au pouvoir pour y développer une autre politique alternative à celle macroniste, c’est-à-dire libérale et conservatrice, que nous connaissons depuis 2017 et qui, depuis les dernières élections quinquennales de 2022, manifeste à nouveau des velléités antisociales à travers la réforme annoncée des retraites.
Au lieu d’une telle modestie, implicitement attendue par le corps électoral, ce fut, à l’inverse, depuis les dernières élections législatives de juin 2022, un débordement d’arrogance de la part de l’Exécutif et de la majorité présidentielle principalement dirigée contre l’alliance des partis de gauche, au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES). Il est de plus en plus clair qu’une telle alliance des gauches dérange la droite présidentielle dite « Renaissance » ainsi que l’autre partie de la droite parlementaire LR [2] qui, faute d’avoir apporté son soutien au parti présidentiel, abonde néanmoins avec celui-ci dans le même sens critique négatif à l’égard de LFI en particulier et de la NUPES en général. L’on peut penser que cela n’a rien d’étonnant ni même d’anormal mais relève du jeu politique habituel dès lors que l’alliance des gauches au sein de la NUPES recèle un danger politique pour les forces de droite car elle est riche d’une potentialité d’accéder au pouvoir pour y développer une autre politique alternative à celle macroniste, c’est-à-dire libérale et conservatrice, que nous connaissons depuis 2017 et qui, depuis les dernières élections quinquennales de 2022, manifeste à nouveau des velléités antisociales à travers la réforme annoncée des retraites.
L’on peut néanmoins, en prenant un peu de distance par rapport à cette situation politique nouvelle, se demander si une telle posture de la majorité actuelle est vraiment républicaine, au moins dans sa contestation de l’existence même d’une force politique rassemblant les diverses sensibilités politiques qui, depuis plusieurs décennies, expriment pourtant la diversité, à gauche, des courants et idées politiques qui traversent de notre pays.
Une telle arrogance hautaine du parti présidentiel peut-elle être considérée comme faisant partie du jeu politique habituel ?
I/ La posture largement partagée par toutes les forces de droite de dénigrement systématique et permanent de la NUPES et, en son sein, plus particulièrement de LFI, est-elle « républicaine » ?
 Le 6 octobre 2020, le Ministre de l’Intérieur, Gérald DARMANIN, accusait le parti de La France insoumise (LFI) d’être lié à un « islamo-gauchisme qui détruit la République ».
Le 6 octobre 2020, le Ministre de l’Intérieur, Gérald DARMANIN, accusait le parti de La France insoumise (LFI) d’être lié à un « islamo-gauchisme qui détruit la République ».
Un peu plus tard, sur « l’islamo-gauchisme » proprement dit, le 15 février 2021, la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique VIDAL déclarait sur CNEWS vouloir lancer une enquête sur « l’islamo-gauchisme » qui « gangrène », selon elle, l’Université. Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), à qui la ministre voulait confier une telle « enquête », lui répondit tout de suite que l’ »islamo-gauchisme » n’est pas une réalité scientifique.
La Conférence des Présidents d’Université (CPU) recadra également sèchement la ministre à travers le communiqué suivant : « L’islamo-gauchisme » n’est pas un concept. C’est une pseudo-notion dont on chercherait en vain un commencement de définition scientifique, et qu’il conviendrait de laisser, sinon aux animateurs de Cnews, plus largement, à l’extrême droite qui l’a popularisé. (…) La CPU appelle à élever le débat. Si le gouvernement a besoin d’analyses, de contradictions, de discours scientifiques étayés pour l’aider à sortir des représentations caricaturales et des arguties de café du commerce, les universités se tiennent à sa disposition. Le débat politique n’est par principe pas un débat scientifique : il ne doit pas pour autant conduire à raconter n’importe quoi. » On ne pouvait être plus clair.
Dans une République, le respect de l’adversaire politique est un devoir moral et une obligation politique sans le respect desquels le débat pacifique deviendrait vite impossible, c’est ce qui ressort de la recommandation de GAMBETTA mise en exergue du présent article.
Aujourd’hui, en soi, la posture combattive du parti « RENAISSANCE » – parti du Président issu de la fusion de la République en Marche, de Territoires de Progrès (aile gauche) et Agir (aile droite) – qui, par sa nouvelle appellation, veut faussement accréditer l’idée de la naissance d’un nouveau parti politique, alors qu’on a repris les mêmes hommes autour des mêmes idées (voir leur posture obstinée sur les retraites) pour recommencer à gouverner à droite – n’aurait rien d’étonnant et ne serait qu’une énième péripétie politique si elle n’était assortie d’un excès verbal consistant à vouloir disqualifier la NUPES et la politique alternative qu’elle envisage de mettre en œuvre en la qualifiant de « gauchiste », ce qui devient plus inquiétant quant au fonctionnement de notre démocratie qui doit reposer sur la coexistence de projets politiques alternatifs présentés aux libres suffrages de nos concitoyens.
À écouter les forces de droite – et quelques personnalités nostalgiques de l’ex PS d’hier (plus libéral que social) -, les gauches seraient ainsi subitement devenues politiquement déraisonnables en se rapprochant des positions de LFI.
Rappelons que les accords passés entre La France insoumise (LFI), Europe Ecologie-Les Verts (EELV), le Parti communiste (PCF) et enfin le Parti socialiste (PS) ont élaboré un programme économique renouvelé. Ce programme, en se démarquant du modèle économique libéral et productiviste actuel, inquiète certaines forces politiques et économiques, en particulier par sa volonté de s’affranchir des règles européennes, sans pour autant sortir de l’Union européenne, comme l’indiquent clairement les accords précités rappelant que la France « Pays fondateur de l’Union européenne, assumera ses responsabilités dans ce cadre. Le gouvernement que nous formerons pour cette législature ne pourra avoir pour politique la sortie de l’Union, ni sa désagrégation, ni la fin de la monnaie unique ».
Pour autant, la nécessité et la légitimité d’une autre approche de l’Europe ne font pas de doute dans le programme de la NUPES. La question est alors de savoir « comment » une majorité de gauche pourrait-elle entrer, si elle le voulait, dans les brèches ouvertes par l’Europe elle-même, par la négociation, et en acceptant les compromis qui en sortiront ?
Ci-dessous, les “3 %” font partie des critères
de convergence européens décidés en 1992
 En effet, déjà, sous la pression de la pandémie et des règles dérogatoires que l’Europe a dû consentir aux États membres pour éviter le naufrage de leur économie, la Commission européenne est plus ouverte aux aides d’Etat – jadis prohibées au nom du vieux principe de la concurrence libre et non faussée – ainsi qu’à la nécessité d’une politique industrielle. Par ailleurs, une réflexion a été amorcée en Europe sur les changements à apporter aux règles budgétaires, ainsi qu’à la place des investissements « verts » pour les sortir du calcul de la règle draconienne des 3 % issue du Traité de Maastricht.
En effet, déjà, sous la pression de la pandémie et des règles dérogatoires que l’Europe a dû consentir aux États membres pour éviter le naufrage de leur économie, la Commission européenne est plus ouverte aux aides d’Etat – jadis prohibées au nom du vieux principe de la concurrence libre et non faussée – ainsi qu’à la nécessité d’une politique industrielle. Par ailleurs, une réflexion a été amorcée en Europe sur les changements à apporter aux règles budgétaires, ainsi qu’à la place des investissements « verts » pour les sortir du calcul de la règle draconienne des 3 % issue du Traité de Maastricht.
Tout bien pesé, ce qui pose problème à la Droite (« Renaissance » et LR) c’est le fait que ce soit LFI et son leader charismatique Jean-Luc Mélenchon qui en aient été le ciment fédérateur, comme si le PS et les Verts s’étaient alliés avec le Diable, en l’occurrence un Diable « rouge »… Or si la discussion et la controverse peuvent légitimement porter sur le contenu de leur programme, il n’est pas besoin, si l’on adopte un point de vue contraire, de chercher à disqualifier un adversaire politique en essayant de faire naître la crainte et la peur de l’application de son projet en véhiculant une image négative de son auteur en la travestissant.
Une telle attitude de « RENAISSANCE » et des forces de droite est excessive et civiquement et moralement condamnable car, pour peu que l’on se donne au moins la peine de lire le programme du parti LFI de Mélenchon, il n’a rien de « gauchiste » ni de subversif. Il n’est pas plus « radical » ni subversif que ne l’était le programme des « radicaux » sous la Troisième République. Il s’agit seulement d’un programme résolument tourné à gauche, comme l’était celui des « radicaux » entre 1880 et 1905 (cf. infra), préconisant un changement social et politique faisant sens, également pour des millions de Français se revendiquant de « gauche », comme l’a montré la dernière élection présidentielle.
Outre l’Europe déjà évoquée, prenons deux exemples concrets très significatifs.
A/ La contestation de l’alliance militaire de l’OTAN fait-elle ou non partie du débat démocratique ?
Au sein de la NUPES, l’on connaît la position de contestation par LFI et Mélenchon de l’OTAN et surtout de l’adhésion de la France à ce pacte militaire guerrier. L’on peut, bien sûr, partager ou pas une telle posture qui d’ailleurs ne fait pas consensus au sein de le NUPES (notamment au PS) et qui serait donc arbitrée par le Parlement saisi par LFI du retrait immédiat de la France du commandement intégré de l’OTAN puis, par étapes, de l’organisation elle-même ». Il reste que, selon Jean-Luc MELENCHON, le but de la coalition de gauche sera de « réaffirmer que l’ONU est le seul organe légitime pour la sécurité collective à l’échelle mondiale ».
Mais, même si l’on ne la partage pas, la critique de l’alliance militaire de l’OTAN et la résolution de vouloir que la France s’en retire, cette dénonciation n’a rien d’une posture « gauchiste » ni « gauchisante » de la part de LFI, pas plus que, bien avant elle, ne le fut celle du général de GAULLE qui, le 21 février 1966, annonça le retrait de la France de l’Alliance militaire atlantique et le retour à sa souveraineté pleine et entière. Vouloir vivre dans un Etat souverain et indépendant maître de son destin sans être solidaire de conflits douteux et périlleux pour la paix dans le monde qui ne résulteraient pas de nos choix politiques souverains, quoi de plus sain, naturel et légitime pour un pays qui possède son indépendance militaire, et même nucléaire, dans le sens d’une riposte potentielle graduée du faible au fort… Ainsi, vouloir se retirer de l’OTAN, c’est « bien » si c’est de Gaulle qui l’affirme en 1966 puis le fait, mais c’est « mal » si c’est Mélenchon qui le propose en 2022, suite à notre contestable et triste retour dans cette Alliance décidée par les partis de droite animés par CHIRAC d’abord et SARKOZY ensuite [3] !
L’expression d’une pensée politique forte sur un sujet aussi sensible que celui de nos alliances, notamment militaires, qui touche à la liberté et à la souveraineté de notre peuple serait-elle interdite et serait-elle devenue exclusivement le monopole des partis de droite ?
B/ La contestation des institutions de la 5ème République est-elle un crime de lèse-majesté ?
De la même manière, vouloir donner la parole au peuple pour changer de République et entrer dans une « Sixième République », moins autoritaire et monarchique que notre cinquième République actuelle, de surcroît à bout de souffle, quoi de plus normal quand le chemin indiqué est tracé dans le cadre du respect du processus démocratique faisant appel à l’élection dune « Constituante » conformément à notre tradition démocratique depuis 1792.
1/ La question d’une refondation constitutionnelle républicaine n’est pas un tabou
Notre actuelle Constitution a déjà été révisée pas moins de 25 fois, ce qui montre sa fragilité et atteste qu’elle n’est donc plus la même que la constitution originelle de 1958.
Pour autant, ces révisions successives n’ont pas touché le cœur du problème mais n’ont fait que le déplacer et parfois même l’aggraver en mettant au centre des révisions une pratique du pouvoir contestable mais seulement pour mieux mettre les textes en accord avec une telle pratique, le meilleur exemple en étant, en 2000, la réforme du quinquennat.
Ci-dessous, Jacques CHIRAC,
Président de la République (1995-2002)
et son Premier Ministre d’alors,
Lionel JOSPIN (1997-2002),
tous deux à la manoeuvre
lors de l’adoption du quinquennat
en septembre 2000
 Le 24 septembre 2000, la réforme sur le quinquennat (Président de la République élu pour une durée de 5 ans au lieu de 7) – co-véhiculée par le Président CHIRAC et son Premier Ministre d’alors, Lionel JOSPIN – était approuvée par 73,21% des suffrages exprimés.
Le 24 septembre 2000, la réforme sur le quinquennat (Président de la République élu pour une durée de 5 ans au lieu de 7) – co-véhiculée par le Président CHIRAC et son Premier Ministre d’alors, Lionel JOSPIN – était approuvée par 73,21% des suffrages exprimés.
Mais la preuve que cette réforme du quinquennat n’allait pas au cœur du problème institutionnel c’est que les Français ne s’y trompèrent guère et n’y accordèrent que très peu d’attention car l’abstention, très forte, toucha 70% des inscrits, avec un très fort taux de votes blancs et nuls (16 %).
Ensuite, une loi organique décida que les élections législatives se feraient la même année que l’élection présidentielle, mais après celle-ci afin de donner une prime au Président nouvellement élu pour que dans la foulée de la dynamique de l’élection présidentielle le Parti le soutenant devienne largement majoritaire à l’Assemblée nationale en obtenant la majorité absolue des sièges de députés : la prééminence du Président de la République était ainsi réaffirmée et même confortée. Ce fut une grave erreur de la part du PS et des forces de gauche qui l’approuvèrent.
En fait, la véritable motivation du quinquennat pour les deux partis de gouvernement (alors le PS et le RPR) était d’éviter de nouvelles cohabitations – Président appartenant à un parti politique et majorité parlementaire (absolue) à l’Assemblée nationale appartenant à un autre parti politique fondamentalement opposé au parti du Président – qui avaient considérablement affaibli le pouvoir présidentiel en contraignant le Président à « cohabiter » avec un parti politique opposé à son programme.
Cela s’était produit en 1986 lors du premier septennat du Président MITTERRAND qui dût choisir en 1986 Jacques CHIRAC comme Premier Ministre en tant que leader de la majorité parlementaire ayant remporté les élections législatives. Cette cohabitation dura jusqu’en 1988, date à laquelle le président MITTERRAND, une fois réélu (jusqu’en 1995), procéda à une dissolution de l’Assemblée nationale, ce qui lui permit de reconquérir une majorité à sa dévotion jusqu’en 1993. Mais, en 1993, lors des élections législatives, la Droite obtint à nouveau la majorité absolue à l’Assemblée nationale, et ce fut une nouvelle cohabitation qui s’ouvrit de 1993 à 1995 (fin du mandat de MITTERRAND). En 1995, Jacques CHIRAC, élu Président, disposait d’une majorité à l’Assemblée nationale mais il voulut la conforter en 1997 en prononçant la dissolution anticipée de l’Assemblée nationale. Dissolution qui devait s’avérer infructueuse et funeste pour le Président en place car les socialistes et leurs alliés (PCF, PRG, EELV, MDC) remportèrent les élections et une troisième cohabitation, avec JOSPIN au poste de Premier Ministre, s’ensuivit. Elle fut la plus longue et dura 5 ans, jusqu’au terme du mandat du septennat de Jacques CHIRAC (2002).
Au moment où s’opère la réforme du quinquennat, en septembre 2000, la France connaît, depuis 3 ans déjà, une nouvelle période de cohabitation, et le Président CHIRAC se laisse convaincre sur l’intérêt d’une réforme constitutionnelle ramenant la durée du mandat du Président sur celui de l’Assemblée nationale (5 ans) afin que les deux élections s’effectuent la même année et de manière rapprochée.
Ci-dessous, image du spectre d’une cohabitation
Macron/Mélenchon très présent dans les
Législatives de juin 2022
 Cette préoccupation consistant à vouloir écarter le risque d’une cohabitation ne donne aucune garantie qu’elle n’ait pas lieu à nouveau. L’on a vu que lors des dernières élections présidentielles et législatives de 2022, le Président MACRON fraîchement élu n’a pu obtenir ensuite une majorité politique le soutenant suffisamment forte, et que Jean-Luc Mélenchon avait développé une campagne vigoureuse de « 3ème tour des présidentielles » en demandant à ses concitoyens de voter massivement pour la NUPES afin de « l’élire » ainsi indirectement Premier Ministre, en tant que leader reconnu de cette alliance, ce qui aurait pu exposer le Président à une nouvelle cohabitation avec la gauche. Certains dénonçaient à l’avance un tel scénario comme étant inconstitutionnel alors qu’il s’était déjà produit antérieurement, comme on l’a vu, à trois reprises et n’était pas politiquement impossible, suite à la désacralisation du Président MACRON à l’issue de son premier quinquennat peu glorieux, malgré ses habits jupitériens.
Cette préoccupation consistant à vouloir écarter le risque d’une cohabitation ne donne aucune garantie qu’elle n’ait pas lieu à nouveau. L’on a vu que lors des dernières élections présidentielles et législatives de 2022, le Président MACRON fraîchement élu n’a pu obtenir ensuite une majorité politique le soutenant suffisamment forte, et que Jean-Luc Mélenchon avait développé une campagne vigoureuse de « 3ème tour des présidentielles » en demandant à ses concitoyens de voter massivement pour la NUPES afin de « l’élire » ainsi indirectement Premier Ministre, en tant que leader reconnu de cette alliance, ce qui aurait pu exposer le Président à une nouvelle cohabitation avec la gauche. Certains dénonçaient à l’avance un tel scénario comme étant inconstitutionnel alors qu’il s’était déjà produit antérieurement, comme on l’a vu, à trois reprises et n’était pas politiquement impossible, suite à la désacralisation du Président MACRON à l’issue de son premier quinquennat peu glorieux, malgré ses habits jupitériens.
Tel ne fut certes pas le cas mais l’absence, pour le Président, d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale réduit l’étendue politique de ses pouvoirs et laisse planer une possible motion de censure qui, en cas de dissolution, rebattrait ensuite les cartes, sans écarter une éventuelle nouvelle cohabitation à l’issue d’un tel processus politique conflictuel.
Il est d’ailleurs symptomatique que le Président CHIRAC (1995-2002) ne consentit à mettre en chantier la réforme du quinquennat qu’à la condition qu’on ne touche pas aux pouvoirs du Président de la République, ce qui était le cœur même du problème.
Depuis 2000, la désertion chronique des urnes par nos concitoyens, suite à la crise de confiance en leurs représentants, n’a fait que se confirmer, au fil des consultations électorales, atteignant parfois jusqu’à 50% des électeurs qui préfèrent s’abstenir plutôt que d’aller voter car ayant le sentiment d’un vote inutile.
Aujourd’hui, à l’occasion de la campagne présidentielle, Emmanuel MACRON, en accord avec Marine LE PEN sur ce point constitutionnel, affirmait être favorable au retour au septennat. Selon le président candidat, ce serait un « bon rythme pour la présidentielle ». Il se montrait alors favorable à un mandat renouvelable quand sa concurrente d’extrême droite défendait l’idée d’un mandat unique, non renouvelable.
 Mais, comme il a été dit, le problème ne se situe pas exclusivement dans la durée du mandat du Président mais réside surtout dans le rôle qu’on lui assigne (arbitre véritable ou chef d’un parti majoritaire, alors qu’aujourd’hui il est l’un et l’autre) avec les larges pouvoirs que lui attribue la Constitution : nomination discrétionnaire du Premier Ministre et, dans la pratique, révocation de celui-ci en cas de désaccord avec lui, même s’il a la confiance de l’Assemblée nationale ; présidence du Conseil des ministres ; droit de demander une nouvelle délibération de la loi (abusivement lié à son pouvoir de promulgation des lois) ; droit de dissolution discrétionnaire de l’Assemblée nationale même sans confli enre celle-ci et le Gouvernement ; maîtrise du mécanisme référendaire de l’article 11 pour les projets de loi gouvernementaux (alinéa 1er) ; pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat (article 13) concurrent avec le pouvoir dévolu au Premier Ministre, en principe chef de l’administration du fait de l’exercice du pouvoir réglementaire qu’il tient de l’article 21 de la constitution ; article 16 donnant les pleins pouvoirs au Président, etc.
Mais, comme il a été dit, le problème ne se situe pas exclusivement dans la durée du mandat du Président mais réside surtout dans le rôle qu’on lui assigne (arbitre véritable ou chef d’un parti majoritaire, alors qu’aujourd’hui il est l’un et l’autre) avec les larges pouvoirs que lui attribue la Constitution : nomination discrétionnaire du Premier Ministre et, dans la pratique, révocation de celui-ci en cas de désaccord avec lui, même s’il a la confiance de l’Assemblée nationale ; présidence du Conseil des ministres ; droit de demander une nouvelle délibération de la loi (abusivement lié à son pouvoir de promulgation des lois) ; droit de dissolution discrétionnaire de l’Assemblée nationale même sans confli enre celle-ci et le Gouvernement ; maîtrise du mécanisme référendaire de l’article 11 pour les projets de loi gouvernementaux (alinéa 1er) ; pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat (article 13) concurrent avec le pouvoir dévolu au Premier Ministre, en principe chef de l’administration du fait de l’exercice du pouvoir réglementaire qu’il tient de l’article 21 de la constitution ; article 16 donnant les pleins pouvoirs au Président, etc.
Les pouvoirs attribués au Gouvernement par notre Constitution sont également considérables et dessaisissent, le plus souvent, le Parlement de sa mission originelle : ordonnances de l’article 38 substituant l’Exécutif au Parlement par le biais du vote, par ce dernier, d’une loi habilitant le premier à intervenir dans une matière législative [4] ; article 49-3 permettant l’adoption aveugle d’un texte par la pression du Gouvernement sur le Parlement avec la menace d’une crise politique.
Dans le contexte constitutionnel inchangé actuel, la modification seule de la durée du mandat présidentiel devient inopérante si le Président conserve ses pouvoirs politiques de chef d’un parti et d’une majorité parlementaire et de Président doté de pouvoirs constitutionnels exorbitants faisant de lui un chef politique suprême. Et si, également, celles des attributions les plus contestables – car impérialistes – du Gouvernement à l’encontre du Parlement (article 38, article 49-3 notamment) ne sont pas révisées dans un sens plus respectueux du pouvoir législatif de ce dernier.
Le retour au septennat ne règlerait rien car nous en avons fait déjà l’expérience – de 1958 à 2000 – à travers plusieurs pratiques de septennats assumés par pas moins de cinq présidents successifs (De GAULLE, POMPIDOU, GISCARD d’ESTAING, MITTERRAND, CHIRAC), sans que cela n’ait jamais apporté grand-chose à la pratique présidémentialiste du mode de fonctionnemment des institutions de la 5ème République.
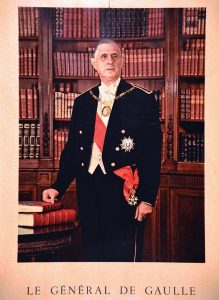
Il n’est donc pas insensé de poser le problème de la révision radicale de nos institutions pour refonder notre République. Dans la critique de nos institutions républicaines, le général de Gaulle n’avait-il pas, lui-même, jadis, donné le ton et l’exemple dans un sens plus que contestataire ?
L’on sait que de GAULLE n’avait jamais cessé, depuis la libération de la France, de prôner un changement de République au profit de la suprématie de l’Exécutif en ne se privant pas de fustiger constamment un système politique qu’il haïssait, notamment à partir de 1947, celui de la quatrième République. Pourtant, cette même république « démocratique et sociale » s’était dotée d’une constitution, celle du 27 octobre 1946, qui était elle-même précédée d’un long préambule réaffirmant les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », et proclamant en outre, comme étant particulièrement nécessaires à notre temps, un certain nombre de nouveaux nouveaux droits politiques, économiques et sociaux énumérés exhaustivement ensuite.
Pourquoi donc, dans l’ordre de nos Républiques, après être passé de la « quatrième à la « cinquième », il nous serait définitivement interdit de vouloir passer à une « sixième » conçue selon un autre schéma constitutionnel vraiment républicain, c’est-à-dire autrement que ne le fut le modèle autoritaire de 1958 baignant dans des limbes monarchiques, à l’instar de la constitution monarchique des 3/14 septembre 1791, mais en donnant au Président élu encore plus de pouvoirs que n’en avait alors le Roi de droit divin (puisque le Roi ne pouvait dissoudre l’Assemblée nationale) ?
Comme on le sait, en 1958, à la faveur de son retour, essentiellement provoqué par la crise algérienne, de GAULLE sut habilement présenter un autre schéma constitutionnel et le fit adopter par nos concitoyens. Mais, comme on le vit rapidement, de dérive en dérive, d’abord par une pratique du pouvoir personnel discutable [5], ensuite par la réforme inconstitutionnelle de 1962 et une série d’autres qui suivirent – dont certaines tout aussi malencontreuses que le coup d’Etat feutré de 1962 – et furent mises en chantier par les successeurs de de Gaulle (notamment l’adoption du quinquennat sous CHIRAC avec la complicité de JOSPIN, alors Premier Ministre, le quinquennat officialisant la dérive du système dans le sens de la suprématie du pouvoir présidentiel). Sous une pseudo « cinquième République », ces pratiques autoritaires du pouvoir et ces réformes successives substituèrent progressivement à une certaine conception classique de la République – mettant à la première place la Loi, expression de la volonté générale et le Parlement qui l’élabore – l’image pourtant archaïque car dangereuse et démagogique de « l’homme providentiel » (dernier vestige de la Monarchie ou du césarisme bonapartiste) recevant l’onction du suffrage universel, succédané moderne du sacre monarchique en la cathédrale de Reims.
Pourquoi donc, suite à ces errements – qui durent maintenant depuis plus de soixante ans – une résurrection de la République ne serait-elle pas aujourd’hui possible et même franchement souhaitable ?
2/ Un culte d’un autre temps, celui de « l’homme providentiel » incompatible avec une République
Formellement la France est une « République indivisible, laïque, démocratique et sociale » (article 1er de notre Constitution), mais l’est-elle encore aujourd’hui ?
Ci-dessous, une séance du Sénat romain
 L’idée de République est ancienne. Chez les romains de l’Antiquité, la « res publica » signifiait la « chose publique », la chose de tous, ce qui donnait à tous les citoyens romains les mêmes droits politiques. Dans la République romaine (509-27 av. J.-C.), gouverner la cité était donc une affaire publique et collective.
L’idée de République est ancienne. Chez les romains de l’Antiquité, la « res publica » signifiait la « chose publique », la chose de tous, ce qui donnait à tous les citoyens romains les mêmes droits politiques. Dans la République romaine (509-27 av. J.-C.), gouverner la cité était donc une affaire publique et collective.
À Rome toute mesure importante dans la vie publique, comme dans la vie privée (pater familias qui avait son conseil de parents), devait être discutée en conseil. Les magistratures suprêmes comme celles des deux consuls, celles du préteur et du tribun de la plèbe avaient leur conseil qui était le Sénat qu’ils sollicitaient et convoquaient pour qu’il leur donne son avis sous la forme de « senatus consultum » (sénatus-consultes).
A priori la République romaine reposait, comme on le sait, sur l’équilibre de trois organes politiques qui se contrôlaient mutuellement : les magistrats, le Sénat et les comices, ou assemblées du peuple.
De nombreuses précautions avaient été prises par le législateur pour éviter l’instauration d’un pouvoir personnel. Ainsi les comices élisaient chaque année les magistrats, lesquels gouvernaient sous la tutelle des sénateurs, nommés à vie.
Les magistratures étaient collégiales (plusieurs magistrats partageaient les mêmes pouvoirs) et annuelles (ils étaient élus pour un an). En fait, du fait de l’annalité, de la collégialité des magistratures et de leur multiplicité, c’était le Sénat qui, profitant de leur faiblesse organique et temporelle, dirigeait, en tant qu’organe permanent, la politique romaine et incarnait la continuité de cette politique.

Cette primauté du Sénat sur tous les autres organes était exprimée par la formule Senatus populusque Romanus (SPQR) = « le Sénat et le peuple romain ». Elle symbolisait l’union du Sénat avec le peuple car en son second terme la formule faisait référence au peuple qui se réunissait en assemblées (comices).
En fait, comme au sein du Sénat, lui-même assemblée aristocratique, dans les assemblées populaires (comices), c’étaient les citoyens les plus riches qui, au sein des comices centuriates, détenaient le pouvoir et prenaient toutes les décisions : élections des magistrats, vote de la loi. Ainsi, à partir du premier tiers du 3ème siècle av. J. Ch., la noblesse patricio-plébéienne dominait les comices, constituait le Sénat et se partageait les magistratures. En fait, seuls les riches prenaient part au pouvoir [6] et la république romaine fut une aristocratie de l’argent (oligarchie).
C’est dire que la République romaine n’est sûrement pas un modèle satisfaisant, mais malgré ses imperfections elle nous livre un aspect intéressant du système républicain, à savoir qu’une République ne peut être que collégiale et ne doit pas encourager toute forme de pouvoir personnel s’exerçant hors de tout contrôle par un homme placé au-dessus de tous les autres, comme l’est actuellement notre Président de la République, plus proche d’un monarque élu pour une durée temporelle de cinq ans que d’un magistrat romain, avec des pouvoirs exorbitants dont l’exercice échappe à tout contrôle parlementaire comme populaire.
Émile LITTRÉ (1801-1881), dans son monumental Dictionnaire de la langue française – communément appelé aujourd’hui « Le Littré » – définissait la République comme « la chose publique, et, en général, toute espèce de gouvernement », mais ensuite, dans une seconde acception correspondant davantage à la tradition française (au moins jusqu’en 1958), il la définissait comme le « Gouvernement de plusieurs ; ou état gouverné par plusieurs. » [7]
Cette définition de LITTRÉ, surtout dans la seconde acception, correspond à la vision de la République exposée par GAMBETTA pour qui elle ne saurait être « l’apanage d’un seul homme », mais doit comporter une certaine fluidité des hommes dans l’exercice du pouvoir :
« Un homme ne peut incarner la République, non ! il peut la représenter comme fonctionnaire, il doit la défendre comme citoyen ; mais ce n’est que par les efforts de tous les bons citoyens que ce gouvernement peut vivre et prospérer. Et c’est précisément dans ce caractère collectif, unanime, général, du gouvernement républicain que se trouvent son excellence et sa supériorité.
—–
—–
« C’est là ce qui fait que le régime républicain offre des garanties sérieuses même contre l’incapacité, contre les hasards de la naissance, contre les infirmités, contre les passions, contre les vices d’un seul homme. Aussi faut-il bien se garder, parmi nous, de jamais faire du régime républicain l’apanage d’un seul homme ; il faut en faire au contraire un régime qui change de mains, qui est mobile et qui va, par l’élection, par le choix, tous les jours plus assuré, plus juste et plus moral, au plus digne. Quand celui-ci a fait son temps, on le remplace, la nation étant appelée à se donner ainsi pour premier magistrat, – et non pas pour maître, – le plus intelligent, le plus expérimenté, le plus digne.
C’est pourquoi la République est, par excellence, le régime de la dignité humaine, le régime du respect de la volonté nationale. C’est le régime qui peut, seul, supporter la liberté de tous ; qui, seul, peut faire les affaires d’un peuple qui a besoin de communiquer avec lui-même, de se réunir, de s’associer, d’exiger des comptes, de critiquer, d’examiner, en un mot de diriger ses propres intérêts et de changer ses intendants quand ils ont mal agi. » [8]
L’avènement, depuis 1958/1962, de cette monarchie élective abusivement étiquetée « république » – et sa décadence chronique à cause de sa surdité et son autisme qui engendrèrent le mouvement des « Gilets jaunes » – aurait-il définitivement clos le débat constitutionnel au prétexte que c’est l’Homme du 18 juin qui nous la délivra comme un Oracle ou un Sage antique et qu’elle engendra une certaine stabilité, laquelle n’a jamais fait partie de la définition de la démocratie mais est plutôt rattachée au principe héréditaire de la monarchie absolue d’Ancien Régime (« Le Roi est mort, vive le Roi » = « Un président en chasse un autre, vive le Président ! ») ?
En quoi serait-il condamnable de vouloir changer un tel régime – qui n’a que les apparences nominales et formelles d’une République – en une véritable République ?
Car c’est cette même monarchie élective qui, au fil d’une cascade de traités européens, nous fit prendre le chemin d’une construction européenne libérale à marche forcée, alors même que le rejet par le peuple français, lors du référendum du 29 mai 2005, du Traité constitutionnel européen (TCE), montra combien notre peuple n’avait pas renoncé à sa souveraineté originelle historiquement acquise lors de la Révolution française, et qui, d’ailleurs, à travers l’idée de « Nation » est toujours consacrée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Pourtant, peu après le rejet du TCE, le Président SARKOZY signa, le 13 décembre 2007, le traité de Lisbonne à peu près semblable au texte rejeté en 2005. Et pour éviter toute nouvelle sanction populaire contre ce nouveau texte, il le fit constitutionnellement valider par le Congrès réuni à Versailles.
En même temps qu’avec de Gaulle, la France se donnait de nouvelles institutions, avec celles-ci, depuis 1958, l’on a introduit dans notre république l’image pourtant historiquement funeste de « l’homme providentiel » qui était jusqu’alors rattachée, en France, à des périodes sombres, dictatoriales ou autoritaires, bien éloignées du modèle républicain.
De manière générale, l‘homme providentiel est celui qui est considéré par une Nation en quête de son identité ou d’une nouvelle identité comme en capacité de la sauver en la sortant d’une situation politique confuse ou d’une crise ouverte majeure lorsque le processus démocratique est fermé ou s’est grippé. Cette crise peut être institutionnelle, politique, économique, sociale ou morale ou les cinq à la fois…
En effet, dans l’imaginaire politique des Français « l’homme providentiel », selon Jean GARRIGUES, est « un personnage qui apparait dans les périodes de crises, et qui se présente comme le sauveur ultime chargé d’une sorte de mission historique ou divine » [9].
Ci-dessous, le jeune général BONAPARTE
 Selon cet historien [10], « … celui qui a véritablement posé son empreinte sur la généalogie des hommes providentiels, le référent suprême, est Napoléon Bonaparte, petit général corse issu de la Révolution française, et devenu en 1799 le recours politique du Directoire grâce au prestige de ses victoires militaires, à Toulon, en Italie puis en Égypte. Il est le sauveur par excellence, étranger à la caste politique traditionnelle, à la fois patriote et chef de guerre, et qui a su rétablir l’ordre dans une France disloquée et assiégée et restaurer la grandeur nationale puis conquérir l’Europe au nom des valeurs de la Révolution française » [11].
Selon cet historien [10], « … celui qui a véritablement posé son empreinte sur la généalogie des hommes providentiels, le référent suprême, est Napoléon Bonaparte, petit général corse issu de la Révolution française, et devenu en 1799 le recours politique du Directoire grâce au prestige de ses victoires militaires, à Toulon, en Italie puis en Égypte. Il est le sauveur par excellence, étranger à la caste politique traditionnelle, à la fois patriote et chef de guerre, et qui a su rétablir l’ordre dans une France disloquée et assiégée et restaurer la grandeur nationale puis conquérir l’Europe au nom des valeurs de la Révolution française » [11].
Encore faut-il préciser qu’avec la figure de Napoléon BONAPARTE l’homme providentiel est presque toujours associé au « césarisme » qui véhicule une certaine conception personnalisée et autoritaire du pouvoir.
Le « césarisme » dont s’inspira BONAPARTE consistait en un gouvernement de type monarchique qu’avait voulu imposer Jules CÉSAR à Rome. Avec lui, le pouvoir était concentré entre les mains d’un homme fort, charismatique, chef militaire auréolé de victoires (conquête des Gaules par César et campagnes d’Italie et d’Égypte par BONAPARTE) et s’appuyant également sur le peuple. Ce type de régime politique comporte une forte dimension démagogique, dans le sens où le chef tirerait officiellement sa légitimité directement du peuple et contre la représentation nationale (le Sénat de Rome ou les deux assemblées du Directoire en France).
Après BONAPARTE, nous fîmes plusieurs fois l’expérience malheureuse de l’homme providentiel, d’abord avec le prince Louis Napoléon BONAPARTE qui fut élu le 10 décembre 1848, président de la République au suffrage universel (masculin) après une violente mais courte campagne électorale. Il écrasa alors ses adversaires avec 70% des suffrages exprimés (5 587 759 voix) dès le premier tour de scrutin. Il avait bénéficié, à droite du soutien du parti de l’Ordre, et à gauche de la sympathie des ouvriers, ce qui lui valut de recueillir près des 3/4 des suffrages exprimés. LAMARTINE, l’un de ses adversaires qui avait été l’un des plus fougueux avocats de l’élection du Président de la République au suffrage universel en pariant sur la « maturité du pays », n’obtint qu’un peu plus de 20 000 voix. Le neveu de Napoléon 1er fut porté au pouvoir par le prestige de son nom, ses propres options socialisantes et le discrédit qui entourait l’Assemblée conservatrice de la IIe République. On sait ce qu’il advint ensuite de la seconde République emportée par le coup d’Etat perpétré le 2 décembre 1851 par le prince-président qui d’abord élabora la constitution autoritaire du 14 janvier 1852 puis la transforma au bout d’un an en un Second Empire.
Lors de la chute du second Empire, Adolphe THIERS fut aussi considéré, en son temps, longtemps comme « l’Homme providentiel », après la déchéance de Napoléon III et la proclamation de la République le 4 septembre 1870. On connaît la suite : traité de Versailles négocié par THIERS humiliant la France et la privant de l’Alsace et de la Lorraine avec de lourdes indemnités de guerre versées aux prussiens, puis répression par THIERS de la Commune de Paris au cours de la semaine sanglante…
Sous la troisième République, après la signature de l’armistice le 22 juin 1940 à Rethondes, lorsqu’il obtint le 1er juillet 1940 les pleins pouvoirs du Parlement (pouvoir constituant), le maréchal PÉTAIN – auréolé de son prestige militaire (vainqueur de VERDUN) et commandant en chef des forces françaises jusqu’à la fin de la guerre de 1914-1918 – avait été, lui aussi, choisi comme l’homme providentiel en 1940 pour faire face aux allemands, mais, rapidement débordé, il sombra dans le défaitisme puis la collaboration avec l’occupant nazi en n’opposant aucune résistance aux actes les plus barbares de ceux-ci.
Ci-dessous, Charles de Gaulle, lors de
l’Appel mémorable du 18 juin 1940, lancé sur
les ondes de la BBC à Londres
 Quant à Charles de GAULLE, l’Homme du 18 juin 1940, qui, entre 1940-1945, se rebella contre le régime défaitiste et collaborationniste de VICHY et incarna, avec courage et lucidité, la résistance à l’occupation nazie de la France, il fut considéré, mais a posteriori, et au lendemain de la victoire, comme « l’homme providentiel » sauveur de la France et de son honneur.
Quant à Charles de GAULLE, l’Homme du 18 juin 1940, qui, entre 1940-1945, se rebella contre le régime défaitiste et collaborationniste de VICHY et incarna, avec courage et lucidité, la résistance à l’occupation nazie de la France, il fut considéré, mais a posteriori, et au lendemain de la victoire, comme « l’homme providentiel » sauveur de la France et de son honneur.
Si son rôle historique incontestable dans sa double résistance à l’ennemi nazi et à Pétain lui permit d’accéder au pouvoir en 1958, ce fut néanmoins dans des circonstances assez peu républicaines, sous la pression violente, à Alger, des partisans factieux de l’Algérie française et plus encore à la suite du putsch d’Alger ou coup d’État du 13 mai 1958, conduit conjointement par l’avocat et officier parachutiste de réserve Pierre LAGAILLARDE, les généraux Raoul SALAN, Edmond JOUHAUD, Jean GRACIEUX, l’amiral AUBOYNEAU, avec l’appui de la 10e division parachutiste du général MASSU et la complicité active des alliés du gaulliste Jacques SOUSTELLE. Au pouvoir, de 1958 à 1969, De GAULLE mit en place, avec la constitution du 4 octobre 1958, une forme autoritaire de gouvernement consacrant la prééminence de l’Exécutif. Sur le plan de la politique internationale de la France, il se démarqua de l’atlantisme – dans lequel avait sombré la Troisième force née sous la 4ème République – pour affirmer la souveraineté et l’indépendance de la France vis-à-vis des deux blocs dont le triple affrontement idéologique, économique et militaire généra la « guerre froide ». Mais, malgré l’influence des « gaullistes de gauche » (René CAPITANT, Louis VALLON, etc.), il eut du mal à se libérer des forces conservatrices qui étaient son principal soutien et qui d’ailleurs le lâchèrent lors du référendum du 27 avril 1969 sur la régionalisation et la réforme du Sénat.
Mais, par rapport à la définition somme toute assez classique de Jean GARRIGUES, fondamentalement ancrée dans l’histoire et rappelée ci-dessus, la notion d’homme providentiel a subi aujourd’hui une mutation sous l’angle de l’extension des circonstances qui le conduisent au pouvoir et la banalisation de ses qualités de « chef » : il n’est plus l’homme « exceptionnel », déjà reconnu par une histoire qui précède son accès au pouvoir ni forcément appelé pour affronter les crises et les tempêtes, mais il est devenu l’homme politique du quotidien – ayant suivi en général un cursus politique au sein d’un parti où il s’est constitué un cercle d’amis et de partisans. C’est pour désigner un tel homme à la fonction suprême que le peuple est périodiquement convoqué pour lui remettre les clés du pouvoir en lui confiant la conduite du pays. Il est aujourd’hui choisi tous les cinq ans et doté de pouvoirs constitutionnels considérables, ce qui est en soi aussi aberrant qu’infantile, car, de tous les présidents que nous avons connus depuis 1958, y en a-t-il eu un seul qui ait été vraiment « providentiel » quand tous connurent, rapidement après leur élection, la même désaffection de nos concitoyens estimant qu’ils s’étaient éloignés des aspirations populaires ? C’est le sacre du suffrage universel qui accrédite cette idée absurde et si peu républicaine d’« homme providentiel » car il ne s’agit que d’un homme ordinaire que la Constitution place au-dessus de ses semblables malgré le principe d’égalité civique consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Comme il a été dit, cette même Constitution accentue davantage cette posture inégalitaire en conférant au Président des pouvoirs parfois encore plus exorbitants que ceux conférés au monarque de droit divin de la monarchie d’Ancien Régime.
Il serait temps, enfin, de laisser « la Providence » – divine ou laïque – entre les mains des religieux ou des mystiques et, en matière constitutionnelle, de faire le choix plus rationnel et avisé, pour nos concitoyens et avec eux, de la démocratie et d’une vraie République car cela n’a rien de gauchiste ni de subversif, comme nous l’ont montré au moins les choix qui furent faits dans trois de nos républiques antérieures : la 1ère République, avec la constitution du 24 juin 1793 ; la troisième République avec les lois constitutionnelles de 1875 ; la 4ème République avec la Constitution du 27 octobre 1946.
Mais il ne s’agit pas de les recopier ni de les imiter mais de nous en inspirer en nous efforçant d’aller encore plus loin dans le contrôle de l’action des gouvernants par le peuple souverain : référendum d’initiative populaire ou « citoyenne » ; référendum révocatoire d’une loi votée par le Parlement ; limitation des mandats dans le temps ; choix du scrutin à la représentation proportionnelle ; rappel des élus sous contrôle de leurs mandants [12] ; contrôle populaire de l’Exécutif et du Parlement, etc.
Certains de ses mécanismes de démocratie semi-directe existent déjà avec une certaine efficacité dans certains pays (SUISSE, ITALIE, certains États fédérés des USA depuis 1898 [13]) et la France, aujourd’hui, a pris du retard dans le développement du processus démocratique qui s’est grippé et momifié dans notre pays.
II/ Le rôle de parti d’opérette assigné à l’opposition par le parti présidentiel Renaissance
Il nous semble que « Renaissance » serait bien avisée de faire sienne cette citation de Léon GAMBETTA :
« Ce que les majorités victorieuses ont surtout à redouter, c’est de vouloir toucher à tout à la fois, au risque de tout confondre et de tout compromettre. » (Déclaration du 25 octobre 1875 de Léon GAMBEATTA).
L’on est sidéré par les discours outranciers que l’on entend à droite (majorité actuelle) à propos de l’opposition des syndicats et de la NUPES à la réforme des retraites.
A/ De la polémique politicienne à la vérité
1/ Des étiquettes politiques à la réalité
Nos adversaires incarnent le trouble et des désordres et ne veulent pas faire une « réforme des retraites, c’est impopulaire ».
C’est en ces termes qu’Aurore BERGER, députée des Yvelines et surtout présidente des députés macronistes à l’Assemblée nationale, dans une interview donnée au quotidien « Le Parisien » le dimanche 2 octobre 2022 (voir page 7), défend la ligne de la majorité sur les retraites et justifie à l’avance le 49-3.
Les étiquettes politiques accolés parfois à un parti par ses adversaires politiques ou le monde des journalistes – le taxant, hier, d' »extrême gauche radicale », aujourd’hui, de « gauchiste », ou d’« islamo-gauchistes », etc. – doivent être à prendre le plus souvent avec des pincettes tant elles traduisent si mal la réalité et la travestissent.
Le précédent des « radicaux » honnis par la droite cléricale sous la Troisième République
Rappelons, pour mémoire, que lors de la campagne pour les élections législatives d’août-septembre 1881, les « radicaux » de l’époque (tout ça parce qu’ils ne voulaient pas, entre autres, d’un Sénat conservateur) emmenés par Georges CLEMENCEAU s’opposaient aux républicains dits « modérés » dont le chef de file était alors GAMBETTA. Le scrutin fut remporté par l’Union républicaine de GAMBETTA (204 sièges), devant la Gauche républicaine de Jules Ferry et le Centre gauche (39 sièges).
Quant au parti de CLEMENCEAU, qui était qualifié « d’extrême-gauche radicale », il n’obtint que 46 sièges…
Ci-dessous, Georges CLEMENCEAU
par MANET, entre 1879 et 1880
 C’est qu’après 1880, ce fut CLEMENCEAU qui prit la tête de la tendance de « gauche » des républicains, tandis que Jules FERRY et GAMBETTA se tournaient vers le centre et vers « l’opportunisme ». Jusqu’en 1902, les radicaux n’hésitèrent jamais à s’associer aux gouvernements de « défense républicaine » contre le boulangisme et contre la montée du nationalisme, après le scandale de Panama, et plus tard contre l’agitation d’extrême droite provoquée par l’affaire Dreyfus. Ils étaient alors – comme LFI aujourd’hui – bien plus souvent dans l’opposition qu’au pouvoir. Pourtant, c’est l’esprit du radicalisme qui inspira les grandes lois de cette période où la démocratie politique s’organisa et se structura : loi de 1881 sur la liberté d’expression, loi de 1884 sur les conseils municipaux et sur les syndicats, lois sur l’enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire, révision de la Constitution de 1875, loi sur les associations, etc.
C’est qu’après 1880, ce fut CLEMENCEAU qui prit la tête de la tendance de « gauche » des républicains, tandis que Jules FERRY et GAMBETTA se tournaient vers le centre et vers « l’opportunisme ». Jusqu’en 1902, les radicaux n’hésitèrent jamais à s’associer aux gouvernements de « défense républicaine » contre le boulangisme et contre la montée du nationalisme, après le scandale de Panama, et plus tard contre l’agitation d’extrême droite provoquée par l’affaire Dreyfus. Ils étaient alors – comme LFI aujourd’hui – bien plus souvent dans l’opposition qu’au pouvoir. Pourtant, c’est l’esprit du radicalisme qui inspira les grandes lois de cette période où la démocratie politique s’organisa et se structura : loi de 1881 sur la liberté d’expression, loi de 1884 sur les conseils municipaux et sur les syndicats, lois sur l’enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire, révision de la Constitution de 1875, loi sur les associations, etc.
Rappelons également que lorsque le radical Léon BOURGEOIS, devint, le 1er novembre 1895, Président du Conseil et forma le premier ministère radical homogène – avec l’intention d’appliquer le programme du parti radical – il se heurta à la droite en proposant le vote d’un « impôt progressif sur le revenu », sans succès, qui le contraignit à la démission le 23 avril 1896.
Enfin, le « radical » CLEMENCEAU, en novembre 1917, fut à nouveau nommé président du Conseil et forma un gouvernement acquis à la poursuite de la guerre avec la ferme volonté d’aboutir à une victoire totale sur l’Empire allemand en galvanisant toutes les énergies, civiles et militaires, n’hésitant pas à rendre visite aux valeureux soldats courbés et exténués par de nombreux jours passés dans la boue des tranchées.
C’est dire que notre république est redevable de beaucoup de grandes lois et de fortes poussées avant-gardistes aux « radicaux » conduits par CLEMENCEAU : amnistie pour les communards ; opposition à la colonisation conduite par jules Ferry ; engagement pour la défense du capitaine Dreyfus par la publication par CLEMENCEAU, dès 1899, de son livre L’iniquité ; séparation des églises et de l’Etat qui se réalisera enfin en 1905, etc.
Mais c’est vrai qu’en politique, c’est bien connu, « l’enfer, c’est les autres ! »
Assez peu soucieuse de l’existence d’une représentation nouvelle du pays à l’Assemblée nationale ainsi que du rôle du Parlement et aussi du fait que l’existence d’une majorité relative à l’Assemblée nationale résulte de la volonté du peuple souverain – qui a refusé de donner au Président une majorité absolue afin qu’il trouve un consensus avec la totalité de l’Assemblée -, Mme Aurore BERGER décrète, de manière péremptoire, que dès l’instant que la « réforme » est conçue par l’Exécutif, elle est de ce fait « engagée » et donc doit se « faire »[14].
Ci-dessous, Assemblée nationale en séance
 À quoi servirait donc le Parlement si, sitôt conçue par le Gouvernement, une loi ne pouvait qu’être adoptée par le Parlement sans discussion ?
À quoi servirait donc le Parlement si, sitôt conçue par le Gouvernement, une loi ne pouvait qu’être adoptée par le Parlement sans discussion ?
Le Parlement ne serait-il devenu subitement qu’une chambre d’enregistrement de la volonté de l’Exécutif ?
Quel dogmatisme de croire qu’à soi seul l’on incarne la Raison et le Droit ! C’est le fait du Prince et de sa cohorte de courtisans et de flatteurs ! L’on se croirait replongé quelques siècles en arrière au temps de la Monarchie absolue.
Un tel aveuglement constitue, de surcroît, une mauvaise lecture, fondamentalement antidémocratique du résultat des élections législatives de juin 2022.
2/ Une « réforme » dont Aurore BERGER admet elle-même le caractère « impopulaire »
Réforme des retraites dont l’ensemble des syndicats
ne veulent pas, étant donné son contenu.
Même l’accommodante CFDT (ci-dessous Laurent BERGER)
combat déjà l’âge de départ à la retraite à 65 ans
 En effet, allant encore plus, loin Aurore BERGER considère que « pour certains ça ne sera jamais le moment. Ils auront toujours une bonne raison de ne pas la faire, au prétexte qu’une réforme des retraites c’est impopulaire. Pour nous, c’est surtout une nécessité et le marqueur qu’on veut agir. » [15]
En effet, allant encore plus, loin Aurore BERGER considère que « pour certains ça ne sera jamais le moment. Ils auront toujours une bonne raison de ne pas la faire, au prétexte qu’une réforme des retraites c’est impopulaire. Pour nous, c’est surtout une nécessité et le marqueur qu’on veut agir. » [15]
Mais qu’est-ce une « réforme impopulaire », sinon une réforme dont le peuple souverain ne veut pas ?
Les partis de gauche rassemblés dans la NUPES ne sont pas les seuls à dénoncer cette nouvelle tentative de réforme régressive des reraites au plan social car aujourd’hui tous les syndicats de travailleurs sont mobilisés pour la combattre.
De l’aveu donc de Mme BERGER, la majorité relative présidentielle actuelle veut gouverner contre le peuple, de manière élitiste et méprisante pour l’opposition qui représente plusieurs millions de citoyens et de manière plus générale, et selon l’affirmation même de la présidente du Groupe Renaissance, du peuple.
B/ Une curieuse présidence de l’Assemblée nationale contestant les pouvoirs du Parlement dont sa présidente actuelle est pourtant censée incarner la force et l’identité
Répondant aux questions de France Télévisions, dimanche 2 octobre au JT de 13h, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël BRAUN-PIVET confondant « audition » et « concertation » estime que la rentrée parlementaire a été bien préparée parce que vingt ministres ont été « auditionnés » et justifie par avance l’usage du 49-3 par le Gouvernement et de l’utilisation de l’arme de la dissolution par le Président en estimant que si le « Parlement » est bloqué c’est parce que, selon elle, il « ne remplit pas sa mission constitutionnelle qui est de légiférer et contrôler le gouvernement ».
Mais en quoi s’opposer à une loi et une réforme, si l’on n’est pas d’accord avec le Gouvernement, constitue-t-il une attitude anticonstitutionnelle ?
Si le Gouvernement a bien l’initiative des lois concurremment avec le Parlement, c’est encore et toujours le Parlement qui la vote, aux termes de l’article 24 de la Constitution. Il possède le droit d’amendement (article 44 de la Constitution). L’article 45, enfin, dispose que « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. »
Les textes constitutionnels sont clairs : le pouvoir d’adoption d’une loi appartient au Parlement (article 24). Les dispositions constitutionnelles posent la règle, pour l’adoption d’une loi, de la nécessité d’une majorité dans chacune des deux chambres en vue de l’adoption d’un texte identique (article 45).
Le Gouvernement n’est pas démuni car face à une pléthore d’amendements, s’il veut sauvegarder son texte originel ou sa philosophie, il peut demander « à l’Assemblée saisie de se prononcer par un seul vote, sur tout ou une partie du texte en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement » (article 44, alinéa 3 de la Constitution).
En quoi les prérogatives du Gouvernement et du Président et leur usage – article 49-3 dont le Gouvernement a la maîtrise et article 12 relatif à la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la république – sont-elles plus constitutionnelles que l’usage par le Parlement de ses prérogatives propres en matière législative ?
De tels discours « va-t-en-guerre » de la part de la représentante de la majorité parlementaire à l’Assemblée nationale (parti RENAISSANCE du Président) avec cette mise en cause des pouvoirs du Parlement – dès qu’une majorité se dérobe – est symptomatique du déséquilibre originel au sein des institutions de la 5ème République qui s’est efforcé de déplacer le lieu politique du pouvoir du Législatif – où se faisait la loi expression de la volonté générale – vers l’Exécutif.
La loi ne devrait-elle plus n’être que l’expression de la volonté présidentielle à laquelle serait soumise le Parlement ?
Ce serait alors une véritable révolution dans notre droit constitutionnel n’allant pas forcément dans le sens de notre République dont le principe « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » est pourtant inscrit dans l’article 2, alinéa 5, de notre actuelle Constitution.
CONCLUSIONS
1/ Les nombreuses contradictions de la Constitution du 4 octobre 1958
La Constitution actuelle du 4 octobre 1958 énonce une série de dispositions contradictoires : souveraineté du peuple (articles 2 et 3) et article 49-3 mettant momentanément en « vacances » ses représentants en privant le Parlement de son droit de faire la loi (article 24) et de l’amender (article 44) ; article 11 relatif à la procédure référendaire mais laissant celle-ci entre les mains du Président de la République ou du Parlement dans sa mise en œuvre (alinéa 3), ce qui dans les deux cas écarte le peuple de l’initiative proprement dite car il ne s’agit que d’un référendum d’initiative partagée (RIP) assujetti à des conditions draconiennes ; délégation, par le biais de l’article 38, trop fréquente du pouvoir législatif au Gouvernement [16] dans toutes les matières législatives, même parmi les plus fondamentales intéressant le droit des personnes. Or devaient être exclues du champ de l’habilitation donnée au Gouvernement par le Parlement (article 38 précité) le droit civil, le droit pénal, le droit commercial, le droit du travail et le droit social ainsi que les réformes structurelles ayant une incidence économique (privatisations comme celles de services publics tels que la SNCF, les ADP, etc.) ou sociale élevée (l’on pense aujourd’hui à la réforme des retraites par exemple) et, en tout cas, considérée comme telle par les acteurs institutionnels et nos concitoyens [17]. Il faudrait aussi y ajouter les libertés publiques qui devraient être exclues du champ de l’habilitation.
A fortiori, dans ces matières, si l’article 49-3 n’était pas abrogé en tant que contraire aux prérogatives du Parlement, mais devait perdurer, son utilisation devrait être formellement exclue.
2/ En matière référendaire…
Comme on l’on a vu, à propos de la privatisation des aéroports de Paris (ADP [18]) décidée en avril 2019, la procédure référendaire, dès que le peuple s’en mêle est difficile à actionner tant il a été difficile de totaliser le dixième des électeurs inscrits – soit près de 5 millions d’électeurs (4,7 millions de citoyens) – et encore seulement pour demander au Parlement de se prononcer une nouvelle fois sur un nouveau texte demandant l’abrogation de la loi qu’il avait antérieurement votée.
Comme l’avaient signalé de nombreux députés d’opposition, l’intérêt était évident, pour l’Etat, de conserver la maîtrise du Groupe ADP du fait de son caractère « stratégique » pour la France en termes d’aménagement du territoire, d’emploi local ou de sécurité des frontières et de la bonne santé d’ADP dont la rentabilité ne cessait d’augmenter depuis 10 ans et dont par ailleurs les bénéfices étaient en hausse de 6,9% en 2018 [19].
C’est dire qu’une telle loi de privatisation, habilement insérée dans l’article 49 de la loi PACTE, n’avait comme justificatif que de satisfaire la doxa libérale du Gouvernement d’alors et du Président MACRON.
3/ Requiem pour le référendum de l’article 11 (retour sur image) et pour son remplacement par un vrai mécanisme de consultation populaire
Force est de constater que l’article 11 de notre Constitution a été essentiellement utilisé par le Général de Gaulle pour court-circuiter le Parlement et lui permettre d’imposer ses vues. Ainsi en fut-il en 1962 pour l’adoption de la réforme constitutionnelle décidant de l’élection du Président de la République au suffrage universel, malgré l’hostilité du Sénat sans l’accord duquel cette réforme n’aurait pas dû voir le jour si la procédure de révision constitutionnelle de l’article 89 avait été respectée.
D’autres fois, le référendum fut utilisé comme un plébiscite pour valider sa politique, notamment à propos du règlement politique de la guerre d’Algérie : référendums du 8 janvier 1961 organisé pour faire valider la politique d’autodétermination du général de Gaulle en Algérie ; référendum du 8 avril 1962, toujours sur le dossier algérien, pour autoriser le président de la République à négocier un traité avec le futur gouvernement algérien, mais, en fait, ayant pour but de faire approuver par les Français les accords d’Évian du 18 mars 1962.
Quant au référendum du 27 avril 1969, il fut fatal au Général de GAULLE. Si, formellement les électeurs devaient se prononcer sur la régionalisation et la réforme du Sénat, le débat porta en réalité sur le maintien au pouvoir ou le départ du général de Gaulle, après onze ans de présidence et un an après la crise de mai 1968. Les « non » l’emportèrent avec 52,41% des suffrages exprimés. Le lendemain, 28 avril 1969, le président de Gaulle démissionnait.
4/ De la nécessité de rattraper le retard pris par la France en matière de démocratie semi-directe
La France a pris du retard dans le développement du processus démocratique qu’elle avait pourtant été l’une des premières nations à initier au niveau européen et plus généralement dans le monde. Sa foi aveugle dans les vertus du régime représentatif l’a conduite à s’abstenir, en effet, d’ouvrir constitutionnellement son régime de démocratie représentative aux mécanismes correcteurs de la démocratie semi-directe que sont le référendum de validation ou d’abrogation d’une loi votée par le Parlement, un tel type de référendum était présent dans la constitution montagnarde du 24 juin 1793, de l’An I de la République, dans les articles 59 et 60 en matière législative sous le terme de « réclamation », et en matière de « révision de l’acte constitutionnel » dans les articles 115 à 117 ; l’initiative populaire (ou RIC) de confection d’une loi ; le contrôle de tous les élus au cours de leur mandat par le référendum révocatoire de leur fonction.
5/ De la nécessité de refonder notre République en allant vers une Sixième République authentique
Devant le comportement aujourd’hui outrancier du Président, de son Premier Ministre et des élus de Renaissance – qui ont la prétention de gouverner contre le peuple -, la question de la refondation de notre République est plus que jamais posée avec l’avènement d’une 6ème République authentique se substituant à notre actuelle cinquième République qui n’a depuis 64 ans de république que le nom abusivement usurpé.
Louis SAISI
Paris, le 11 octobre 2022
Tableau des sigles et abréviations :
ADP = Aéroports de Paris ;
CNRS = Centre National de la Recherche Scientifique ;
CPU = Conférence des Présidents d’Université ;
EELV = Europe Ecologie Les Verts ;
LFI = La France Insoumise ;
LR = Les Républicains ;
MDC = Mouvement des Citoyens ;
NUPES = Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale ;
PACTE = Plan d’action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises
( Loi promulguée le 22 mai 2019) ;
PCF = Parti Communiste Français ;
PRG = Parti Radical de Gauche ;
PS = Parti Socialiste ;
RIP = Référendum d’Intiative Partagée ;
RIC = Référendum d’Initiative Citoyenne ;
RPR = Rassemblement pour la République ;
SPQR = Senatus populusque Romanus ;
SNCF = Société nationale des Chemins de fer Français (malmenée depuis sa privatisation) ;
TCE = Traité constitutionnel européen.
NOTES
[1] Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta, publiés par M. Joseph Reinach, 11 vol., Paris, G. Charpentier, 1880-1885, vol. VII, pp.7-10.
[2] Le Rassemblement National de Mme LE PEN n’a pas davantage été avare de critiques acerbes.
[3] Voir sur ce site notre article « Il était une fois l’OTAN ».
[4] Michel VERPEAUX (Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris-I) – Directeur du Centre de recherches de droit constitutionnel) : « Les ordonnances de l’article 38 ou les fluctuations contrôlées de la répartition des compétences entre la loi et le règlement », CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 19 (DOSSIER : LOI ET RÉGLEMENTS) – JANVIER 2006 ; conseil-constitutionnel.fr/…/les-ordonnances-de-l-article-38-ou-les-fluctuations-controlees-de-la-repartition-des-competences
[6] Catherine DECOUAN : « La démocratie romaine à la loupe », in HISTORIA, spécial 83.
[7] Le Littré, le dictionnaire de référence de la langue française, Éditions GARNIER, septembre 2007, tome 17, p. 152
[8] Source site L’Agora : « Le régime républicain », 8 août 2013.
[9] Jean GARRIGUES : Les hommes providentiels : histoire d’une fascination française, Paris, Éditions du Seuil, 2012, 459 p. Jean GARRIGUES, La Tentation du sauveur : histoire d’une passion française, Paris, Histoire Payot, 2022, 456 p. (édition augmentée de Les hommes providentiels).
[10] Auquel l’on peut cependant reprocher une certaine tendance à vouloir banaliser l’homme providentiel pour le présenter, sans aucune critique, comme un élément constitutif du système républicain justifiant ainsi implicitement toutes les dérives actuelles de nos institutions publiques au point faire un panthéon des figures politiques qui ont tenté de l’incarner.
[11] Jean GARRIGUES : « Le mythe de l’homme providentiel est un paradoxe de la France démocratique et républicaine », interview à FIGAROVOX du 25/02/2022.
[12] Le contrôle des élus par les électeurs existe dans certains États fédérés aux USA sous la forme du « recall », technique permettant au corps électoral de censurer les élus et de mettre fin à leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat.
[13] Jean-Pierre LASSALE : « Le référendum aux États-Unis », Pouvoirs n°77 – Le référendum – avril 1996 – p.152-165. Selon cet auteur, « … l’exercice de la démocratie semi-directe est concentré dans le bloc massif des États de l’Ouest et du Centre, du Dakota du Nord au Washington, et du Washington à l’Arizona. A quelques exceptions près – Michigan, Illinois, Floride, Alaska –, ce sont dans les États de l’Ouest que l’on trouve, conjugués, l’initiative, le référendum et le « recall ».
[14] Aurore BERGER : « Le Parisien » du dimanche 2 octobre 2022 (voir page 7),
[15] Aurore BERGER : « Le Parisien » du dimanche 2 octobre 2022 (voir page 7),
[16] Jean-Marc SAUVÉ : Intervention du 6 juin 2014 à l’occasion du colloque organisé par le Centre d’études constitutionnelles et politiques, l’Institut Cujas et la Société de législation comparée, cf. Conseil d’Etat : « La législation déléguée ». Selon Jean-Marc SAUVÉ, alors Vice-président du Conseil d’Etat, « 600 ordonnances, qu’elles aient été ratifiées ou non par le Parlement, étaient en vigueur à la fin de l’année 2010, sans compter celles dont le contenu s’est incorporé dans les codes en vigueur. »
[17] Jean-Marc SAUVÉ, intervention op. cit. Selon l’ancien Vice-président du Conseil d’Etat, « L’usage de la législation déléguée ne saurait conduire à retirer au Parlement l’examen de textes qui, compte tenu de leur domaine d’intervention et de leurs enjeux politiques, relèvent du cœur de ses missions. Celui-ci ne recouvre pas seulement le périmètre des réformes dites de société, mais comprend également les réformes substantielles de notre droit, notamment civil, commercial, social et pénal, ou les réformes structurelles ayant une incidence économique ou sociale élevée et, en tout cas, considérée comme telle par les acteurs institutionnels et nos concitoyens ».
[18] Le Groupe ADP possède les aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle (72,2 millions de passagers), Orly (33,1 millions de passagers), Le Bourget et une dizaine d’aérodromes. Ces aéroports sont aussi des centres commerciaux d’envergure, avec 386 boutiques et services, qui ont rapporté, à eux seuls, 1 milliard d’euros en 2018.
[19] Cf. Les Décodeurs, Le Monde en ligne du 13 juin 2019 : « Les questions que pose la privatisation des aéroports de Paris ».

