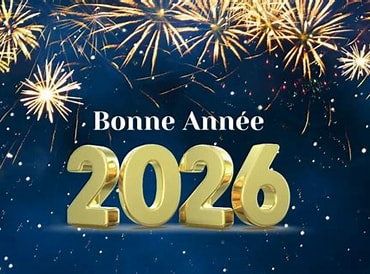Chers amis,
Nous remercions chaleureusement notre amie Florence GAUTHIER, éminente universitaire, historienne des révolutions de France et de Saint-Domingue-Haïti, qui nous livre ci-dessous un article intitulé « Galanterie et Amours paysannes à l’époque moderne en France ».
Nous avons déjà donné d’elle, le 22 janvier 2019, une brève notice biographique sur ce site – notamment à l’occasion de son article sur « Kant, le droit cosmopolite et la société civile des nations » co-écrit avec Marc BELISSA (https://ideesaisies.deploie.com/kant-le-droit-co…-et-marc-belissa/) – à laquelle nous renvoyons (nombreuses publications sur la Révolution française et Robespierre).
S’appuyant sur ROBESPIERRE et François-Noël BABEUF (dit Gracchus BABEUF), elle s’efforce de nous montrer ici que la galanterie a sa place dans un projet politique démocratique pour lequel les deux ardents révolutionnaires précités luttèrent constamment.
Membre très actif de l’académie d’Arras, ROBESPIERRE, qui en assuma la présidence dès 1787, s’efforça d’ouvrir celle-ci à la mixité des sexes dont il souligna les avantages. C’est ainsi qu’à cette date deux femmes furent élues comme membres honoraires de l’académie d’Arras, dont Louise de KÉRALIO.
Dans sa réponse à Louise de KÉRALIO, récipiendaire, ROBESPIERRE n’oublia pas de citer ASPASIE qui s’attira le respect de la plupart des grands hommes de son temps grâce à son érudition dans l’art oratoire et politique. Elle contribua ainsi à l’âge d’or de la démocratie athénienne (V° siècle, « siècle de Périclès »), en associant son nom à celui de PÉRICLÈS et surtout à la culture galante.
Quant à François-Noël BABEUF (dit Gracchus BABEUF), partisan infatigable de « l’égalisation » qui « perfectionne et ne détruit rien », il milita, entre autres convictions politiques, pour détruire « la servitude de la femme » afin de « proclamer son affranchissement ».
Ainsi, nous rappelle avec force Florence GAUTHIER, « la galanterie n’était pas un domaine réservé aux classes nobles et riches, mais faisait partie d’un projet démocratique comme le proposèrent ROBESPIERRE et BABEUF, qui en expriment le désir et l’urgence. »
Avec le développement des revendications féministes – et la place centrale prise par ce mouvement dans nos sociétés modernes – cet article percute une actualité souvent tensionnelle par rapport à laquelle Florence GAUTHIER a le mérite de nous éclairer en nous montrant, avec pertinence que, contrairement à des raccourcis abusifs, la galanterie – confondue trop souvent avec le Don Juanisme – n’est nullement l’ennemie du féminisme.
Louis SAISI
Paris, le 30 juillet 2025
——————————
Galanterie et Amours paysannes à l’époque moderne en France par Florence GAUTHIER, Historienne des Révolutions de France et de St-Domingue/Haïti
Ci-dessous Le Pèlerinage à l’île de Cythère [1],
d’Antoine WATTEAU, réalisé en 1717, et présenté
par le peintre comme morceau de réception
à l’Académie royale de peinture où il fut reçu
dans le genre de « la fête galante », spécialement créé pour lui.
Ce tableau est aujourd’hui exposé au musée du Louvre
 Ce que l’on nomme galanterie se retrouve dans différentes parties du monde et sous d’autres noms et n’appartient pas seulement aux classes supérieures, puisqu’on rencontre des formes populaires au Moyen-âge, en Europe et ailleurs, à l’époque moderne. Je me limite au Royaume de France en commençant par la forme que lui donna la cour du roi, avant de préciser quelques traits spécifiques de cette culture populaire.
Ce que l’on nomme galanterie se retrouve dans différentes parties du monde et sous d’autres noms et n’appartient pas seulement aux classes supérieures, puisqu’on rencontre des formes populaires au Moyen-âge, en Europe et ailleurs, à l’époque moderne. Je me limite au Royaume de France en commençant par la forme que lui donna la cour du roi, avant de préciser quelques traits spécifiques de cette culture populaire.
La galanterie avait comme objectif de civiliser les relations entre les sexes et se déploya à la cour du roi de France du XVIe au XVIIIe siècles. Elle fut combattue au XIXe siècle, jusqu’à perdre son rôle d’éducation sociale, mais ne disparut pas pour autant, même si elle suscita, dans certains courants prétendus féministes récents, mépris et rejet.
Historienne de la Révolution française, j’ai fait connaissance avec la galanterie lorsque je suis tombée sur un texte de ROBESPIERRE qui m’a interloquée : je ne comprenais pas ce dont il parlait et je suis partie à la recherche de ce qui m’échappait.
I
La proposition d’une galanterie démocratique par Robespierre avant et pendant la Révolution
Il faut rappeler que depuis plus de deux siècles, la figure de ROBESPIERRE est devenue peu à peu celle d’une Méduse accouchant de monstres politiques, pourtant apparus ultérieurement ! Mais, par un effet singulier, ces fabricateurs de mythes de la Révolution française se sont efforcés d’en situer l’apparition chez ROBESPIERRE lui-même ! Ainsi, les Thermidoriens lui ont attribué la Terreur et l’anarchie, le centenaire de la Révolution française a voulu en faire le pontife d’une religion nouvelle, le stalinisme des années 1930 en a fait un petit bourgeois, le post-modernisme l’a affublé de la paternité de la Terreur comme matrice des totalitarismes du XXe siècle [2]. Le dernier né de ces monstres sur l’exclusion des femmes des droits politiques attribuée à la Révolution française et, en particulier à ROBESPIERRE, a été repris par certains courants féministes récents, venant des Etats-Unis [3]. Je ne répondrai ici qu’au dernier monstre d’un ROBESPIERRE misogyne, en présentant ce que j’ai trouvé dans ses textes et dans ses actes.
ROBESPIERRE à l’Académie d’Arras, 1783-1789

Les deux hommes voulaient ouvrir l’Académie à la mixité des sexes et, en 1787, deux femmes furent élues comme membres honoraires : deux femmes de lettres, Marie Le MASSON Le GOLFT, qui habitait le Havre et s’intéressait aux sciences de la nature, et Louise de KÉRALIO qui vivait à Paris. Précisons que l’on ne connaît, semble-t-il, que cinq femmes qui aient participé aux Académies privées, à cette époque, comme membres honoraires : celle d’Arras en a fait entrer une troisième en 1789, Melle du CHATELLIER, et forme ainsi la pointe avancée de ce mouvement de mixité dans ce type d’académies.
Notons que Louis-Félix de KÉRALIO [4], le père de Louise, avait été choisi parmi les précepteurs envoyés avec Condillac à la cour de Parme, car une des filles de Louis XV avait épousé le Prince de Parme, et son fils devait recevoir une éducation princière : Louise en bénéficia.
Du même âge que ROBESPIERRE, Louise venait de publier une Histoire d’Elisabeth, reine d’Angleterre et les premiers volumes d’une Collection des meilleurs ouvrages français composés par des Femmes, qui en comptera 14. Notons que la littérature par des femmes ne manque pas ! Donc, le 18 avril 1787, ROBESPIERRE présenta Louise de KÉRALIO dans ce qu’il appelle « sa profession de foi [5] ».
Constatant la rareté des femmes dans les sociétés savantes, il qualifie cette situation de : « honteuse […] de scandale d’un siècle éclairé » et attribue la cause de cette rareté aux préjugés qu’il faut combattre et se révèle partager les principes de cartésiens comme Poulain de la Barre [6]. ROBESPIERRE affirme, en effet, l’égalité entre les deux sexes doués des mêmes facultés et précise que des différences de sexe ne doivent pas devenir le prétexte d’une domination de l’un par l’autre. Il ajoute qu’offrir aux femmes des places de membre honoraire dans les sociétés savantes est insuffisant, parce qu’elles ne sont jamais là, sauf à la séance de leur réception. Il propose de leur ouvrir la possibilité d’être des membres ordinaires qui participent physiquement et intellectuellement à la production du savoir et aux débats, je le cite : « Ce n’est pas seulement par leurs lumières que les femmes contribueraient au progrès des lettres et à la gloire des sociétés savantes, c’est surtout par leur présence. [7] »
Son plaidoyer décrit longuement les avantages sur le plan intellectuel, mais aussi sur la vie des sociétés savantes et insiste sur l’émulation et la gloire qui en résulteraient, émulation transformée parce que les femmes participeraient au jugement des auteurs. La gloire qu’il définit ainsi : « C’est l’amour et l’admiration de nos semblables. L’amour de la gloire est donc le désir d’inspirer ces sentiments aux autres [8]. »
Amour et admiration réciproques, mêlés à une émulation non dépourvue de séduction. Nous retrouvons ici ce que la préciosité du XVIIe siècle avait mis en avant : les femmes sont précieuses et doivent être respectées, elles interviennent dans la vie littéraire, elles écrivent elles-mêmes et veulent, elles aussi, être juges des auteurs. Cette mixité ferait naître encore un bonheur particulier que ROBESPIERRE imagine et décrit.
Je m’arrête un instant sur ce dernier point car, la première fois que j’ai lu ce texte, j’ai senti que quelque chose m’échappait et que je ne comprenais pas de quoi il s’agissait. Ce sont ces formulations, où dominent la réciprocité, qui m’ont invitée à chercher ce dont ROBESPIERRE parlait et j’ai alors suivi les indications bibliographiques qu’il précisait dans son texte et j’ai fini par apprendre qu’il s’agissait du bonheur créé par une érotisation des relations sociales, propre à la culture de la galanterie et que, celle-ci étant tombée dans l’oubli, nous est devenue plus difficilement sensible [9].
J’ai appris par ailleurs qu’il s’était produit la même chose avec la musique et l’esthétique baroque, qui accompagna la galanterie du XVIe au XVIIIe siècles [10].
Voilà donc la galanterie devenue un « trésor perdu » comme « la liberté avant le libéralisme » que Quentin SKINNER a pu ramener à la surface du passé de l’Angleterre, ou encore le grand livre de Peter LASLETT, Un monde que nous avons perdu [11].
Qu’est-ce que la galanterie ?
 Je m’appuie sur le travail de Claude HABIB, « La galanterie française », 2006 : la galanterie n’est pas à confondre avec le libertinage et encore moins la débauche. Elle souligne que la galanterie est une politique qui a pour objet les rapports entre les deux sexes et se caractérise par une culture réciproque de civilisation : les hommes doivent respecter les femmes, avoir des égards pour elles, leur faire confiance et se soumettre à leurs jugements. ROBESPIERRE l’exprime de la manière suivante : « Nous le savons et elles ne l’ignorent pas, nous sommes tout ce qu’elles veulent que nous soyons. C’est à elles à exiger que nous soyons toujours dignes d’elles » [12].
Je m’appuie sur le travail de Claude HABIB, « La galanterie française », 2006 : la galanterie n’est pas à confondre avec le libertinage et encore moins la débauche. Elle souligne que la galanterie est une politique qui a pour objet les rapports entre les deux sexes et se caractérise par une culture réciproque de civilisation : les hommes doivent respecter les femmes, avoir des égards pour elles, leur faire confiance et se soumettre à leurs jugements. ROBESPIERRE l’exprime de la manière suivante : « Nous le savons et elles ne l’ignorent pas, nous sommes tout ce qu’elles veulent que nous soyons. C’est à elles à exiger que nous soyons toujours dignes d’elles » [12].
Claude HABIB souligne que les relations amoureuses en font partie et la culture galante initie au commerce spirituel et donc, à la mixité de la société, à une érotisation sociale, à une valorisation de l’amour, du plaisir de la séduction, de la délicatesse et même à l’héroïsme amoureux. Ce respect des femmes a permis de valoriser le droit des femmes à disposer d’elles-mêmes, en commençant par la propriété de leur corps, ce qui représente une grande conquête, et a incontestablement contribué à construire l’égalité entre les deux sexes et leur désaliénation réciproque : la galanterie parle d’amour publiquement, comme d’une passion universellement partagée et non sur un registre seulement privé [13].
On ne peut s’empêcher de penser que la galanterie participe d’une culture du don et du contre-don. Notons que la galanterie appartient au monde profane du bonheur, de la gaieté et des plaisirs [14] et qu’elle a croisé les chemins du grand mouvement de séparation des facultés humaines de la théologie, qui a caractérisé la période de la fin du Moyen-âge et de l’époque moderne, soit le long processus de laïcisation. Ce qui n’empêchait pas de galantes personnes de choisir de finir leurs jours dans des couvents.
Selon VOLTAIRE, le mot galanterie vient du celte gal, que l’on retrouve en espagnol avec regalado : délicieux, gala : grâce, élégance, galante en italien et galant en français qui renvoient à un mode relationnel de don et de contre-don. VOLTAIRE ajoute qu’il ne faut pas confondre les expressions positives un galant homme et une galante femme, avec un homme galant, une femme galante qui désignent des débauchés [15].
C. HABIB rappelle qu’en France, la galanterie a été introduite par François Ier qui l’avait ébloui à la cour d’Urbino, en Italie, au point de l’importer dans la sienne, avec l’objectif de polir « les mœurs rudes et grossières du noble guerrier comme de l’austère lettré [16]».
Henri II poursuivit cette politique culturelle, qui fut suspendue durant les Guerres de religion, mais réapparut dans des salons privés, comme celui de Mme de RAMBOUILLET, à Paris. Cette galanterie française a connu son apogée au XVIIe siècle, sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, avec la préciosité qui a rendu l’amour, le tendre, et la sexualité précieux et honorables, alors que jusque-là, l’orgasme était considéré comme une fonction vitale, mais appartenait au « bas corporel ». Ce furent les Précieuses, autour de Melle de SCUDÉRY, qui donnèrent à la sexualité le rôle de recéler les secrets de l’âme [17].
La politique royale de la galanterie a été une véritable éducation sociale de civilisation et l’esthétique baroque l’a chantée et enchantée d’ailleurs, trois siècles durant, dans tous les arts et beaux-arts, sans oublier le théâtre, la danse, l’opéra.
La galanterie se cultive et s’entretient grâce aux salons, dans lesquels on se divertit par des jeux, par des pièces de théâtre ou de musique, jouées par les participants, ou encore par l’organisation de sorties et de promenades. Ces divertissements peuvent s’ouvrir à tous les âges et initient les enfants, les adolescents, comme les adultes.
 Il y a encore des réunions consacrées à la lecture des auteurs des deux sexes, ou à des ateliers d’écriture. Par exemple, les romans galants comme L’Astrée, d’Honoré d’URFÉ (1567-1625) a 5.000 pages et fut écrit à quatre mains : à la mort d’URFÉ, son secrétaire rédigea les deux dernières parties. Par contre, les romans de Madeleine de SCUDÉRY, qui travaillait avec son frère, pouvaient avoir plus de 15.000 pages, car il s’agissait d’ateliers d’écriture : un véritable salon-atelier où l’on pouvait s’entraîner à écrire un récit suivant un autre récit, en créant de nouveaux personnages, comme dans Les Mille et une nuits. Ce qui permet au passage de comprendre qu’à cette époque, ces gens étaient eux-mêmes musiciens, acteurs, danseurs, écrivains, chercheurs, etc… ils étaient fort actifs !
Il y a encore des réunions consacrées à la lecture des auteurs des deux sexes, ou à des ateliers d’écriture. Par exemple, les romans galants comme L’Astrée, d’Honoré d’URFÉ (1567-1625) a 5.000 pages et fut écrit à quatre mains : à la mort d’URFÉ, son secrétaire rédigea les deux dernières parties. Par contre, les romans de Madeleine de SCUDÉRY, qui travaillait avec son frère, pouvaient avoir plus de 15.000 pages, car il s’agissait d’ateliers d’écriture : un véritable salon-atelier où l’on pouvait s’entraîner à écrire un récit suivant un autre récit, en créant de nouveaux personnages, comme dans Les Mille et une nuits. Ce qui permet au passage de comprendre qu’à cette époque, ces gens étaient eux-mêmes musiciens, acteurs, danseurs, écrivains, chercheurs, etc… ils étaient fort actifs !
Toutefois, la culture de la galanterie a été attaquée au début du XVIIIe siècle par le libertinage et la débauche. La galanterie s’est défendue en refusant la figure de Don Juan, séducteur et tyran, qui domine et martyrise ses victimes. Don Juan est l’antithèse des relations galantes fondées sur la confiance réciproque et, plus encore, sur la réciprocité du respect et des égards entre hommes et femmes. En 1688, LA BRUYÈRE l’exprime ainsi : « Le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui [18] ». Et SADE répond un siècle plus tard, je cite : « Il est faux qu’il y ait du plaisir à en donner aux autres ; c’est les servir cela. Et l’homme qui bande est loin du désir d’être utile aux autres. En faisant du mal, au contraire, il éprouve tous les charmes que goûte un individu nerveux à faire usage de sa force : il domine alors, il est un tyran [19] ».
La divergence est nette : la galanterie s’appuie sur ce qui est commun au genre humain, comme la passion, le désir, le plaisir, le bonheur et qui peut être donné, reçu, partagé. SADE choisit la tyrannie et l’inégalité dans les relations entre humains.
CHODERLOS de LACLOS a fait une remarquable critique de la tyrannie de Don Juan dans Les Liaisons dangereuses [20] : Valmont se révèle incapable de répondre à l’amour de Mme de Tourvel qu’il a séduite. Elle est d’une ignorance totale de ses propres sentiments, ce qui révèle qu’elle fut tenue à l’écart d’une éducation galante, qui lui aurait appris à se connaître. Valmont la viole pour commencer, la tyrannise, la méprise et la réduit à la solitude de sa passion qui la submerge. Valmont n’est pas davantage en état de répondre à l’amour de Mme de Merteuil, qui lui offre son amitié et la trahit de façon ignoble.
Un autre adversaire de la galanterie fut ROUSSEAU et ensuite le romantisme. À Genève, ROUSSEAU connaissait la littérature galante qu’il dévorait, mais quand il vint en France il fut mal reçu, n’ayant pas connu l’apprentissage social concret de la galanterie et sa déception lui fit écrire La Nouvelle Héloïse et l’Émile, dans lesquels il affirme la passion individuelle, qui n’est plus partagée et ne veut connaître que le moi singulier.
Le romantisme a rompu avec les Lumières, dont celles de la galanterie. Ce qui disparut alors, c’est bien l’apprentissage collectif dans la connaissance et l’expression des sentiments que la galanterie organisait, en mêlant tous les âges, de l’adolescence à l’âge adulte. Le romantisme ne connaît plus cet apprentissage et les sentiments, comme les passions, sont devenus individuels, uniques.
Notons que le XXe siècle a valorisé la figure de Don Juan, séducteur et tyran, qui n’offre que l’apprentissage de la domination et du martyr. Cette confusion tardive entre galanterie et débauche a probablement contribué à leurrer des courants féministes, qui ne voient plus dans la galanterie qu’une imposture, dissimulant la domination masculine : mais cette confusion ne repose que sur une ignorance.
Le surgissement d’Aspasie
Retournons à ROBESPIERRE et à sa réponse à Louise de KÉRALIO et comment il exprime cette culture galante en proposant de la démocratiser.
La première fois que j’ai rapproché en public ces deux mots : galanterie et démocratie, j’ai suscité des exclamations de surprise car, m’a-t-on objecté, la galanterie ne saurait être démocratique. Il est vrai que la galanterie fait apparaître des comportements de respect réciproque, de séduction, de grâce et d’élégance. Ces qualités seraient-elles étrangères à la démocratie et au peuple ? Et pourquoi donc ?
Si l’on veut bien ne pas perdre de vue que la galanterie est une politique menée en France par les rois dans le but de civiliser les mœurs brutales et aliénées des nobles guerriers et des clercs, on ne voit pas pourquoi une telle politique ne pourrait être menée en démocratie : en tout cas, ce fut une préoccupation de ROBESPIERRE et c’est à ce titre qu’elle nous intéresse ici.

Ci-contre, une représentation d’ASPASIE, femme de lettres, républicaine et démocrate, 1794.
Au salon de peinture de 1794, Marie-Geneviève BOULIAR exposait un remarquable portrait d’Aspasie, thème plutôt rare en peinture.
La peintre avait 22 ans et habitait Paris. Son tableau se trouve au Musée des Beaux-Arts d’Arras [42].
Le buste de Périclès se trouve en arrière-plan, dans l’ombre, et une Aspasie rayonnante est représentée assise à un bureau : elle tient dans sa main gauche un manuscrit, sur la table un globe du zodiaque.
Le vêtement d’Aspasie est simple, une tunique blanche légère et un manteau rouge, elle ne porte aucun bijou et peut se regarder dans un miroir pour y voir : Aspasie, femme de lettres, comme on l’entendait à l’époque de la galanterie, version 1794, séduisante, cultivée, aimée, respectée.
Note F. G : Reproduction d’une huile sur toile 163 x 127, Wikimedia Commons. Voir Annick NOTTER, Guillaume AMBROISE, Le Musée des Beaux-Arts d’Arras, Arras, 1998, tableau reproduit avec une brève notice sur son auteur p 100. Je l’ai vu, alors que je travaillais aux Archives d’Arras sur les papiers de Robespierre, mais je n’ai pu encore établir de rapport entre l’Académie de Dubois de Fosseux, Robespierre et ce tableau d’Aspasie qui se retrouve… dans la ville d’Arras.
Dans son texte, ROBESPIERRE cite les noms des femmes qui ont œuvré à la culture galante et la première est pour lui ASPASIE (représentée ci-dessus) qui vécut avec PÉRICLÈS, je cite :
« O douce illusion ! O spectacle enchanteur ! Je crois voir Socrate et Démosthène conversant avec Aspasie, ou bien les Deshoulières, les Sévigné, les La Suze, les La Fayette, assises dans le sanctuaire des muses, auprès des Bossuet, des Molière, des Racine, des Corneille. »
Il compare ces muses à « de nouvelles Aspasies » :
« Puis-je oublier ces sociétés célèbres, formées dans un temps plus moderne où tous les hommes de génie de la France venaient faire l’hommage de leurs chefs-d’œuvre à de nouvelles Aspasies ! O Rambouillet ! O nom à jamais cher aux lettres ! O temple charmant des Muses et des grâces ! Heureux les hommes de lettres à qui il fut donné de venir dans votre enceinte sacrée recevoir des mains de la beauté la couronne des talents [21]. »
Ces « nouvelles Aspasies » étaient toutes femmes de lettres, poétesses, romancières. Il s’agit de Mme de RAMBOUILLET qui, au XVIIè s, tenait un salon à Paris, bien sûr dédié à la galanterie et de bien d’autres femmes qui animèrent des sociétés galantes [22].
ROBESPIERRE, dans l’Académie d’Arras, vivait la mixité entre nobles et roturiers, comme DUBOIS de FOSSEUX et lui-même s’y retrouvaient, et il propose la poursuite d’une nouvelle mixité entre les sexes dans les sociétés savantes, qu’il place carrément sous l’égide d’Aspasie, c’est-à-dire de la démocratie athénienne, provoquant un rapprochement proprement stupéfiant par son audace, ce qui annoncerait à ses yeux un « progrès des Lumières » et une « heureuse révolution »[23].
Ajoutons que ROBESPIERRE accorde aux sociétés qu’animèrent ces « nouvelles Aspasies » une place supérieure à l’Académie royale officielle qui refusa la présence des femmes, je cite :
« Oui, n’en déplaise aux génies sublimes dont la première Académie du Royaume se glorifiait sous le règne de Louis XIV, il manquait à sa gloire de compter parmi ses membres les femmes illustres qui embellissaient ce siècle immortel ; et les jours brillants marqués pour les triomphes des Muses françaises ne furent pas l’âge d’or de la littérature [24] ».
La galanterie était, certes, une politique royale qui, au XVIIe siècle et Robespierre le souligne, n’osa vaincre les préjugés refusant aux femmes de reconnaître officiellement leur production littéraire et scientifique [25].
ASPASIE est la femme la plus célèbre du monde grec antique, bien que l’on connaisse peu de choses à son sujet, si ce n’est les sentiments d’amour et de respect sur lesquels on insiste, qu’elle put inspirer à PÉRICLÈS, à quoi l’on ajoute l’influence qu’elle a pu exercer sur lui. Deux historiennes, Marie DELCOURT et Nicole LORAUX, s’accordent à penser que ce qui se dégage du faisceau d’interprétations, largement calomnieuses, léguées par l’Antiquité grecque et romaine au sujet d’Aspasie, c’est bien le scandale que provoqua PÉRICLÈS, parce qu’il portait un attachement amoureux et constant à ASPASIE, cette milésienne instruite et libre, avec qui il vivait, sans pouvoir l’épouser, car les lois d’Athènes le lui interdisaient [26].
ROBESPIERRE a inventé peut-être, sinon poursuivi, une interprétation particulièrement élogieuse d’ASPASIE, qui construit le souvenir de la démocratie galante à venir. Trois moments historiques forment chez lui une constellation nouvelle, pour reprendre la belle métaphore de Walter BENJAMIN : un passé double, avec la démocratie athénienne ou siècle d’Aspasie et la galanterie du XVIIe ou siècle de Mme de RAMBOUILLET brille dans le présent de ROBESPIERRE, qui y voit la lumière des temps à venir. ROBESPIERRE féministe ? Le terme est anachronique [27], on lui préfèrera un galant homme !
François BABEUF correspondant de l’Académie d’Arras en 1787
DUBOIS de FOSSEUX et ROBESPIERRE proposèrent une enquête sur la présence des femmes dans les sociétés savantes, auprès des correspondants de l’Académie d’Arras, qui reçurent le discours de ROBESPIERRE. L’enquête fut menée de mai 1787 à juin 1788. On a retrouvé onze réponses : deux sont favorables et neuf non hostiles, mais réticentes, expression d’une certaine crainte des femmes savantes, non exempte d’admiration. Il existe encore une lettre que BABEUF destinait à DUBOIS de FOSSEUX, mais restée à l’état de brouillon.
Ci-dessous, François-Noël BABEUF, dit Gracchus BABEUF
(1760- 1797)
 François BABEUF, né en 1760, venait d’un milieu très pauvre, mais fut remarqué par le seigneur chez qui sa famille travaillait et qui lui permit de faire des études. Il apprit le droit seigneurial chez un notaire et devint feudiste, spécialiste du droit féodalo-seigneurial, et s’établit à son compte en 1781 à Roye, en Picardie. Il devint correspondant de l’Académie d’Arras en 1785 et reçut ainsi la circulaire de l’Académie, invitant à la discussion sur l’admission des femmes dans les sociétés savantes comme membres ordinaires : il eut envie de jeter ses idées sur le papier [28].
François BABEUF, né en 1760, venait d’un milieu très pauvre, mais fut remarqué par le seigneur chez qui sa famille travaillait et qui lui permit de faire des études. Il apprit le droit seigneurial chez un notaire et devint feudiste, spécialiste du droit féodalo-seigneurial, et s’établit à son compte en 1781 à Roye, en Picardie. Il devint correspondant de l’Académie d’Arras en 1785 et reçut ainsi la circulaire de l’Académie, invitant à la discussion sur l’admission des femmes dans les sociétés savantes comme membres ordinaires : il eut envie de jeter ses idées sur le papier [28].
BABEUF considère que l’éducation « de la femme » lui apprend à obéir aux hommes et non à développer ses facultés. Elle n’a pas accès aux sciences ni aux arts, à rien de réfléchi, seulement à des frivolités. Il affirme l’égalité entre les deux sexes qui partagent les mêmes facultés humaines. Les inégalités n’ont pas une origine naturelle, mais sociale, produite par les différences de fortune et d’éducation qui, précise-t-il, tuent la fraternité entre les humains :
« D’abord, nous sentons que nous sommes tous frères ; mais bientôt au nom de deux inégalités que la nature n’a pas créées, le rang et la fortune, aux nobles, on inspire de la dureté et des airs hautains, aux riches on inculque l’arithmétique des plus vils intérêts. A ceux qui ne sont ni nobles, ni riches, on impose le respect et la soumission ; on laisse à ces derniers leurs peaux d’agneau et l’on jette sur les autres des peaux de loup. Tous sont sevrés du doux miel de la fraternité [29] ».
Il en vient ensuite à la question de l’éducation qui doit être « éclairée » par la critique des préjugés, puis expose la possibilité de développer les facultés propres à chaque sexe, pour leur permettre d’exprimer leur originalité et se libérer de l’imitation :
« La femme ne se fût pas réfugiée dans ces tristes imitations si l’on n’avait pas tué son génie ; il y aurait eu alors une littérature de femme, une poésie de femme, une musique, une peinture, une sculpture de femme ; en regard et à l’égal du génie de l’homme se fût élevé le génie de la femme avec le caractère qui lui est propre et les deux sexes auraient pu s’admirer et se charmer réciproquement. Que de bonheur et de jouissances nous y aurions gagnées ! [30] »
Nous retrouvons ici l’érotisation sociale propre à la mixité galante, accompagnée de sa séduction, de ses plaisirs et de son bonheur.
BABEUF a eu la chance de faire des études. Ne fréquentant ni la cour ni les salons, il n’ignore cependant pas la galanterie et révèle sa capacité à réfléchir par lui-même. Il connaît bien les grands seigneurs de Picardie par son métier de feudiste et critique cette classe dominante « à peau de loup », mais ne rejette pas pour autant la culture galante, car il n’en fait pas la chose de cette classe et a bien saisi qu’il s’agissait d’une politique de civilisation pour les deux sexes, à laquelle il rattache ce qu’il nomme « l’affranchissement de la femme », je cite :
« La vraie civilisation s’arrête et se fixe majestueusement un niveau, là est marqué le terme de toutes les misères, de tous les gémissements, de tous les sanglots (…). Là, seulement, quand tous sont rassurés sur leur sort, là le but de la société est réalisé, puisqu’à moins d’être une ligue hostile aux principes de la justice, elle doit être instituée à cette seule fin que le faible ne soit pas plus malheureux que le fort (…) ; le bonheur des individus, des familles, des peuples, des sexes ne peut être qu’un effet de l’égalisation : l’égalisation perfectionne et ne détruit rien (…). Tôt ou tard, elle détruira la servitude de la femme ; elle fera proclamer son affranchissement. Quelles seraient les conséquences de cet affranchissement, quelles lois nouvelles deviendraient indispensables pour qu’il n’ait que de salutaires effets ? Ce sont là des questions auxquelles je ne suis pas en mesure de répondre, mais il faudra bien y songer quelque jour [31] ».
Ainsi, l’affranchissement de la femme se fera avec l’aide de cette politique de civilisation culturelle telle qu’il la conçoit, la remodèle et, lui aussi, la démocratise en la fondant sur la réciprocité des droits, dans un projet de réformes complémentaires sur les plans économiques et sociaux.
Ainsi, la galanterie n’était pas un domaine réservé aux classes nobles et riches, mais faisait partie d’un projet démocratique comme le proposèrent ROBESPIERRE et BABEUF, qui en expriment le désir et l’urgence.
II
Cultures et pratiques des amours paysannes
 Je m’appuie sur les riches travaux de Jean-Louis FLANDRIN qui, à la recherche de cette longue histoire, a mis en lumière le sujet des « amours paysannes » [32] : la culture amoureuse paysanne.
Je m’appuie sur les riches travaux de Jean-Louis FLANDRIN qui, à la recherche de cette longue histoire, a mis en lumière le sujet des « amours paysannes » [32] : la culture amoureuse paysanne.
Rappelons qu’en 1789, la population française se montait à environ 26 millions : le Tiers-état était formé de 85% par la paysannerie, de 10% d’artisans et d’ouvriers urbains et de 3% des couches supérieures « bourgeoises », les ordres privilégiés de la noblesse et celui du clergé représentaient 2% de la population.
Les « libertés et franchises » venues du Moyen-âge, formaient les institutions des communes villageoises, qui se formaient en assemblées générales des habitants et des habitantes, pour organiser les travaux du système agraire communautaire, suivant un calendrier précis des cultures et des récoltes faites en commun, des droits d’usage collectifs et de la gestion des biens communaux et autres questions concernant la vie du village.
Au XIVe siècle, la royauté rétablit les Etats généraux, qui réunissaient dans un grand conseil les mandataires de toute la société, répartie en trois ordres : noblesse, clergé et Tiers-état. Avec les Etats généraux, le roi avait institué un partage de la souveraineté entre lui et son peuple sur les grandes décisions politiques à prendre : guerre et paix, montant des impôts. C’était le Tiers-état, le plus nombreux et de loin, qui payait les impôts, et le roi avait considéré que son accord lui était indispensable, les ordres privilégiés ayant obtenu d’en payer beaucoup moins.
De 1614 à 1789, pour cause de guerres de religion, la monarchie suspendit les Etats généraux et fut qualifiée, à juste titre, de despotique et de tyrannique, car il supprimait l’exercice de la souveraineté du peuple en matière de guerre et d’impôts. Mais en 1788, Louis XVI fut contraint de convoquer à nouveau les Etats généraux pour la date traditionnelle du 1er mai, en 1789, et fut alors proclamé : « restaurateur de liberté françoise [33] ».
Il faut rappeler que les femmes avaient le droit de vote dans toute la société, fait soigneusement occulté depuis le XIXe siècle, occupé principalement à détruire l’héritage égalitaire en droits entre les deux sexes : comme on le sait, à la fin du XVIIIe siècle, l’échec de la Révolution démocratique connut une succession d’aristocraties des riches et des variantes de monarchie (l’Empire, les Bourbons, les Orléans) dont les femmes et le peuple travailleur étaient exclus des droits politiques depuis 1795 et ensuite. Cette longue occultation visait la démocratie médiévale et les formes populaires, comme aristocratiques, des cultures de galanterie et de celles des amours paysannes.
Commençons par un rappel de la doctrine du mariage selon l’Eglise.
J-L. FLANDRIN a consacré un livre à ce sujet : L’Eglise et le contrôle des naissances, Flammarion, 1970 et rappelle que du IIe siècle après J-C jusqu’à Vatican 2 en 1964, soit 18 siècles, la doctrine de l’Eglise condamnait, tout d’abord, l’attrait amoureux, le plaisir, la pulsion sexuelle comme des péchés ; ensuite l’accouplement dans le mariage était limité à la procréation et enfin, ce qui touchait au plaisir était qualifié de désordres charnels, de fornication et d’adultère : l’Eglise traitait les hommes qui s’y livraient de paillards et les femmes de putains. C’est en ces termes qu’elle condamna l’amour courtois des chevaliers et des dames, parce qu’ils se livraient aux désordres charnels et qu’ils avaient, de plus, des pratiques contraceptives. Certes, la doctrine de l’Eglise existait, mais d’autres références également, et les populations adaptèrent leur propre culture amoureuse à leurs conceptions des relations entre les sexes [34].
Ainsi, les pratiques sociales attestent que, depuis le XVe siècle où l’on dispose de sources, en Europe occidentale, les mariages sont de plus en plus tardifs, passant de 20 à 25 ans : ce qui diffère du dogme de l’Eglise, qui autorisait le mariage très jeune et sans autorisation des parents, à 11 ans pour les filles, 13 pour les garçons, parce qu’elle y voyait un remède pour éviter la fornication : comprenne qui pourra…
Mariage et capacité à s’établir étaient liés à ces mariages tardifs et on note qu’en ville, les garçons célibataires, apprentis ou salariés, ne pouvaient y atteindre : c’est dans les villes que ces jeunes gens pratiquaient des viols collectifs visant des femmes pauvres, considérées comme des filles communes à tous et que des bordels se développèrent.
Par contre, dans les campagnes, la liberté de fréquentation des jeunes des deux sexes, sans perte de l’honneur des filles, était reconnue, avec des pratiques non fécondantes : caresses et attouchements de plaisir, mais pas de coït pour protéger les jeunes filles : l’absence de grossesses démontre la connaissance de ces pratiques.
Ensuite, viennent les fiançailles et le mariage à l’essai, attestés de façon courante. Ces fréquentations peuvent durer plusieurs années et se pratiquent aux champs ou chez les parents de la jeune fille, lors des veillées ou du mariage à l’essai. L’amour et la liberté sexuelle existaient bien dans les campagnes et s’exprimaient dans les fréquentations paysannes avant le mariage, comme gestuel d’amour, pratiques d’attente, essais d’accord sexuel et de solidarités villageoises. Enfin, la contraception dans le mariage est attestée : la famille conjugale était la forme dominante et révèle une moyenne de 3 enfants [35].
Rappelons que ces pratiques paysannes subirent la répression de la contre-réforme catholique, préparée par le Concile de Trente en 1565, et qui s’exerça tout au long du XVIIe siècle, mais rencontra une forte résistance paysanne, malgré la situation économique marquée par le morcellement des terres paysannes, la baisse des salaires au XVIe siècle et la prolétarisation, conduisant de jeunes paysans sans terre à migrer dans les villes.
Cette répression religieuse fut freinée au XVIIe siècle, y compris par les acquits juridiques qui, depuis le XVIe siècle, dégageaient la femme de la tutelle maritale, en reconnaissant la séparation de corps accordée à la femme et même le divorce en cas de violences du mari sur sa femme. Dès le début du XVIIIe siècle, la répression de l’Eglise recula [36].
Comme je l’ai précisé, la galanterie s’est déployée aux XVIIè et XVIIIè siècles, et je reviens pour conclure sur :
ROBESPIERRE défenseur des droits politiques des deux sexes pendant la Révolution, 1789-1794
Voyons maintenant ce que cette proposition de Robespierre d’une politique de galanterie, dans une perspective démocratique, est devenue pendant la Révolution. L’étude sera limitée ici à sa défense du droit de vote des deux sexes.
Le « droit de franchise », qui désigne le droit de voter, depuis le Moyen-âge, réapparut donc avec la Convocation des Etats généraux le 1er mai 1789. Les assemblées électorales prirent la forme traditionnelle d’assemblées générales des commune villageoises et des sections de communes urbaines, avec un système à deux niveaux : ces assemblées primaires communales choisissaient leurs mandataires, qui, à leur tour, se réunissaient au niveau des bailliages de provinces pour choisir, parmi eux, les députés aux Etats généraux. N’oublions pas que dans l’ordre de la noblesse, les femmes avaient aussi le droit de choisir leurs mandataires pour défendre leurs titres et leurs fortunes. Ainsi, l’ensemble de la société choisissait des mandataires responsables et révocables devant leurs mandants et mandantes, chargés d’un mandat sous la forme des cahiers de doléances [37]. Le maintien de ces assemblées primaires issues des Etats généraux a représenté, pendant la Révolution, un double enjeu démocratique : l’exercice d’un droit de vote universel incluant donc les femmes et le peuple.
ROBESPIERRE participa à la réunion des Etats généraux en Artois, et prit une défense énergique de ces pratiques populaires, qu’il désignait par les termes de « cause du peuple, souveraineté du peuple, droits du peuple » et qui impliquaient le droit de vote des deux sexes.
On commence à mieux saisir que les assemblées primaires des deux sexes, réunies de « façon traditionnelle » signifie « de façon démocratique réelle ».
La Grande Peur de juillet 1789 fut une immense jacquerie paysanne qui commença de prendre le pouvoir local et de créer les gardes communales en armant leurs citoyens pour se défendre. Les paysans exposaient leur programme de destruction de la féodalité, en se rendant aux châteaux pour y brûler les titres de propriété des seigneurs, exprimant leur refus de payer droits et rentes [38]. Ce fut aussi la forme du mouvement populaire dans les villes qui prit le pouvoir local et créa leurs gardes communales.
C’est alors que les possédants prirent conscience de l’irruption du mouvement paysan sur la scène de l’histoire et durent lui faire quelques concessions lors de la Nuit du 4 août, en votant le décret supprimant le régime féodal : « L’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal », mais sans décret d’application… repoussé à plus tard, puis en votant, le 26 août, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette situation contradictoire créa la division de l’Assemblée en un « côté gauche » et « un côté droit », le premier s’engageant à défendre les principes déclarés, le second cherchant en sens inverse à les renverser.
Dès 1789, des députés du « côté droit » voulurent faire taire les assemblées primaires communales. La meilleure façon de les abattre était de supprimer le système électoral des Etats généraux et ce fut l’œuvre du « côté droit » de l’Assemblée nationale constituante qui, de 1789 à septembre 1791, vota peu à peu les éléments de ce qui devint la Constitution de 1791. Le « côté gauche » s’y opposa vigoureusement, mais restait encore minoritaire.
La Constitution de 1791 n’hésita pas à violer les principes déclarés de la souveraineté populaire et de l’égalité en droits, en imposant un droit de vote masculin et un cens électoral excluant le peuple et toutes les femmes, même riches, et instaurait une « aristocratie des mâles riches » qui fut appliquée en octobre 1791 avec les élections censitaires de l’Assemblée Législative.
Les assemblées primaires communales devaient disparaître avec ce système censitaire, mais ce ne fut pas le cas : le mouvement populaire se poursuivit sous la forme de cinq nouvelles jacqueries, soit deux par an jusqu’au printemps 1793 et continuèrent la prise de pouvoir local et la création de gardes communales citoyennes armées, en dépit des lois, car c’était cela aussi la révolution. Bien sûr, elles ne participaient plus légalement aux élections, mais appliquaient légitimement le principe de la souveraineté populaire de la Déclaration des droits. En dépit de la politique de Loi martiale contre toutes les formes du mouvement populaire, mais l’Assemblée n’eut pas les moyens de les réprimer, à cause des gardes communales.
Ci-dessous, une séance de la Convention nationale (21 septembre 1792 jusqu’au 26 octobre 1795)
 L’Assemblée législative fut renversée par la Révolution du 10 août 1792 qui supprima la monarchie en France, institua la République et la souveraineté populaire et convoqua une nouvelle assemblée constituante, la Convention. Celle-ci fut d’abord gouvernée par les Brissotins-Girondins de septembre à mai 1793. Ce gouvernement parvint à éluder le vote de la Constitution jusqu’à la Révolution des 31 mai-2 juin 1793, qui fut remarquable par la simple révocation des mandataires infidèles, soit 30 députés et 2 ministres Brissotins, qui furent assignés à résidence, expression claire de la conception démocratique traditionnelle de la responsabilité des mandataires par leurs mandants [39].
L’Assemblée législative fut renversée par la Révolution du 10 août 1792 qui supprima la monarchie en France, institua la République et la souveraineté populaire et convoqua une nouvelle assemblée constituante, la Convention. Celle-ci fut d’abord gouvernée par les Brissotins-Girondins de septembre à mai 1793. Ce gouvernement parvint à éluder le vote de la Constitution jusqu’à la Révolution des 31 mai-2 juin 1793, qui fut remarquable par la simple révocation des mandataires infidèles, soit 30 députés et 2 ministres Brissotins, qui furent assignés à résidence, expression claire de la conception démocratique traditionnelle de la responsabilité des mandataires par leurs mandants [39].
La Convention montagnarde qui lui succéda, commença par donner une constitution. ROBESPIERRE et SAINT-JUST présentèrent, le premier un Projet de déclaration des droits, le second de constitution, qui ensemble rétablissaient légalement les assemblées primaires et leur système électoral, conformément aux principes de la Déclaration des droits de 1789.
ROBESPIERRE y prenait la défense de l’indépendance des assemblées primaires dans son Projet de déclaration des droits, je cite :
« Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible est vicieuse […] Chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté : elle est essentiellement indépendante de toutes les autorités constituées et maîtresse de régler sa police et ses délibérations. »
 Et dans son important discours du 10 mai 1793 à la Convention, ROBESPIERRE (image ci-contre) précisait, je cite :
Et dans son important discours du 10 mai 1793 à la Convention, ROBESPIERRE (image ci-contre) précisait, je cite :
« Respectez surtout la liberté du peuple souverain dans les assemblées primaires. Par exemple, en supprimant ce code énorme qui entrave et anéantit le droit de voter, sous le prétexte de le régler, vous ôterez des armes infiniment dangereuses à l’intrigue et au despotisme des directoires ou des législatures […] Au surplus, que le peuple, je le répète, soit parfaitement libre dans ses assemblées : la constitution ne peut établir que les règles générales nécessaires pour bannir l’intrigue et maintenir la liberté même : toute autre gêne n’est qu’un attentat à sa souveraineté. Qu’aucune autorité constituée surtout ne se mêle jamais ni de sa police, ni de ses délibérations [40]. »
ROBESPIERRE proposait ainsi que les assemblées primaires communales soient souveraines dans leur organisation et continuent de se réunir, comme elles en avaient l’habitude depuis des siècles.
La Convention montagnarde discuta de la nouvelle constitution et la vota le 24 juin 1793 : le système électoral communal « traditionnel » était rétabli. La Convention avait voté l’abolition de la Loi martiale visant la répression par l’armée des mouvements populaires et les grèves des ouvriers (les plus nombreux à l’époque étaient les ouvriers agricoles et ceux des manufactures rurales) dès le 23 juin 93. Elle vota les décrets d’application de la réforme agraire, répondant enfin aux jacqueries qui rythmèrent le cours de la Révolution, en libérant les terres travaillées par les paysans de toute rente et droits féodalo-seigneuriaux, en supprimant l’institution de la seigneurie, en récupérant les biens communaux usurpés par les seigneurs depuis 1669, soit plus d’un siècle : la propriété et la gestion des biens communaux fut enfin reconnue aux communes rurales et urbaines.
Cette reconquête des communaux dans les campagnes permit de récupérer des pâturages et d’accroître l’élevage et la production, car ne l’oublions pas, c’était l’élevage qui fournissait la totalité des engrais pour les cultures. Enfin, la Montagne mit en place la politique du Maximum des prix dans le but de rééquilibrer les prix et les salaires, contre la politique de « libéralisation » des prix des denrées de première nécessité, qui permettait de hausser les prix en détruisant tous les contrôles des marchés publics, ce qui créait de véritables famines. Dès 1789, les jacqueries avaient dénoncé cette politique et inventé les réponses à ce fléau mortel, en contrôlant les marchés publics communaux contre les marchés privés [41].
La Révolution avait reconnu le 20 septembre 1792, l’état civil communal qui remplaçait celui des curés jusque-là, et le divorce facilité par le consentement mutuel. La Montagne ajouta à cette égalité des droits civils et politiques, le partage des héritages entre les enfants des deux sexes, y compris avec les enfants naturels reconnus, le 26 octobre 1793.
La Contre-révolution thermidorienne
Le 9 thermidor-27 juillet 1794 mit fin à la Convention montagnarde. Pour la première fois depuis 1789, l’armée entrait dans Paris et réprimait le mouvement populaire. La Constitution de 1793 fut renversée par les Thermidoriens, après avoir supprimé les gardes communales, les sociétés populaires et le fonctionnement démocratique des communes.
Le moyen politique des Thermidoriens fut de se lancer dans une guerre de conquête et en décembre 1794, la Rhénanie était occupée. La nouvelle Constitution de 1795 qui instaura le Directoire, instituait à nouveau une « aristocratie des mâles riches » en rétablissant un cens électoral et en éliminant toutes les femmes, même riches, et la Déclaration des droits naturels disparut de la Constitution et fut remplacée par une déclaration des droits des mâles riches en société.
Le Directoire poursuivit la guerre de conquête et de pillage en Europe, mais fut arrêté par le coup d’état de Bonaparte, le 9 novembre 1799, qui prit le pouvoir, restaura la monarchie en France en établissant l’Empire, et poursuivit la guerre de conquête et de pillage des pays voisins. Napoléon reprit la politique de répression des amours paysannes et de la galanterie : en 1804, son code civil mit les femmes en tutelle de leur père et de leur mari et imposa aux femmes mariées une incapacité juridique totale. Les enfants appartiennent au père et le divorce est interdit aux femmes. Le libéralisme bourgeois du XIXe siècle prolonge cette mutation décisive.
Ci-dessous, la Nouvelle Danaë, 1799, par GIRODET,
après Aspasie (ci-dessus), une autre représentation de la femme dans l’espace public

Le Journal des Arts commentait ce tableau de Anne-Louis GIRODET exposé au salon de 1799 :
« … une allégorie représentant Danaë, coiffée avec des plumes de paon, tenant dans ses mains le miroir de la Vanité et recevant avec complaisance les pièces d’or qui tombent d’une draperie que soutient devant elle un jeune Amour […] Sur le châlit ignoble où Danaë est assise, on voit une colombe ayant au col l’exergue fidelitas, à qui une pièce d’or a brisé les ailes, elle est ensanglantée. Sous le châlit paraît un satyre, les yeux bouchés par les ducats et derrière, une lampe où des papillons volages vont se détruire. Sur le côté gauche, le peintre a représenté un dindon avec une queue de paon qui fait la roue, porte des bagues à ses pattes ou griffes et regarde avec lubricité Danaë nue [43]. »
GIRODET livre ici un réquisitoire implacable contre le choix d’une politique de corruption et de débauche sous le Directoire. On notera qu’à la différence de l’Aspasie de Bouliar qui se regarde dans son miroir, Danaë ne le peut plus.
Note F.G : Reproduction d’une huile sur toile, 65 x 54. The Minneapolis Institute of arts. Voir Philippe BORDES et Régis MICHEL (ed), Aux armes et aux arts ! Les Arts de la Révolution, 1789-1799, Paris, Adam Biro, 1988, p 94 et n 43.
La Restauration des Bourbons remplaça l’Empire en 1814, puis celle des Orléans, suivie d’un Second Empire. En 1875, la Troisième République établissait un suffrage universel masculin et continuait d’exclure les femmes des droits civils et politiques et cela jusqu’en… 1946, soit près d’un siècle et demi. En 1946, après une guerre effroyable contre nazisme et fascismes, le suffrage universel des deux sexes et la Déclaration des droits naturels de 1789 furent rétablis, ensemble, dans le droit constitutionnel français, réhabilitant de fait ce double et précieux héritage médiéval.
Pour conclure, on ne rencontre pas, chez ROBESPIERRE, cette hostilité au sexe féminin qui lui est attribuée de façon récente, bien au contraire. Homme des Lumières, démocrate et défenseur des droits naturels du peuple, il a combattu en faveur de l’admission pleine et entière des femmes dans les sociétés savantes, participant à la production du savoir, tout comme celle du peuple participant à la société politique, en exerçant sa souveraineté pleine et entière.
Comment a-t-on pu lui attribuer un tel comportement ? Il semblerait que l’assimilation de ROBESPIERRE à ROUSSEAU ait pu induire ce qui n’est alors qu’un préjugé. Pour ma part, j’ai montré de façon détaillée que la formation intellectuelle de ROBESPIERRE en philosophie politique, était très éloignée de celle que ROUSSEAU avait exprimée dans Le Contrat social, en particulier [42]. En effet, à la différence de ROUSSEAU qui rejette toute déclaration des droits, ROBESPIERRE avait été un politique, grand connaisseur de ce courant du droit naturel médiéval et moderne, et révéla, pendant la Révolution, sa capacité à le développer. On voit sur la question des relations entre les deux sexes et de leur place dans la société politique, un écart très net entre les deux hommes.
Enfin, si la position de ROBESPIERRE sur la place des femmes dans l’espace public a pu être éclaircie, reste le problème suivant : quel est ce « monstre » qui voulait les en écarter si ce n’est pas « la faute à Robespierre », mais que « monstre », il y a bien eu ? Nous l’avons vu pointer « ses oreilles de loup » à différentes reprises. C’est bien de la horde des ennemis de la souveraineté du peuple dont il s’agit et qui, pour y parvenir, s’emploie à opposer les gens les uns contre les autres, en utilisant tous les prétextes possibles, que ce soit la culture, le sexe, la religion, les classes d’âge, la couleur de l’épiderme etc…
Florence GAUTHIER, universitaire,
Historienne des Révolutions de France et de St-Domingue/Haïti
Paris, 30 juillet 2025
NOTES
[1] Dans l’Antiquité, l’île de Cythère, située dans les îles grecques de la mer Égée, abritait un temple dédié à Aphrodite, déesse de l’amour : ses eaux auraient vu naître la déesse. L’île représente donc le symbole des plaisirs amoureux.
[2] Sur le legs thermidorien voir Marc DELEPLACE, L’Anarchie, de Mably à Proudhon, 1750-1850. Histoire d’une appropriation polémique, Lyon, ENS éditions, 2000 ; sur ROBESPIERRE pontife voir Alphonse AULARD, Histoire politique de la Révolution française, Paris, 1901, chap. IX, 4, p 487-93, qui fait de Robespierre, et contre l’évidence, un adepte de la religion civile selon Rousseau, et la mise au point d’Albert MATHIEZ, « ROBESPIERRE et le culte de l’Être suprême », (1910) Études sur Robespierre, Paris, Éd. Sociales, 1973 ; aux sources de la version stalinienne voir Tamara KONDRATIEVA, Bolcheviks et Jacobins, Paris, Payot, 1989, chap 9 ; enfin, François FURET reprit la thèse de la matrice des totalitarismes du XXe siècle dans son Penser la Révolution française, Paris, 1978, qui s’est imposée depuis le bicentenaire de 1989.
[3] Voir Joan W. SCOTT, La Citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, (1996) Paris, Albin Michel, 1998, qui fait elle aussi de Robespierre, et contre toute raison sensible, un adepte de la misogynie propre à Rousseau. Sur l’histoire des femmes, voir la très riche mise au point de Lynn HUNT, « L’histoire des femmes : accomplissements et ouvertures », in Martine LAPIED, Christine PEYRARD (dir.), La Révolution française au carrefour des recherches, Aix-en-Provence, PUP, 2003, pp. 281-292. Sur le mythe Robespierre voir Marc BELISSA, Yannick BOSC, Robespierre. La fabrication du mythe, Paris, Ellipses, 2013.
[4] Sur la famille KÉRALIO, voir Jean SGARD, « Louis Félix, Guynement de KÉRALIO, traducteur, académicien, journaliste, intermédiaire » ; Elisabeth BADINTER, « Auguste de KÉRALIO : un auxiliaire invisible de la république des sciences » ; Annie GEFFROY, « Les cinq frères KÉRALIO », Dix-huitième siècle, 2008. Je corrige ainsi la confusion que j’ai faite entre Auguste et Louis, dans ROBESPIERRE, Œuvres, t. XI, Paris, 2007, p.189, n 4 : Louis est le père de Louise et non Auguste.
[5] ROBESPIERRE, Œuvres, Paris, t XI, « Réponse de Robespierre au discours de Melle de Kéralio, p 189-201, et Correspondance entre Dubois de Fosseux et Robespierre, p 129-135.
[6] François POULAIN DE LA BARRE, De l’égalité des deux sexes, (1673) Paris, Fayard, 1984.
[7] ROBESPIERRE, ibid, p 194.
[8] Id, ibid, p 197.
[9] Claude HABIB, Galanterie française, Paris, Gallimard, 2006, chap III, 2, Le projet précieux, p 171. Melle de Scudéry évoque le plaisir propre à la mixité des sexes p 271 : « Il y a je ne sais quoi, que je ne sais comment exprimer […] qui fait qu’un honnête homme réjouit et divertit plus une compagnie de dames que la plus aimable femme de la terre ne saurait faire ». Le propos de Robespierre fait l’exact pendant, du point de vue masculin : « Ouvrez aux femmes l’entrée des Académies […] et vous verrez se rallumer le feu d’une utile émulation et ce commerce enchanteur de l’esprit et de la pensée reprendra toute l’activité dont il est susceptible en acquérant des agréments jusqu’alors inconnus », op. cit, p 194.
[10] Voir les travaux littéraires et musicaux de Philippe BEAUSSANT et en particulier Vous avez dit baroque ? Musiques du passé, pratiques d’aujourd’hui, Arles, Babel, (1988), 1994.
[11] Q. SKINNER, La liberté avant le libéralisme, (Cambridge 1988) trad. Seuil, 2000 ; P. LASLETT, Un monde que nous avons perdu. Les structures sociales pré-industrielles, trad. de l’anglais, Paris, Flammarion, 1969.
[12] C. HABIB, Galanterie française, op. cit, chap. 3, L’âge galant : instauration, signification ; ROBESPIERRE, op. cit, p 197.
[13] C. HABIB, op. cit, p 247 et s.
[14] Ibid, chap. 4. La liberté des femmes, p 235.
[15] HABIB, Ibid, « Le sens du mot », p 147.
[16] Selon l’expression de Dominique GODINEAU, Les femmes dans la société française, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Colin, 2003, p 139.
[17] HABIB, ibid, p 184.
[18] La BRUYÈRE, Les caractères, De la Société, 1688.
[19] SADE, Philosophie dans le boudoir, 1795, 5e dialogue.
[20 CHODERLOS de LACLOS, Les Liaisons dangereuses, 1782.
[21] ROBESPIERRE, Réponse…, op. cit, p 195 et 199 pour les citations. On notera que Robespierre désigne ces écrivains des deux sexes de la même manière, par leur nom de famille : RAMBOUILLET, MOLIÈRE, La SUZE, BOSSUET, etc… Sur l’âge d’or de ces sociétés où ces femmes couronnaient les talents voir HABIB, ibid, op. cit, chap. III et IV.
[22] Catherine de VIVONNE-SAVELLA, marquise de RAMBOUILLET (1588-1655) vit sa société qualifiée « d’Académie ou Parnasse français » ; Antoinette DESHOULIÈRES (1637-1694), roturière, animait une société comme poétesse ; Henriette de COLIGNY comtesse de La SUZE (1618-1673) poétesse ; Marie de RABUTIN-CHANTAL marquise de SÉVIGNÉ (1626-1696) exprima dans sa correspondance sa gaieté galante et son esprit précieux ; Marie-Madeleine PIOCHE de la VERGNE comtesse de La FAYETTE (1643-1693) amie de la précédente et auteure de romans. Voir A. ADAM, Histoire de la littérature française au XVIIe s, Paris, (1948) 1997 ; A. VIALA, Les institutions de la vie littéraire en France au XVIIe s, Lille, 1985.
[23] ROBESPIERRE, ibid, p 198. Y a-t-il eu, avant ROBESPIERRE, un tel rapprochement entre les Précieuses et Aspasie ? Je l’ignore. Une recherche mérite d’être poursuivie à ce sujet.
[24] Id., ibid, p 195.
[25] On sait que Madeleine de SCUDÉRY, faillit entrer à l’Académie française, voir M. et Georges de SCUDÉRY, Artamène ou le Grand Cyrus, (1649) Paris, GF, 2005, textes choisis, Présentation, p 9.
[26] M. DELCOURT, Périclès, Paris, 1939 ; N. LORAUX, « Aspasie, l’étrangère, l’intellectuelle », Clio, 2001, n° 13, p 17-42. Dans le Ménexène, Platon dresse un portrait à charge contre Aspasie, femme savante : elle ferait donc l’homme, mais Socrate la suspecte de plagier Périclès, la renvoyant à son infériorité naturelle. Comme on le sait, cette critique de la femme-qui-veut-faire-l’homme a été formulée par les adversaires des femmes et de la démocratie athénienne, depuis… Aspasie. Il est pour le moins surprenant de retrouver ce thème sous la plume de « féministes » déclarées comme J. SCOTT qui, à propos d’Olympe de Gouges, reproduit cette antienne que l’on espérait, en tous cas de ce côté-là, périmée ! Voir Platon, « Ménexène », Œuvres, La Pléiade, 1, p 493 ; J.W. SCOTT, La citoyenne paradoxale, op. cit, p 83. Sur O. de Gouges, voir Fl. GAUTHIER, « O. de Gouges, histoire ou mystification ? », in Cahiers internationaux de Symbolisme, Bruxelles, 2016.
[27] Voir F. ROCHEFORT, « Du droit des femmes au féminisme en Europe, 1860-1914 », in Christine FAURE, éd, Encyclopédie historique et politique des femmes, Paris, PUF, p 552.
[28] Voir V. DALINE, A. SAÏTTA, A. SOBOUL, Œuvres de Babeuf, Paris, 1977, Daline y publia un carnet de correspondance de Babeuf conservé à l’Institut du Marxisme-léninisme de Moscou, p 80-118. Ce document n’est pas l’original mais une copie d’Advielle, au XIXe siècle, et datée par Daline « après le 1er juin 1786 ». Il est possible de dater plus précisément la copie d’Advielle car Babeuf mentionne les noms de deux membres honoraires reçues en avril 1787, retranscrits ainsi par Daline : « Mme Le Masson de Goltz et Melle de Mérlan ». Nous savons d’une part qu’il s’agit de Le Masson Le Golft, et il ne fait guère de doute que Mérlan soit une déformation de Kéralio : ce passage a été rédigé par Babeuf après réception du compte-rendu de la séance du 18 avril 1787, envoyé par Dubois de Fosseux aux correspondants de l’Académie d’Arras, et sa réponse date de 1787 et non de 1786.
[29] Correspondance de BABEUF, ibid, p 96.
[30] Ibid, p 100.
[31] Ibid, p 102.
[32]J -L. FLANDRIN, L’Eglise et le contrôle des naissances, Paris, Flammarion, 1970 ; Les Amours paysannes, Paris, Gallimard, Archives, 1975 ; Familles, parenté, maison, sexualité, XVIe-XIXe siècles, Paris, Hachette, 1976 ; Le Sexe et l’Occident, Paris, Seuil, 1981 ; Un temps pour embrasser. Aux origines de la morale sexuelle occidentale, VIe-XIe siècles, Paris, Seuil, 1983.
[33] Voir Jean EGRET, La Pré-Révolution française, 1787-88, Paris, PUF, 1962.
[34] J-L. FLANDRIN, Le Sexe…, op. cit, p 101, 110.
[35] Id, Les Amours paysannes, op. cit. et Le Sexe…, op. cit, p 279-302.
[36] Id., Le Sexe et l’Occident…, op. cit, p. 124.
[37] Christine FAURE, « Doléances, déclarations et pétitions, trois formes de la parole des femmes sous la Révolution », Annales Historiques de la Révolution Française, n° 344, 2006, p 5-25.
[38] Georges LEFEBVRE, La Grande Peur de juillet 1789, Paris, Colin, 1932 ; Anatoli ADO, Paysans en révolution, 1789-1794, (1971) trad. du russe Paris, Société des Etudes Robespierristes, 1996.
[39] Albert SOBOUL, Les Sans-culottes, Paris, Seuil, 1968.
[40] ROBESPIERRE, « Projet de déclaration des droits de l’homme et du citoyen », le 24 avril 1793 et « Sur la constitution », le 10 mai 1793, les deux à la Convention, in ROBESPIERRE, Pour le bonheur et pour la liberté, Paris, La Fabrique, 2004, Textes choisis, p 236 et 249.
[41] Sur la suppression de la seigneurie féodale, A. ADO, Les Paysans…, op.cit ; sur la politique du Maximum, Fl. GAUTHIER, Triomphe et mort…,op.cit, II, chap. 1 à 3.
[42] Fl. GAUTHIER, Triomphe et mort…, op. cit, sur Rousseau I, chap. 2, p 33-40 ; II, p 73-137.