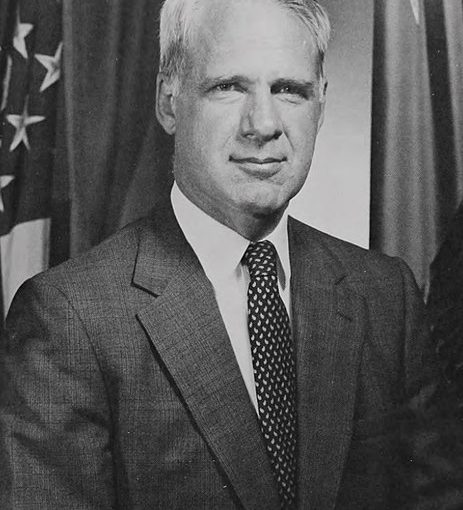22 septembre 1792, 24 février 1848, 4 septembre 1870 : La République, toujours un combat, celui du peuple souverain !
par Louis SAISI
 Nous avons été, pour la énième fois, le 22 septembre 2020, conviés à nous souvenir de la naissance de la République, voire à la fêter.
Nous avons été, pour la énième fois, le 22 septembre 2020, conviés à nous souvenir de la naissance de la République, voire à la fêter.
Aujourd’hui, notre Constitution, dans son article premier, identifie la France à une « République indivisible, laïque, démocratique et sociale » et, dans son article 2, en donne les caractéristiques (langue, drapeau, hymne national), la devise (assise sur le triptyque Liberté, Égalité, Fraternité) et son principe (« gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »).
Mais si l’article 1er de la Constitution parle de la France et son article 2 de la République, son article 3 lie enfin cette République au peuple seul détenteur de la souveraineté qu’il exerce soit par ses représentants, élus au suffrage universel, soit directement par la voie du référendum.

C’est dire le lien étroit entre la République, le suffrage universel, et les élections de représentants permettant le fonctionnement du gouvernement représentatif.
Or, depuis plusieurs décennies, la forte abstention récurrente à l’occasion des scrutins électoraux altère les conditions de représentation des élus et grippe le fonctionnement du modèle républicain.
 C’est ainsi que le taux d’abstentions à nouveau élevé, lors des dernières élections municipales des 15 mars 2020 – 28 juin 2020 [1], a exprimé, une fois encore, un signe alarmant de l’état de notre République quand on sait combien a toujours été fort l’attachement de nos concitoyens à la vie locale et à l’élection des conseils municipaux et indirectement, ensuite, des maires(voir sur ce site notre analyse de ces élections).
C’est ainsi que le taux d’abstentions à nouveau élevé, lors des dernières élections municipales des 15 mars 2020 – 28 juin 2020 [1], a exprimé, une fois encore, un signe alarmant de l’état de notre République quand on sait combien a toujours été fort l’attachement de nos concitoyens à la vie locale et à l’élection des conseils municipaux et indirectement, ensuite, des maires(voir sur ce site notre analyse de ces élections).
A leur tour, les élections législatives partielles du dimanche 20 septembre 2020 confortent la forte abstention des dernières « municipales ».
En effet, conséquences des « municipales » et de la nomination de certains membres du gouvernement en juillet dernier, le dimanche 20 septembre s’est déroulé le premier tour de six élections législatives partielles.
Ci-dessous, élection législative partielle à La Réunion
le 20 septembre 2020
 A l’issue du 1er tour, les résultats définitifs de cinq d’entre elles montrent une abstention massive atteignant 80 % des électeurs inscrits. C’est ainsi que, l’abstention dépasse 79 % dans la 1re circonscription du Haut-Rhin, 82 % dans la 5e de Seine-Maritime et dans la 3e de Maine-et-Loire, 84 % dans la 1re de La Réunion, et atteint même 87 % dans la 9e circonscription du Val-de-Marne.
A l’issue du 1er tour, les résultats définitifs de cinq d’entre elles montrent une abstention massive atteignant 80 % des électeurs inscrits. C’est ainsi que, l’abstention dépasse 79 % dans la 1re circonscription du Haut-Rhin, 82 % dans la 5e de Seine-Maritime et dans la 3e de Maine-et-Loire, 84 % dans la 1re de La Réunion, et atteint même 87 % dans la 9e circonscription du Val-de-Marne.
Quant à la 11ème circonscription des Yvelines, dimanche à 20 heures, la préfecture des Yvelines – qui ne devait communiquer les résultats définitifs que le lundi 21 septembre – chiffrait la participation électorale à 19,69 % : une participation unanimement reconnue comme très faible rejoignant celle, également très faible, relevée dans les 5 autres circonscriptions législatives précitées.
Ainsi près de quatre électeurs sur cinq ne se sont pas rendus aux urnes ce dimanche dans les six circonscriptions concernées par ce premier tour. Tout se passe comme si le vote des citoyens devenait une session politique à huis clos ou le privilège d’un club d’initiés.
Cette désertion des urnes pour la désignation de leurs représentants par les citoyens français n’est pas un signe de vitalité de notre République. Elle traduit, au contraire, la distance des Français par rapport aux institutions de la République qui n’est pas sans nous rappeler le sondage IFOP exclusif qui avait été réalisé en mai 2015 pour ATLANTICO. Ce sondage révélait que 65 % des Français n’étaient plus « touchés » par le terme « République » ni l’expression « valeurs de la République » dans les discours politiques.
Or, à l’époque, cela pouvait apparaître d’autant plus paradoxal et surprenant que ces dernières années la République et ses valeurs n’avaient jamais été autant invoquées par les hommes politiques de tous bords.
Ainsi Manuel VALLS, dans un style martial de proconsul romain, en avait fait sa marque de fabrique, d’abord quand il était place Beauvau (2012-2014), ensuite lorsqu’il devint Premier ministre (2014-2016), une première fois (31 mars au 25 août 2014), puis une seconde fois (25 août 2014 au 6 décembre 2016). En 2015, Nicolas SARKOZY, qui cherchait un nouveau nom de baptême pour ripoliner son vieux parti conservateur, n’avait pas hésité jusqu’à aller proposer que son parti – qui s’inscrivait dans la continuité des anciens partis dominants conservateurs UNR, UDR et RPR, UMP qui l’avaient précédé – s’appelle « Les Républicains »…
Un peu plus tard, le 6 avril 2016, à Amiens, Emmanuel MACRON créa « La République en marche » (abrégée en LREM ou LaREM, parfois REM, voire LRM) — également appelée dans sa première dénomination « En marche » (EM) – qui devait le porter à la présidence de la République le 7 mai 2017.
Pourtant, un an avant, le même Emmanuel MACRON, alors Ministre de François HOLLANDE, avait déclaré le 8 juillet 2015, dans le journal hebdomadaire « Le 1 » :
« La démocratie comporte toujours une forme d’incomplétude car elle ne se suffit pas à elle-même. […] Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n’a pas voulu la mort. La Terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif : le roi n’est plus là ! On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d’y placer d’autres figures : ce sont les moments napoléonien et gaulliste, notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l’espace. On le voit bien avec l’interrogation permanente sur la figure présidentielle, qui vaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. Pourtant, ce qu’on attend du président de la République, c’est qu’il occupe cette fonction. Tout s’est construit sur ce malentendu. »
Et après sa déclaration de candidature du 16 novembre 2016 – faite lors d’une visite dans un centre de formation à Bobigny, en Seine-Saint-Denis -, de retour vers Paris, le premier geste symbolique du candidat MACRON fut de s’offrir une halte à la Basilique de Saint-Denis, tombeau des Rois de France…
L’on discerne ici toute l’ambiguïté, non seulement de l’homme politique MACRON, mais surtout, plus intéressante et moins contingente, de la fonction présidentielle dans les institutions de la 5ème République qui, d’essence plus monarchique que républicaine, est devenue prédominante dans notre système politique, pourtant en principe réputé républicain.
Ainsi les termes « République », « République en Marche » ou « Les Républicains » – soit qu’ils aient été souvent invoqués de manière incantatoire par certains hommes politiques soit qu’ils aient fait l’objet d’une appropriation privée par certains partis politiques – dissimulent mal l’attachement de ces partis et hommes politiques à des institutions fondamentalement autoritaires d’essence monarchique et à des pratiques politiques bien éloignées de l’idéal républicain.
 C’est dire que l’abstention électorale chronique comme le désenchantement des Français pour la République – constaté en 2015 – expriment leur lassitude pour certaines postures convenues démenties par la pratique politique, et montrent à la fois l’usure d’une certaine langue de la politique et l’éloignement, voire la méfiance, d’une partie des citoyens vis-à-vis des formes courantes de la vie politique et implicitement du libéralisme politique et économique qui a capté la République mais surtout l’a rendue captive de la pensée économique dominante actuelle qui, si elle est certes évolutive, maintient toujours ses principes essentiels qui sont même devenus la doxa de la construction de la CEE puis de l’Union européenne.
C’est dire que l’abstention électorale chronique comme le désenchantement des Français pour la République – constaté en 2015 – expriment leur lassitude pour certaines postures convenues démenties par la pratique politique, et montrent à la fois l’usure d’une certaine langue de la politique et l’éloignement, voire la méfiance, d’une partie des citoyens vis-à-vis des formes courantes de la vie politique et implicitement du libéralisme politique et économique qui a capté la République mais surtout l’a rendue captive de la pensée économique dominante actuelle qui, si elle est certes évolutive, maintient toujours ses principes essentiels qui sont même devenus la doxa de la construction de la CEE puis de l’Union européenne.
La République n’est pas seulement une heureuse idée empruntée à l’Antiquité provenant du latin « res publica » qui signifie, au sens propre, la « chose publique » et désigne l’intérêt général, elle caractérise aussi une forme de gouvernement collégial s’opposant à la dictature d’un seul ou au pouvoir souverain d’un Roi héréditaire.
En effet, comme le disait Jean JAURES, le 21 novembre 1893, dans son célèbre discours à la Chambre, la République fait de tous les citoyens une « assemblée de rois », et c’est des citoyens eux-mêmes que doivent émaner les lois et le gouvernement :

« … par le suffrage universel, par la souveraineté nationale, qui trouve son expression définitive et logique dans la République, vous avez fait de tous les citoyens, y compris les salariés, une assemblée de rois. C’est d’eux, c’est de leur volonté souveraine qu’émanent les lois et le gouvernement ; ils révoquent, ils changent leurs mandataires, les législateurs et les ministres… » (Jean JAURÈS).
Jean JAURES (1859-1914) fut un tribun républicain et socialiste qui, comme le montre bien l’illustration ci-contre, mit sa fougue oratoire extraordinaire au service de ses convictions et de son combat pour la justice sociale.
C’est cette idée d’égalité de tous les citoyens célébrée ci-dessus par JAURES que l’on retrouve, exprimée par FURETIÈRE, dans son célèbre Dictionnaire universel (publié en 1690), qui définissait le mot « république » par « État ou gouvernement populaire ».
On la retrouve un siècle plus tard, sous la Révolution, en 1792, exprimée de la manière suivante :
 « Qu’est-ce que la république ? En dernière analyse et dans son véritable sens, c’est le meilleur de tous les gouvernements, car c’est le gouvernement de tous […] Qu’est-ce qu’une république ? C’est un gouvernement où tout le monde est libre, où personne n’est maître, où chaque citoyen a pour sa patrie la même sollicitude qu’un chef de maison porte à sa famille. Qu’est-ce qu’un franc républicain ? C est un citoyen qui ne voit que des égaux dans ses semblables et qui ne connaît au-dessus de lui que la loi et les organes quand ils sont en fonction. Un bon républicain, conformément à l’esprit de ce mot, est tout à la chose commune. […] [2]
« Qu’est-ce que la république ? En dernière analyse et dans son véritable sens, c’est le meilleur de tous les gouvernements, car c’est le gouvernement de tous […] Qu’est-ce qu’une république ? C’est un gouvernement où tout le monde est libre, où personne n’est maître, où chaque citoyen a pour sa patrie la même sollicitude qu’un chef de maison porte à sa famille. Qu’est-ce qu’un franc républicain ? C est un citoyen qui ne voit que des égaux dans ses semblables et qui ne connaît au-dessus de lui que la loi et les organes quand ils sont en fonction. Un bon républicain, conformément à l’esprit de ce mot, est tout à la chose commune. […] [2]
Mais, si elle fut toujours un combat, au moins à sa naissance, la République est rarement devenue une pratique durable, comme l’atteste, en France, l’histoire de nos trois dernières Républiques (1875, 1946, 1958), après celle des deux premières (1792, 1848).
Le peuple fut toujours présent dans ce combat.
Le peuple et la République
En 1792, comme en 1848, puis en 1870, la République a toujours été un combat, non pas développé par des professionnels du verbe et des médias, comme aujourd’hui, mais par le peuple lui-même accompagné, souvent, par des hommes de conviction.
I/ En 1792, le peuple, un acteur majeur
Avant l’avènement de la 1ère République, le peuple avait envahi le Palais des Tuileries, le 10 août 1792, pour demander la destitution du Roi et une République.
Ci-dessous la prise des Tuileries le 10 août 1792
 La journée du 10 août 1792 fut organisée et conduite par la Commune insurrectionnelle de Paris et par les sections parisiennes. Après plusieurs assauts, la foule d’insurgés prit le palais des Tuileries, siège du pouvoir exécutif. C’est aussi la première fois, depuis le début de la Révolution, qu’une journée révolutionnaire était dirigée également contre l’Assemblée jugée trop timorée vis-à-vis du Roi qui pourtant, un an plus tôt, avait trahi son serment et tenté de fuir. Cette journée révolutionnaire consomma la chute de la monarchie constitutionnelle de 1791.
La journée du 10 août 1792 fut organisée et conduite par la Commune insurrectionnelle de Paris et par les sections parisiennes. Après plusieurs assauts, la foule d’insurgés prit le palais des Tuileries, siège du pouvoir exécutif. C’est aussi la première fois, depuis le début de la Révolution, qu’une journée révolutionnaire était dirigée également contre l’Assemblée jugée trop timorée vis-à-vis du Roi qui pourtant, un an plus tôt, avait trahi son serment et tenté de fuir. Cette journée révolutionnaire consomma la chute de la monarchie constitutionnelle de 1791.
À cette occasion, l’Assemblée législative proclama la « suspension » du roi et décréta l’élection au suffrage universel d’une Convention chargée de la rédaction d’une nouvelle Constitution qui devait donner naissance, un an après, à la première Constitution républicaine française (celle du 24 juin 1793).
Afin d’élire les députés de la Convention nationale, les élections législatives françaises de 1792 eurent lieu du 2 au 19 septembre 1792, après l’élection des collèges électoraux par les assemblées primaires le 26 août précédent.

La Convention, fraîchement élue en 1792, vota, à l’unanimité, dès le premier jour de sa session, sur la proposition de COLLOT d’HERBOIS, le 21 septembre 1792, l’abolition de la Monarchie.
Ci-contre, à gauche, Jean-Marie COLLOT d’HERBOIS (1749-1796), député montagnard, à la barre de la Convention le 21 septembre 1792
Le 9 Thermidor 1794, COLLOT d’HERBOIS présidait la Convention nationale et, avec BILLAUD-VARENNE, TALLIEN et FRERON, il fut l’un des artisans du décret d’arrestation contre ROBESPIERRE, son frère AUGUSTIN, LE BAS, SAINT-JUST et COUTHON. Cela ne l’empêcha pas, un peu plus tard, d’être mis lui-même en accusation par ses alliés d’hier, les thermidoriens, et d’être déporté au bagne de CAYENNE en 1795 où il mourut en 1796.
 Après l’abolition de la monarchie, le lendemain, 22 septembre 1792, sur une proposition de BILLAUD-VARENNE [3], la Convention prit, par un décret, la décision de dater du même jour, 22 septembre 1792, tous les actes comme étant ceux de « l’An I de la République française ». C’est par le biais de ce décret que la République naquit.
Après l’abolition de la monarchie, le lendemain, 22 septembre 1792, sur une proposition de BILLAUD-VARENNE [3], la Convention prit, par un décret, la décision de dater du même jour, 22 septembre 1792, tous les actes comme étant ceux de « l’An I de la République française ». C’est par le biais de ce décret que la République naquit.
Ci-contre, à droite, Jacques-Nicolas BILLAUD-VARENNE (1756-1819), avocat et député montagnard. Il se sépara de ROBESPIERRE, en Thermidor, et fit partie de ceux qui le mirent en cause et à mort. Mais, à son tour, il fut mis, plus tard, lui-même en accusation par les mêmes thermidoriens et fut déporté à CAYENNE, en 1795, en même temps que COLLOT d’HERBOIS et BARERE. Malgré sa maladie, il resta emprisonné à CAYENNE pendant 4 ans, puis, à sa libération, il y demeura jusqu’en 1816, date à partir de laquelle il s’installa en HAITI où il mourut en 1819.
 Un peu plus tard, le 25 septembre 1792, sur la proposition de COUTHON, ami de ROBESPIERRE, la République fut déclarée « une et indivisible ».
Un peu plus tard, le 25 septembre 1792, sur la proposition de COUTHON, ami de ROBESPIERRE, la République fut déclarée « une et indivisible ».
Ci-contre, à gauche, le Portrait de Georges Couthon, par François Bonneville, musée Carnavalet.
Georges Auguste COUTHON (1755-1794), avocat et révolutionnaire, souffrait d’une paralysie des jambes et devait se déplacer dans une chaise roulante. Modéré dans l’expression de ses convictions montagnardes, mais ami fidèle de ROBESPIERRE jusqu’au bout, il fut guillotiné, comme lui et SAINT-JUST, le 28 juillet 1794.
II/ En 1848… le 24 février, le peuple encore…
Après la première République (21 septembre 1792 – 26 octobre 1795), les régimes ploutocratiques ou autoritaires se succédèrent : après la Convention thermidorienne, le régime ploutocratique du Directoire (1795-1799), ensuite le régime césarien de BONAPARTE d’abord (1799-1804), puis l’Empire napoléonien (1804-1814), ensuite, la Monarchie restaurée des Bourbons (1814-1830), qui se solda, en 1830, par une nouvelle révolution populaire mais qui fut confisquée par la monarchie pseudo libérale, dite de « juillet », de Louis PHILIPPE (1830-1848).
Ces différentes séquences, après la Première République, furent celles du retour de l’ordre contre le mouvement des idées et d’émancipation des peuples. Sémantiquement, ces tensions furent d’ailleurs très bien traduites entre 1840 et 1848 où, à la Chambre, sous la Monarchie de Juillet (1830-1848), s’opposèrent deux partis : celui du « mouvement » (parti des républicains et libéraux) qui considérait la Charte du 14 août 1830 comme un point de départ pour l’établissement d’un régime vraiment démocratique ; celui de la « résistance » (parti des constitutionnels monarchistes) la considérant, au contraire, comme contenant le maximum de concessions à ne pas dépasser.
Comme le soulignait déjà Albert CRÉMIEUX [4], en 1912, la Révolution de 1848 reste encore assez obscure et mal élucidée par les historiens quant à son irruption soudaine et son cours évènementiel.
Au départ, la querelle sur la modification de la loi électorale – assise sur un cens électoral fortement élevé et privant de l’accès au vote les classes sociales les plus modestes –, avec le rejet cassant et hautain de GUIZOT de l’adoption du suffrage universel, cristallisa le mécontentement populaire avivé par une grave crise économique.
En effet, la crise de 1846-47 avait provoqué un chômage important : en 1848, à Paris, près des deux tiers des ouvriers en ameublement et du bâtiment étaient au chômage.
En province, la crise de subsistance – qui sévissait depuis 1846, suite à deux mauvaises récoltes de céréales (1845 et 1846) et à la maladie de la pomme de terre – provoquait également des troubles. À Buzançais, dans le Berry, le 13 janvier 1847, les tisserands, ouvriers et journaliers, réunis dans les faubourgs, s’opposèrent violemment à un transport de grains. Cette émeute, signe de l’affrontement entre blouses et habits, fut considérée par certains historiens comme un prélude à la révolution puisqu’elle était significative du fossé qui se creusait entre les couches populaires qui s’appauvrissaient et les notables qui s’enrichissaient.
Ci-dessous Banquet de Château-Rouge
ouvrant la campagne des banquets (juillet 1847)
 Sur un plan plus politique, la campagne des banquets fut un moment fort, entre 1847 et 1848, de l’opposition libérale et républicaine à Louis PHILIPPE et à son premier ministre François GUIZOT.
Sur un plan plus politique, la campagne des banquets fut un moment fort, entre 1847 et 1848, de l’opposition libérale et républicaine à Louis PHILIPPE et à son premier ministre François GUIZOT.
Pas moins de 70 réunions furent organisées dans toute la France par l’ensemble de l’opposition à Louis PHILIPPE et à François GUIZOT pour revendiquer l’élargissement du corps électoral. Pour contourner l’interdiction des réunions publiques politiques, ces réunions prirent la forme de banquets qui devenaient ainsi des lieux plus politiques que gastronomiques et festifs.
Devant l’ampleur prise par le mouvement, le gouvernement voulut à nouveau faire preuve de fermeté. Refusant d’ouvrir le débat sur le cens électoral, il fit interdire l’une de ces réunions devant se tenir à Paris, dans le 12ème arrondissement, le 22 février 1848.
En riposte, le 22 février au matin, des centaines d’étudiants – qui s’étaient déjà mobilisés un peu auparavant, en janvier 1848, pour protester contre la suspension des cours de Jules MICHELET [5] au Collège de France – se rassemblèrent place du Panthéon puis firent leur jonction avec les ouvriers à la Madeleine pour se diriger, au nombre de 3000, vers la Place de la Concorde à destination de la Chambre des députés, en scandant « Vive la Réforme ! À bas Guizot ! ». Mais le pouvoir politique contrôlait la situation avec de nombreuses forces de l’ordre : 30 000 soldats, l’appoint de l’artillerie, la sécurité des forts encerclant la capitale, la Garde nationale, enfin, forte 40 000 hommes.
Ci-dessous, cocardes arborées :
1/ à gauche 2/ à droite
Cocarde : Cocarde :
« Vive la Réforme » Caractères de la
« A bas GUIZOT » Garde Nationale
 Pourtant, dès le matin du 23 février, alors que l’insurrection se développait, les gardes nationaux de la deuxième Légion, boulevard Montmartre, crièrent « Vive la Réforme ! ». Dans d’autres quartiers, différents bataillons de la Garde nationale protégèrent les ouvriers contre les gardes municipaux et même contre la troupe de Ligne. La Garde nationale se posa ainsi en médiateur entre l’armée et le peuple parisien. Cette défection accéléra la chute de GUIZOT. LOUIS-PHILIPPE, réalisant enfin l’étendue de l’impopularité de son ministre, se résolut, dans l’après-midi, à le renvoyer et à le remplacer par le comte Louis-Mathieu MOLÉ. Le roi se séparait, certes tardivement, de son ministre GUIZOT, mais la protestation semblait se calmer.
Pourtant, dès le matin du 23 février, alors que l’insurrection se développait, les gardes nationaux de la deuxième Légion, boulevard Montmartre, crièrent « Vive la Réforme ! ». Dans d’autres quartiers, différents bataillons de la Garde nationale protégèrent les ouvriers contre les gardes municipaux et même contre la troupe de Ligne. La Garde nationale se posa ainsi en médiateur entre l’armée et le peuple parisien. Cette défection accéléra la chute de GUIZOT. LOUIS-PHILIPPE, réalisant enfin l’étendue de l’impopularité de son ministre, se résolut, dans l’après-midi, à le renvoyer et à le remplacer par le comte Louis-Mathieu MOLÉ. Le roi se séparait, certes tardivement, de son ministre GUIZOT, mais la protestation semblait se calmer.
Ci-dessous, une barricade en 1848
 Cependant, dans la soirée du 23 février, une fusillade malencontreuse déclenchée par le trop nerveux 14e régiment d’infanterie de ligne sur le boulevard des Capucines fit 52 morts et 74 blessés. Aussitôt, l’appel du tocsin relança l’insurrection. Les armuriers furent rapidement dévalisés et près de 1 500 barricades – sur lesquelles le monde ouvrier, la jeunesse estudiantine et la petite bourgeoisie avaient fraternisé – furent dressées dans toute la ville…
Cependant, dans la soirée du 23 février, une fusillade malencontreuse déclenchée par le trop nerveux 14e régiment d’infanterie de ligne sur le boulevard des Capucines fit 52 morts et 74 blessés. Aussitôt, l’appel du tocsin relança l’insurrection. Les armuriers furent rapidement dévalisés et près de 1 500 barricades – sur lesquelles le monde ouvrier, la jeunesse estudiantine et la petite bourgeoisie avaient fraternisé – furent dressées dans toute la ville…
Devant ce soulèvement, MOLÉ renonça et recommanda au Roi de faire appel à THIERS. Celui-ci, pressenti, exigea alors la dissolution de la Chambre des députés et la réforme électorale que le roi refusa. Renonçant à l’épreuve de force préconisée par le maréchal BUGEAUD, alors commandant supérieur de l’armée et de la Garde nationale de Paris, Louis PHILIPPE préféra rechercher une solution de compromis en espérant pouvoir ainsi pérenniser la dynastie régnante. C’est ainsi que le 24 février, au début de l’après-midi, la duchesse d’Orléans se rendit au Palais Bourbon pour y faire investir son petit-fils, le prince Philippe, comte Paris, et y faire proclamer officiellement la régence [6] dans l’espoir de sauver la dynastie. Les députés, dans leur majorité, semblaient favorables à une régence.
Mais les républicains avaient appris de leur échec de 1830 et n’entendaient pas, cette fois, se laisser déposséder de leur victoire, et tandis que les libéraux essayaient d’organiser un nouveau gouvernement plus libéral, ils forcèrent le cours des choses.
En effet, pendant la séance, le Palais-Bourbon fut envahi par la foule révolutionnaire qui, d’accord avec les élus de l’extrême gauche, repoussa toute solution monarchique et imposa l’instauration d’un gouvernement provisoire.
Le même jour, un gouvernement provisoire républicain fut désigné, et la Monarchie de Juillet abolie.
Ci-dessous,
les membres du Gouvernement
provisoire de 1848.
 Au soir de cette victoire, le 24 février, un gouvernement provisoire fut formé à l’Hôtel de Ville, rallié en hâte par les députés républicains LAMARTINE, LEDRU-ROLLIN, DUPONT DE L’EURE, ARAGO, MARIE, CRÉMIEUX ET GARNIER-PAGÈS. À ce groupe de parlementaires, les insurgés de l’Hôtel de Ville s’adjoignirent très vite quatre autres figures significatives : le mécanicien ALBERT, militant des sociétés secrètes et seul ouvrier du gouvernement, le socialiste Louis BLANC, théoricien de l’organisation du travail, et les directeurs des grands journaux républicains, Armand MARRAST du National et Ferdinand FLOCON de La Réforme.
Au soir de cette victoire, le 24 février, un gouvernement provisoire fut formé à l’Hôtel de Ville, rallié en hâte par les députés républicains LAMARTINE, LEDRU-ROLLIN, DUPONT DE L’EURE, ARAGO, MARIE, CRÉMIEUX ET GARNIER-PAGÈS. À ce groupe de parlementaires, les insurgés de l’Hôtel de Ville s’adjoignirent très vite quatre autres figures significatives : le mécanicien ALBERT, militant des sociétés secrètes et seul ouvrier du gouvernement, le socialiste Louis BLANC, théoricien de l’organisation du travail, et les directeurs des grands journaux républicains, Armand MARRAST du National et Ferdinand FLOCON de La Réforme.
C’est à Alphonse de LAMARTINE que revint l’honneur de proclamer, le 24 février 1848, la deuxième République.
Karl MARX, dans son petit ouvrage Les Luttes de classes en France [7] a très bien analysé les enjeux de cette lutte révolutionnaire et le rôle du peuple dans les journées de février 1848 (cf. Annexe I).
C’est donc bien encore le peuple que l’on retrouve dans la révolution des 22/25 février 1848 qui devait aboutir à la proclamation de la seconde République.
III/ En 1870… le 4 septembre, le peuple toujours…
Le 2 septembre 1870, l’empereur Napoléon III capitulait à l’issue de la bataille de Sedan. Il était fait prisonnier. La nouvelle fut connue à Paris le 3 septembre.
Ci-dessous Jules FAVRE (1809-1880)
Avocat et député républicain
 Lors de la séance de nuit du 3 au 4 septembre, le Corps législatif, en présence des membres du gouvernement, fut convoqué pour délibérer afin de trancher la question de la suite à donner à la nouvelle du désastre de Sedan et à la captivité de l’Empereur. Sur les 283 députés du Corps législatif [8], les 30 députés républicains, très minoritaires, se réunirent derrière Jules FAVRE pour proposer une motion déclarant la déchéance de l’Empereur et de sa dynastie et la mise en place d’une commission de gouvernement nommé par le Corps législatif ainsi que le maintien du général TROCHU dans ses fonctions de gouverneur général de Paris. La séance, qui fut levée dans la nuit, devait reprendre le dimanche 4 septembre à midi.
Lors de la séance de nuit du 3 au 4 septembre, le Corps législatif, en présence des membres du gouvernement, fut convoqué pour délibérer afin de trancher la question de la suite à donner à la nouvelle du désastre de Sedan et à la captivité de l’Empereur. Sur les 283 députés du Corps législatif [8], les 30 députés républicains, très minoritaires, se réunirent derrière Jules FAVRE pour proposer une motion déclarant la déchéance de l’Empereur et de sa dynastie et la mise en place d’une commission de gouvernement nommé par le Corps législatif ainsi que le maintien du général TROCHU dans ses fonctions de gouverneur général de Paris. La séance, qui fut levée dans la nuit, devait reprendre le dimanche 4 septembre à midi.
Le dimanche 4 septembre, la nouvelle du désastre de Sedan se propagea dans Paris par voie de placards et de presse ; les Parisiens, de plus en plus nombreux, se rendirent vers les Tuileries et vers la place de la Concorde. À midi, une foule de Parisiens et de gardes nationaux était déjà massée près du pont de la Concorde.
Lors de la reprise de la séance du Corps législatif, le dimanche après-midi du 4 septembre, le ministre de la Guerre, le général Charles COUSIN-MONTAUBAN, comte de PALIKAO, s’efforça de reprendre la main et de contrer la déchéance de l’Empereur en proposant que soit institué « un conseil de Gouvernement et de défense nationale », conseil restreint composé seulement de cinq membres nommés à la majorité absolue par le Corps législatif. Ce conseil – qui nommerait les ministres sous le contreseing de ses membres – serait placé sous son autorité en sa qualité de « lieutenant général ».
Le ministre, ainsi que d’autres membres du Corps législatif réclamèrent l’urgence et, conformément à la procédure alors en vigueur, le renvoi immédiat du texte dans les bureaux afin de constituer une commission en vue de son examen. Jules FAVRE demanda à ce que sa proposition, déposée dans la nuit, fût également admise à l’urgence, avant le texte du gouvernement, au motif notamment qu’elle accordait un pouvoir plus étendu à la Chambre.
À son tour, Adolphe THIERS proposa un troisième texte – sous la forme d’une proposition de motion signée par 47 membres pris dans toutes les parties de la Chambre – visant d’une part à ce que la Chambre nomme « une commission de gouvernement et de défense nationale », d’autre part la convocation d’une « Constituante » dès que les circonstances le permettraient.
Mais ce texte de compromis, bien que très proche de celui de Jules FAVRE, se gardait bien de déclarer explicitement la déchéance de l’Empereur. En effet, sa rédaction initiale, qui comportait les mots « Vu la vacance du pouvoir » au lieu de « Vu les circonstances », avait été jugée trop radicale par une partie des signataires.
Sur la proposition de Léon GAMBETTA, l’urgence fut votée en bloc pour les trois textes, ainsi que le renvoi collectif aux bureaux. Sur ce, la séance fut suspendue à 13h 40 minutes, afin de réunir les bureaux puis la commission.
Ci-dessous, la foule envahissant le Palais Bourbon
le 4 septembre 1870
 Mais « pendant que les bureaux délibèrent et désignent les commissaires, la foule envahit le Palais-Bourbon et les tribunes publiques : « Dans l’intervalle de la suspension, la foule stationnant sur le pont de la Concorde et devant la façade du Palais-Bourbon, envahit la cour, les couloirs et les escaliers de la Chambre, et se précipite dans les tribunes publiques en poussant le cri “La Déchéance !” mêlé aux cris : “Vive la France ! Vive la République” »[9].
Mais « pendant que les bureaux délibèrent et désignent les commissaires, la foule envahit le Palais-Bourbon et les tribunes publiques : « Dans l’intervalle de la suspension, la foule stationnant sur le pont de la Concorde et devant la façade du Palais-Bourbon, envahit la cour, les couloirs et les escaliers de la Chambre, et se précipite dans les tribunes publiques en poussant le cri “La Déchéance !” mêlé aux cris : “Vive la France ! Vive la République” »[9].
Lors de la reprise de la séance, il n’y avait plus beaucoup de députés présents, et seulement le comte de PALIKAO sur le banc du gouvernement face à une foule nombreuse ayant envahi les tribunes dans lesquelles l’on trouvait des hommes de 1848 et des proscrits. Dans le tumulte grandissant et après le départ du comte de PALIKAO, le Président SCHNEIDER décide de lever la séance à 15h. Après la fin de la séance et le départ du Président SCHNEIDER, quelques députés étaient restés dans la salle, et GAMBETTA s’adressa à la foule en ces termes :
« Citoyens,
Attendu que la patrie est en danger ;
Attendu que tout le temps nécessaire a été donné à la représentation nationale pour prononcer la déchéance ;
Attendu que nous sommes et que nous constituons le pouvoir régulier issu du suffrage universel libre ;
Nous déclarons que Louis Napoléon Bonaparte et sa dynastie ont à jamais cessé d’exercer les pouvoirs qui lui avaient été conférés. »
Jeune avocat, GAMBETTA s’était déjà imposé sous le Second Empire comme l’un des chefs les plus populaires de l’opposition républicaine, jouant, en 1869, un rôle déterminant dans l’élaboration du « programme de Belleville » (voir en Annexe II ce programme très politiquement et socialement avancé) [10].
Un peu plus tard, à l’hôtel de ville de Paris, le même GAMBETTA, en soulignant le rôle majeur du peuple dans la Révolution de 1870, fit la déclaration solennelle suivante au nom des députés républicains qui l’entouraient :
« Français !
Le Peuple a devancé la Chambre, qui hésitait.
Pour sauver la Patrie en danger, il a demandé la République.
Il a mis ses représentants non au pouvoir, mais au péril.
La République a vaincu l’invasion en 1792, la République est proclamée.
La Révolution est faite au nom du droit, du salut public.
Citoyens, veillez sur la Cité qui vous est confiée ; demain vous serez, avec l’armée, les vengeurs de la Patrie !
Hôtel de ville de Paris, le 4 septembre 1870.
Signé : Emmanuel ARAGO, Adolphe CRÉMIEUX, Pierre-Frédéric DORIAN, Jules FAVRE, Jules FERRY, GUYOT-MONTPAYROUX, Léon GAMBETTA, Louis-Antoine GARNIER-PAGÈS, Joseph-Pierre MAGNIN, Francisque ORDINAIRE, Pierre-Albert TACHARD, Eugène PELLETAN, Ernest PICARD, Jules SIMON. »
Ci-dessous Léon GAMBETTA
(1838-1882)
Avocat et député républicain
 Léon GAMBETTA (1836-1882) a incontestablement bien mérité son surnom de « commis voyageur de la République » car s’il ne put empêcher la défaite française de 1870 et l’élection, à Bordeaux, d’une assemblée en majorité monarchiste, il sillonna ensuite, de manière inlassable, les campagnes françaises pour diffuser les idées républicaines dont les défenseurs, à l’Assemblée, étaient essentiellement issus des grandes villes.
Léon GAMBETTA (1836-1882) a incontestablement bien mérité son surnom de « commis voyageur de la République » car s’il ne put empêcher la défaite française de 1870 et l’élection, à Bordeaux, d’une assemblée en majorité monarchiste, il sillonna ensuite, de manière inlassable, les campagnes françaises pour diffuser les idées républicaines dont les défenseurs, à l’Assemblée, étaient essentiellement issus des grandes villes.
Avec d’autres républicains, il vota les lois constitutionnelles de 1875 et combattit avec succès la coalition politique conservatrice encore favorable à une restauration monarchique. Tous ses efforts furent enfin récompensés par la victoire du camp républicain aux élections législatives de 1876 et à celles de 1877, consécutives à la dissolution de la Chambre des députés prononcée par le président MAC MAHON. Président de la Chambre des députés, de 1879 à 1881, GAMBETTA forma ensuite un éphémère grand ministère d’union républicaine mais qui ne dura que deux mois. Sa mort brutale, en décembre 1882, symbolisa la fin de la « République des fondateurs ».
Mais, comme nous l’avons vu, quels qu’aient été les grands mérites de leurs pères fondateurs respectifs, la 3ème République, comme la Seconde et la Première, n’eurent point été possibles sans le combat du peuple. Peuple et République, deux termes indissolubles, comme nous espérons l’avoir montré par le rappel de ces glorieuses pages de notre histoire nationale… qui n’est pas finie!
Louis SAISI
Paris, le 22 septembre 2020
NOTES
[1] Le 2ème tour des élections municipales de 2020, en principe prévu pour le 22 mars 2020 (comme cela apparaissait au départ dans certaines affichages électorales), a dû être reporté au 28 juin 2020, à cause des mesures de confinement prises par le Gouvernement à la suite de l’épidémie du Covid-19.
[2] Cité par François LEBRUN : « 22 septembre 1792 : le jour où la France est devenue républicaine », in L’Histoire , mensuel 155, daté mai 1992.
[3] BILLAUD-VARENNE avait déjà proposé, en juillet 1791, de remplacer la monarchie par la république, et dut même se cacher après avoir produit une brochure républicaine.
[4] Albert CRÉMIEUX : « Les Journées de Février 1848 », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, Année 1912, 17-4 , 1ère partie pp. 289-305 et suite et fin, 17-5, pp. 404-416. Voir aussi Albert CRÉMIEUX : La Révolution de Février : étude critique sur les journées des 21, 22, 23 et 24 février 1848, Ed. Cornély et Cie, Paris, 1912, 1 vol., 535 p. (thèse).
[5] Jules MICHELET s’était lancé dans la bataille politique au mépris de sa sécurité et de son avenir personnel. Ses Cours furent suspendus à partir du 2 janvier jusqu’au au 6 mars 1848. Les cours de MICHELET, donnés au Collège de France, de février 1838 à mars 1851, étaient regardés alors comme une sorte de monument historique. Rien d’étonnant qu’ils aient pu contribuer à la fermentation des esprits autour de la Révolution de 1848 et drainé l’agitation de la « jeunesse des écoles ». Jules VALLÈS (1832-1885), écrivain et journaliste – qui, fondateur du journal Le Cri du peuple, fit partie des élus de la Commune de Paris, en 1871, et dut s’exiler à Londres, de 1871 à 1880, pour échapper à sa condamnation à mort – en garde le souvenir ému et en parle en ces termes : « Le cours de Michelet est notre grand champ de bataille. Tous les jeudis, on monte vers le Collège de France. On a fait connaissance de quelques étudiants, ennemis des Jésuites, qu’on ramasse en route, et nous arrivons en bande dans la rue Saint-Jacques. […] Je sais bien que MICHELET est des nôtres et qu’il faut le défendre. […] Quelle belle tête tout de même, et quel œil plein de feu ! Cette face osseuse et fine, solide comme un buste de marbre et mobile comme un visage de femme, ces cheveux à la soldat mais couleur d’argent, cette voix timbrée, la phrase si moderne, l’air si vivant ! Il a contre le passé des hardiesses à la Camille DESMOULINS ; il a contre les prêtres des gestes qui arrachent le morceau ; il égratigne le ciel de sa main blanche. » (Jules VALLÈS, Le Bachelier, chap. VI, « La politique »).
[6] Philippe est le fils du défunt fils aîné de Louis-Philippe, le prince Ferdinand-Philippe, mort accidentellement le 13 juillet 1842. Comme il n’a que 9 ans, Louis-Philippe désigne donc sa belle-fille, l’épouse du défunt Ferdinand-Philippe et mère de Philippe, comme régente.
[7] Karl MARX : Les luttes de classe en France, Poche, Histoire folio, 27 février 2002.
[8] Le Corps législatif, qui avait été élu en principe pour 6 ans en 1869, comptait alors : 120 députés bonapartistes dits « libéraux » ; 92 députés bonapartistes classés « autoritaires » ; 41 députés royalistes ; 30 députés républicains.
[9] Corps législatif, session extraordinaire de 1870, Compte rendu in extenso de la séance de jour du 4 septembre 1870, p. 368.
[10] En 1869, des électeurs de Belleville appelèrent GAMBETTA à présenter sa candidature aux élections législatives des 24 mai et 7 juin 1869. Un comité électoral se constitua et publia le « Programme de Belleville », que GAMBETTA reprit dans son discours prononcé à Paris dans le quartier de Belleville. Ce discours fut publié dans le journal L’Avenir national le 15 mai 1869. Il est à noter que dans le contexte politique de cette période, ces élections législatives donnèrent lieu parfois à des combats de rue. Elles marquèrent la renaissance de la vie politique avec une presse libre et des réunions publiques dans les grandes villes, surtout à Paris.
ANNEXE I : Karl MARX : Les Luttes de classes en France (1850)
« Le 25 février, vers midi, la République n’était pas encore proclamée, mais, par contre, tous les ministères étaient déjà répartis entre les éléments bourgeois du Gouvernement provisoire et entre les généraux, banquiers et avocats du National. Mais, cette fois, les ouvriers étaient résolus à ne plus tolérer un escamotage semblable à celui de juillet 1830. Ils étaient prêts à engager à nouveau le combat et à imposer la République par la force des armes. C’est avec cette mission que RASPAIL se rendit à l’Hôtel de ville. Au nom du prolétariat parisien, il ordonna au Gouvernement provisoire de proclamer la République, déclarant que si cet ordre du peuple n’était pas exécuté dans les deux heures, il reviendrait à la tête de 200 000 hommes. Les cadavres des combattants étaient encore à peine refroidis, les barricades n’étaient pas enlevées, les ouvriers n’étaient pas désarmés et la seule force qu’on pût leur opposer était la Garde Nationale. Dans ces circonstances, les considérations politiques et les scrupules juridiques du Gouvernement provisoire s’évanouirent brusquement. Le délai de deux heures n’était pas encore écoulé que déjà sur tous les murs de Paris s’étalaient en caractères gigantesques : « République française ! Liberté, Égalité, Fraternité ! » »
ANNEXE II : TEXTE DU PROGRAMME DE BELLEVILLE (mai 1869)
Citoyens,
Au nom du suffrage universel, base de toute organisation politique et sociale, donnons mandat à notre député d’affirmer les principes de la démocratie radicale et de revendiquer énergiquement :
- l’application la plus radicale du suffrage universel tant pour l’élection des maires et des conseillers municipaux, sans distinction de localité, que pour l’élection des députés ;
- la répartition des circonscriptions effectuée sur le nombre réel des électeurs de droit, et non sur le nombre des électeurs inscrits ;
- la liberté individuelle désormais placée sous l’égide des lois et non soumise au bon plaisir et à l’arbitraire administratifs ;
- l’abrogation de la loi de sûreté générale ;
- la suppression de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII et la responsabilité directe de tous les fonctionnaires ;
- les délits politiques de tout ordre déférés au jury ;
- la liberté de la presse dans toute sa plénitude, débarrassée du timbre de cautionnement ;
- la suppression des brevets d’imprimerie et de librairie ;
- la liberté de réunion sans entraves et sans pièges avec la faculté de discuter toute matière religieuse, philosophique, politique ou sociale ;
- l’abrogation de l’article 291 du Code pénal ;
- la liberté d’association pleine et entière ;
- la suppression du budget des cultes et la séparation de l’Église et de l’État;
- l’instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire avec concours entre les intelligences d’élite, pour l’admission aux cours supérieurs, également gratuits ;
- la suppression des octrois, la suppression des gros traitements et des cumuls et la modification de notre système d’impôts ;
- la nomination de tous les fonctionnaires publics par l’élection ;
- la suppression des armées permanentes cause de ruine pour les finances et les affaires de la nation, source de haine entre les peuples et de défiance à l’intérieur ;
- l’abolition des privilèges et monopoles, que nous définissons par ces mots : primes à l’oisiveté ;
- les réformes économiques, qui touchent au problème social dont la solution, quoique subordonnée à la transformation politique, doit être constamment étudiée et recherchée au nom du principe de justice et d’égalité sociale. Ce principe généralisé et appliqué peut seul, en effet, faire disparaître l’antagonisme social et réaliser complètement notre formule :
- LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
- Le comité électoral de Belleville