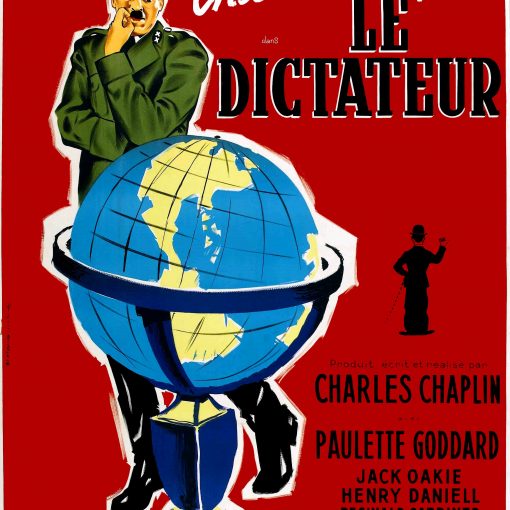LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION PARTIE INTÉGRANTE DU BLOC DES LIBERTÉS PUBLIQUES PROTEGEES PAR LA CONSTITUTION
Conseil constitutionnel n° 2019-780 DC du 4 avril 2019
Par Louis SAISI
 Si, avec le Conseil constitutionnel, en France, et Noam CHOMSKY [1], aux États-Unis, la liberté d’expression, compte deux précieux adeptes, elle possède encore de nombreux adversaires des deux côtés de l’Atlantique…
Si, avec le Conseil constitutionnel, en France, et Noam CHOMSKY [1], aux États-Unis, la liberté d’expression, compte deux précieux adeptes, elle possède encore de nombreux adversaires des deux côtés de l’Atlantique…
Ainsi le 10 novembre 2019, à Paris, la manifestation contre l’islamophobie avait été contestée, dans son principe même, par une partie de la classe politique à cause du contenu de l’appel à cette manifestation (que l’on pouvait certes discuter) ainsi que de la présence de certains signataires – plus ou moins fréquentables selon certains – de cet appel. Et dans ce contexte assez confus, certains hommes politiques élus, pour avoir décidé d’y participer, furent même considérés comme assez peu « républicains » par la droite, pour une fois unanime, mais aussi par une certaine partie de la « gauche » social-libérale, alors même qu’une telle manifestation – qu’on pouvait certes politiquement critiquer et même combattre quant à son opportunité et son bien-fondé politiques – n’avait pas été interdite par les autorités publiques.
Par la hâte avec laquelle certains sont toujours prompts à vouloir décerner des brevets d’orthodoxie républicaine, on s’éloigne ainsi trop souvent de VOLTAIRE et de son Traité sur la tolérance, certes bien ancien (1763), mais dont le contenu, très moderne et sain pour notre vivre ensemble, aurait pu nous faire penser qu’il faisait partie de nos mœurs politiques contemporaines [2] …
Un peu plus tard, après les incidents du samedi 16 novembre 2019 ayant émaillé les manifestations des « gilets jaunes » – surtout à Paris -, on parle toujours et encore, aujourd’hui, du droit de manifester mais surtout, au niveau du pouvoir (gouvernement) et des partis politiques proches de celui-ci, de ses limites éventuelles…
Ce sont, en effet, les partisans du libéralisme et de l’Etat régalien qui s’interrogent sur les limites du champ du droit de manifester en oubliant souvent un peu trop vite que si manifester est un droit, c’est d’abord parce que c’est une LIBERTÉ, et même une LIBERTÉ PUBLIQUE FONDAMENTALE ayant à la fois un caractère collectif et individuel.
Le support juridique de la liberté de manifester réside dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789 qui fait partie du bloc de constitutionnalité puisque celle-ci est explicitement évoquée par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.
L’article 10 de la DDHC dispose en effet :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».
 Ceci explique que dès 1995 le droit de manifester avait été reconnu par le Conseil constitutionnel dans une décision n°94-352 du 18 janvier 1995 rendue à propos de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Considérant que les mesures ainsi édictées par la loi touchent aux conditions dans lesquelles s’exercent la liberté individuelle, la liberté d’aller et venir et le droit d’expression collective des idées et des opinions » (cf. 16ème considérant). Déjà, dans cette décision, le « droit d’expression collective des idées et des opinions » découlait de la constitutionnelle liberté d’expression résultant, comme il a été dit, de l’article 10 de la DDHC.
Ceci explique que dès 1995 le droit de manifester avait été reconnu par le Conseil constitutionnel dans une décision n°94-352 du 18 janvier 1995 rendue à propos de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Considérant que les mesures ainsi édictées par la loi touchent aux conditions dans lesquelles s’exercent la liberté individuelle, la liberté d’aller et venir et le droit d’expression collective des idées et des opinions » (cf. 16ème considérant). Déjà, dans cette décision, le « droit d’expression collective des idées et des opinions » découlait de la constitutionnelle liberté d’expression résultant, comme il a été dit, de l’article 10 de la DDHC.
Aussi, rien de surprenant que l’on retrouve l’affirmation de ce caractère collectif et individuel dans une plus récente décision du Conseil constitutionnel n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 rendue à propos de la Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations [3] (cf. cette décision en Annexe).
Selon cette décision, toute personne est ainsi détentrice d’un « droit d’expression collective des idées et des opinions ».
Cette loi de circonstance visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations était motivée par la situation de crise sociale et politique révélée (et non provoquée !) par le mouvement des « gilets jaunes ».
À partir de novembre 2018, en effet, le mouvement des « gilets jaunes » s’est développé pendant des mois de manière hebdomadaire aux « ronds-points » des villes et de leurs périphéries à l’échelle de toute la France. Cette protestation populaire exprimait une colère et un « mal vivre » remettant en cause certains choix politiques de notre Exécutif à deux têtes MACRON/PHILIPPE – dont la première, la présidentielle, qui a enfanté l’autre, la dépasse toujours – soutenu par leur majorité parlementaire, notamment à l’Assemblée nationale.
 Les revendications, nombreuses, portaient notamment sur la fiscalité (remise en place de l’ISF, baisse de la taxe sur les carburants, baisse de la TVA sur les produits de première nécessité…), les conditions sociales de la vie quotidienne (meilleure sécurité de l’emploi, augmentation du SMIC…), le cadre politique d’exercice de la citoyenneté (reconnaissance du vote blanc ou encore adoption du référendum d’initiative citoyenne).
Les revendications, nombreuses, portaient notamment sur la fiscalité (remise en place de l’ISF, baisse de la taxe sur les carburants, baisse de la TVA sur les produits de première nécessité…), les conditions sociales de la vie quotidienne (meilleure sécurité de l’emploi, augmentation du SMIC…), le cadre politique d’exercice de la citoyenneté (reconnaissance du vote blanc ou encore adoption du référendum d’initiative citoyenne).
Le climat était souvent tendu entre manifestants et forces de l’ordre. A l’occasion de certaines de ces manifestations, il arrivait que l’ordre public soit troublé du fait des heurts, des dégradations et autres violences – venant le plus souvent de la part de « casseurs » hors de tout contrôle de la part des organisateurs – qui empêchaient le bon déroulement des manifestations.
Il reste que les protagonistes – manifestants et forces de police – se reprochaient mutuellement d’être à l’origine de nombreux et parfois très graves incidents faisant parfois des blessés des deux côtés mais surtout du côté des « gilets jaunes » selon le journal Libération.
Pourtant, ce furent aux manifestants eux-mêmes que furent imputés tous les désordres et la violence. D’où naquit l’idée de la mise en place d’une arme législative préventive pour empêcher ce type de violences. C’est en ce sens qu’une proposition de loi [4] visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs fut discutée à l’Assemblée nationale à partir de début février 2019. La loi fut adoptée le 10 mars 2019 pour être soumise dès le 13 mars au Conseil constitutionnel à la fois par les sénateurs et les députés de gauche qui en contestaient sa validité constitutionnelle ainsi que par le Président MACRON lui-même qui souhaitait, à l’inverse, obtenir sa validation par le Conseil constitutionnel.
I/ LA CONSTITUTIONNALITÉ DES ARTICLES 2, 3, 6 ET 8 DE LA LOI
Le Président de la République demandait au Conseil de se prononcer sur la conformité à la Constitution des articles 2, 3 et 6 de la loi. Cette saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, assez peu ordinaire, s’expliquait d’une part par le fait qu’il ne s’agissait pas d’un projet de loi du Gouvernement, d’autre part par la considération que la proposition de loi n’émanait pas du groupe LREM constituant la majorité parlementaire rassemblée autour du Gouvernement. Cette dernière considération pouvant également éclairer le fait qu’une cinquantaine de députés du groupe LREM n’aient pas voté la proposition de loi qui fut par ailleurs vivement critiquée par certains de ceux-ci [5]. S’agissant des dispositions contestées par les parlementaires auteurs de la saisine, les députés contestaient la procédure d’adoption [6] de la loi et, sur le fond, ses articles 2, 3 et 6. Les sénateurs contestaient également les articles 2, 3, 6, de la loi mais aussi son article 8.
Pour l’alléger, nous n’aborderons pas dans ce commentaire la mise en cause de la procédure d’adoption de la loi (par ailleurs jugée constitutionnelle) pour mieux nous concentrer sur les problèmes de fond.
A/ L’objet de ces articles
L’article 2 de la loi introduisait un article 78-2-5 dans le Code de procédure pénale visant à permettre la réalisation d’inspections visuelles accompagnées de fouilles des sacs et véhicules, aux abords des manifestations, par l’intermédiaire d’agents autorisés sur réquisition écrite du procureur de la République (voir §§ 11 à 17 de la décision).
L’article 3 du texte de la loi, le plus fortement contesté, insérait dans le Code de la sécurité intérieure un article L. 211-4-1 permettant aux préfets de prononcer des interdictions administratives de manifester. Certes, de telles interdictions n’étaient censées concerner que les personnes ayant déjà commis, lors de manifestations précédentes, des « atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi que des dommages importants aux biens » ou encore « un acte violent ».
Par ailleurs, le quatrième alinéa de cet article L. 211-4-1 permettait également aux préfets, dans certains cas, d’interdire à une personne de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois.
L’article 6 ajoutait au Code pénal un article 431-9-1 créant le délit de dissimulation volontaire du visage, au sein ou aux abords d’une manifestation, où des troubles à l’ordre public étaient commis ou risquaient d’être commis (voir §§ 27 à 33). L’article 3 relatif à l’interdiction administrative de manifester était considéré comme la mesure phare de la loi anticasseurs.
L’article 138 du code de procédure pénale ayant pour objet de dresser la liste des obligations auxquelles pouvait être soumise une personne placée sous contrôle judiciaire, l’article 8 y introduisait un 3° bis ajoutant l’obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.
B/ La conformité des articles 2, 6 et 8 à la Constitution : discussion
1/ L’article 2 (inspection visuelle des bagages des personnes, leur fouille et visite des véhicules)
Le Conseil constitutionnel a tranché que l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissait ni le principe de proportionnalité des peines ni aucune autre exigence constitutionnelle, était conforme à la Constitution.
En effet, selon lui, « en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et n’a pas porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée. »
Quel était le problème ?
L’article 78-2-5 du code de procédure pénale permettait « l’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l’article 78-2-2 » ainsi que « la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2 ».
L’article 78-2-5 disposait en effet :
« Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
1° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l’article 78-2-2 ;
 2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.
Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Les députés requérants faisaient valoir que ces dispositions méconnaissaient les libertés d’aller et venir et de réunion ainsi que le droit à l’expression collective des idées et des opinions et le principe de proportionnalité des peines. Ils soutenaient notamment que ces opérations n’étaient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi dès lors qu’il existait déjà d’autres dispositions permettant de procéder à de telles opérations et que le périmètre sur lequel elles peuvent être conduites est trop large.
Par rapport à l’invocation de la liberté d’aller et de venir, le Conseil constitutionnel dans sa décision N° 76-75 DC du 12 janvier 1977 [7], relative à la fouille des véhicules, avait déjà érigé dans le premier considérant de sa décision la « liberté individuelle » (sans en préciser la nature ni le contenu) en « principe fondamental reconnu par les lois de la République » : « Considérant que la liberté individuelle constitue l’un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République, et proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par le Préambule de la Constitution de 1958 ». Si elle n’affichait pas explicitement le contenu donné par la Haute Instance de l’aile Montpensier du Palais Royal à la liberté individuelle, cette décision pouvait néanmoins constituer le point de départ d’une possible extension de la notion. En effet, comme le soulignait le Doyen FAVOREU « il n’y avait à proprement parler atteinte ni à la sûreté… ni à la liberté d’aller et de venir… ni à l’inviolabilité du domicile… ni au secret de la correspondance. Mais il pouvait y avoir “un peu de tout cela” ». Et d’ajouter « le droit au respect de la vie privée était donc implicitement consacré par la décision du 12/01/1977 ».
Nous ne sommes pas ici dans le cadre du respect de la vie privée mais néanmoins dans celui d’une liberté à la fois individuelle et collective. Or, par sa généralité et son imprécision – « sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats» -, l’article 2 de la loi du 10 mars 2019 laissait pourtant planer une ombre de suspicion sur toute manifestation et cela d’autant plus que celle-ci n’était pas qualifiée puisqu’il n’était pas posé que celle-ci ait dû générer un désordre que ce soit.
Contrairement à ce qu’il a décidé pour censurer l’article 3, le Conseil constitutionnel n’impose pas ici que la manifestation visée par l’article 2 soit susceptible de donner lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou cause des dommages importants aux biens.
Par ailleurs, si l’article 431-10 du Code pénal dispose bien que « Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende », il ne fait pas de la « manifestation » ou de la « réunion publique» une cause de suspicion générale pouvant générer un acte de délinquance ou même simplement une menace.
C’est dire que la loi du 10 mars 2019, même si elle ne le dit pas, est une loi de circonstance ciblée sur la « couleur » de la manifestation (« gilets jaunes »).
En d’autres termes, le problème est moins la poursuite de l’acte délictueux que la participation à une manifestation récurrente semblant attester, uniquement en tant que telle, d’une intention de nuire…
2/ L’article 6 (délit de dissimulation volontaire du visage)
Le Conseil constitutionnel a considéré que l’article 6 était conforme à la Constitution en se basant sur la double considération d’une part que l’incrimination contestée ne méconnaissait pas le principe de légalité des délits et des peines, d’autre part que l’article 431-9-1 du code pénal ne méconnaissait pas non plus le droit d’expression collective des idées et des opinions ou le principe de proportionnalité des peines ni aucune autre exigence constitutionnelle.
Quel était le problème ?
 L’article 6 ajoutait au Code pénal un article 431-9-1 créant le délit de dissimulation volontaire du visage, au sein ou aux abords d’une manifestation, où des troubles à l’ordre public étaient commis ou risquaient d’être commis. L’article 431-9-1 disposait :
L’article 6 ajoutait au Code pénal un article 431-9-1 créant le délit de dissimulation volontaire du visage, au sein ou aux abords d’une manifestation, où des troubles à l’ordre public étaient commis ou risquaient d’être commis. L’article 431-9-1 disposait :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. »
Les députés et les sénateurs requérants dénonçaient l’imprécision des éléments constitutifs de cette infraction, dont il résulterait une incompétence négative du législateur et une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Ils critiquaient, à ce titre, la difficulté d’appréciation de la notion de dissimulation partielle du visage. Les députés requérants faisaient par ailleurs valoir une caractérisation insuffisante de l’élément intentionnel, puisqu’il n’était pas exigé que la personne qui dissimulait son visage ait participé effectivement aux troubles à l’ordre public dénoncés. En outre, selon eux, l’infraction méconnaitrait également le principe de proportionnalité des peines. Enfin, les sénateurs requérants critiquaient, quant à eux, l’imprécision de la circonstance de troubles à l’ordre public intervenant « à l’issue » d’une manifestation ou de celle de risque de commission de troubles à l’ordre public.
Par rapport aux arguments développés par les parlementaires, la déclaration de constitutionnalité du Conseil constitutionnel n’est guère convaincante car le Conseil, de manière elliptique, énonce une vérité juridique beaucoup plus qu’il n’apporte de soin à la démontrer.
Ainsi le fait de dissimuler son visage si le manifestant pris n’a pas participé lui-même à la commission de « troubles à l’ordre public » n’est pas un motif suffisant pour faire de lui un délinquant.
D’autre part, la notion de « troubles à l’ordre public » est floue et ne peut, en tout cas, se déduire de la seule présence de l’intéressé à une manifestation.
Enfin, sur le dernier point soulevé par les sénateurs et auquel le Conseil constitutionnel n’a pas répondu, il n’est guère discutable que l’article 6 mettait sur le même plan le temps réel et factuel révélant une situation concrète qui s’est réalisée – « au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis » – et le risque de la commission de tels troubles : « ou risquent d’être commis ». Or si le premier temps relève incontestablement du constat d’une réalité, le second temps, lui, relève d’un souci de prévention d’un risque seulement potentiel.
 Par ailleurs, le contexte répressif ayant entouré les manifestations des « gilets jaunes » peut rendre compte de ce souci de protection de leur visage de la part de certains manifestants. En effet, si dans l’espace public et civique, l’on peut comprendre qu’une loi interdise la dissimulation du visage faisant partie de l’identité d’un individu [8], l’on peut comprendre également que dans un certain contexte toxique et dangereux la dissimulation du visage puisse constituer pour certains manifestants la seule manière de se protéger contre certains fumigènes et gaz toxiques déjà utilisés dans le passé par les forces de l’ordre contre les manifestants. Cela peut devenir, alors, une quasi nécessité.
Par ailleurs, le contexte répressif ayant entouré les manifestations des « gilets jaunes » peut rendre compte de ce souci de protection de leur visage de la part de certains manifestants. En effet, si dans l’espace public et civique, l’on peut comprendre qu’une loi interdise la dissimulation du visage faisant partie de l’identité d’un individu [8], l’on peut comprendre également que dans un certain contexte toxique et dangereux la dissimulation du visage puisse constituer pour certains manifestants la seule manière de se protéger contre certains fumigènes et gaz toxiques déjà utilisés dans le passé par les forces de l’ordre contre les manifestants. Cela peut devenir, alors, une quasi nécessité.
En effet, selon Libération du 3 décembre 2018, le 1er décembre 2018, des armes non létales furent utilisées par les forces de l’ordre : « 8 000 grenades lacrymogènes, 1 193 tirs au lanceur de balles en caoutchouc, 1 040 grenades de désencerclement et 339 grenades GLI-F4, munition composée notamment d’une charge explosive de 25 grammes de TNT. (https://www.liberation.fr/france/2018/12/03/gilets-jaunes-a-paris-une-utilisation-historique-des-armes-du-maintien-de-l-ordre_1695773)
Or la grenade GLI-F4 est particulièrement nocive et toxique car il s’agit d’une grenade lacrymogène assourdissante et à effet de souffle contenant une charge explosive de 26 grammes de TNT ainsi que de 4 grammes d’hexocire (mélange d’hexogène et de cire). Utilisée par les forces de police françaises depuis 2011, elle est à l’origine de plusieurs cas de blessures et mutilations. La France est le seul pays européen à l’utiliser pour le rétablissement de l’ordre [9].
3/ L’article 8 (obligation de ne pas participer à des manifestations pour des individus soumis au contrôle judiciaire)
 Ici aussi, le Conseil constitutionnel a décidé que l’article 8 de la loi introduisant un 3° bis dans l’article 138 du code de procédure pénale « qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. »
Ici aussi, le Conseil constitutionnel a décidé que l’article 8 de la loi introduisant un 3° bis dans l’article 138 du code de procédure pénale « qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. »
Comme il a été dit plus haut, l’article 8 introduisait dans l’article 138 du Code de procédure pénale un 3° bis ajoutant l’obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.
Les sénateurs reprochaient à cet article de permettre de prononcer une interdiction de manifester applicable sur tout le territoire national et sans limitation de durée autre que celle du placement sous contrôle judiciaire. Ils en concluaient à la méconnaissance de la liberté d’aller et de venir et à la négation du droit d’expression collective des idées et des opinions et de l’article 9 de la Déclaration de 1789, qui prohibe « toute rigueur qui ne serait pas nécessaire ».
La réponse du Conseil constitutionnel fut d’estimer que le contrôle judiciaire étant déclenché par un magistrat et sous le contrôle de celui-ci, la personne soumise à l’interdiction de manifester pouvant à tout moment demander la mainlevée du contrôle judiciaire. Lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire d’une personne en instance de jugement convoquée par procès-verbal ou soumise aux procédures de comparution à délai différé ou immédiate, la durée de la mesure est limitée par le délai de jugement lui-même.
Aux termes de l’article 138 du Code procédure pénale, le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention à l’encontre d’une personne encourant une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Mais il n’en demeure pas moins que l’objectif du contrôle judiciaire étant toujours de concilier les libertés individuelles avec la protection de la société, le problème posé implicitement par les sénateurs était de savoir si le législateur n’avait pas commis un détournement de procédure concernant le contrôle judiciaire en l’étendant à une liberté publique dès lors que l’alinéa 1er de l’article 137 du Code procédure pénale dispose que « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. »
Certes l’alinéa 2 du même article précise bien ensuite qu’« en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire… », mais il n’en demeure pas moins vrai que le contrôle judiciaire doit être l’exception due aux « nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté ». C’est dire que les « obligations » découlant ensuite du régime du contrôle judiciaire et déterminées par le juge dans l’arsenal des mesures énumérées par l’article 138 du Code de procédure pénale doivent être « nécessaires ».
Le Conseil constitutionnel se borne à rappeler, de manière succincte, le dispositif du fonctionnement du contrôle judiciaire avec la possibilité pour l’individu de demander la levée d’une obligation – notamment, en l’occurrence, celle relative à l’interdiction de manifester – pour en déduire ensuite qu’à partir du moment où celui-ci s’exerce sous l’autorité d’un magistrat, cela était suffisant pour justifier constitutionnellement le fait pour le législateur d’avoir ajouté l’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique parmi les obligations susceptibles d’être imposées à un individu sous le coup d’une procédure pénale, obligations qui sont prévues par l’article 138 du Code de procédure pénale.
II/ LA DÉCISION D’INCONSTITUTIONNALITÉ PARTIELLE
Si les articles 2, 6 et 8 furent déclarés conformes à la Constitution, en revanche, le Conseil constitutionnel censura les dispositions relatives à l’article 3 de la loi.
Mais que disait cet article 3 ?
L’article 3 insérait au sein du code de la sécurité intérieure un article L. 211-4-1 qui devait permettre à l’autorité administrative, sous certaines conditions, d’interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique. Le quatrième alinéa de cet article L. 211-4-1 permettait également à cette même autorité, dans certains cas, d’interdire à une personne de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois.
Cet article avait suscité de nombreuses prises de position et polémiques. Outre les auteurs de la saisine, même certains parlementaires de la majorité présidentielle avaient critiqué les dispositions de l’article 3.
Un texte « liberticide ». C’est le terme qui revenait le plus souvent dans la bouche des opposants. « On permet à une autorité administrative, non indépendante, le préfet, de restreindre le droit de manifester de manière préventive, sans qu’aucun acte répréhensible n’ait été commis. C’est loin d’être anodin », critiquait notamment Aurélien TACHÉ, député LREM de la 10ème circonscription du Val d’Oise, mettant également en avant la « notion floue » du terme « menace d’une particulière gravité ». Comme en écho à ses propos, sa collègue LREM Martine WONNER, députée de la 4ème circonscription du Bas-Rhin, surenchérissait : cela « donne surtout beaucoup trop de pouvoirs aux préfets. Une justice administrative, c’est impossible pour moi ». Le député centriste Charles de COURSON était allé jusqu’à dénoncer un retour au « régime de Vichy » pour fustiger un texte qu’il considère – comme d’autres – comme attentatoire aux libertés publiques.
Pour sa part, Amnesty International ne se privait pas, à son tour, de dénoncer le caractère «arbitraire » du dispositif : « Ce n’est plus la justice qui dira “cette personne est un danger en manifestation“, mais le relais du pouvoir exécutif, qui pourra décider d’interdire à une personne de manifester. C’est une porte ouverte très claire à l’arbitraire ».
« Rogner sur les libertés publiques présente nécessairement un risque » s’inquiète Patrick WACHSMANN, professeur de droit public, et auteur d’un ouvrage sur Les libertés publiques et d’un autre sur Les droits de l’Homme.. « Ce n’est pas la première fois que l’on fait entrer une disposition de l’état d’urgence dans le droit commun, mais cette fois ça ne concerne pas le terrorisme », souligne-t-il. S’il considère la référence de Charles de COURSON au régime du maréchal Pétain « excessive », il rappelle toutefois que « le régime de Vichy n’avait presque rien changé à la législation qui lui était préexistante, l’arsenal juridique adopté par la IIIe République suffisait à asseoir un régime autoritaire. En multipliant les exceptions juridiques qui resteront dans le droit, on s’expose bien sûr à ce qu’un pouvoir peu soucieux des libertés en fasse un usage dangereux ».
A/ Les griefs des parlementaires contre l’article 3
Comme nous l’avons vu, le Conseil constitutionnel avait fait l’objet de deux saisines : l’une émanant de députés ; l’autre de sénateurs.
1/ Les griefs des députés
Ci-dessous, séance à l’Assemblée nationale
 Les députés requérants soutenaient que l’ensemble de cet article était contraire au droit à l’expression collective des idées et des opinions et à la liberté d’aller et venir et à celle de réunion.
Les députés requérants soutenaient que l’ensemble de cet article était contraire au droit à l’expression collective des idées et des opinions et à la liberté d’aller et venir et à celle de réunion.
Ils estimaient que cette mesure d’interdiction n’était pas nécessaire, dès lors qu’une personne ayant suscité des troubles dans une manifestation :
– avait déjà pu être pénalement sanctionnée par l’autorité judiciaire, le cas échéant par une interdiction de manifester ;
– la mesure était disproportionnée compte tenu du champ des personnes auxquelles elle était susceptible de s’appliquer ;
– par ailleurs, en permettant qu’une mesure d’interdiction de manifester soit prononcée par l’autorité administrative, de manière préventive, le législateur méconnaîtrait les droits de la défense et la présomption d’innocence ;
– cet article violerait enfin le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu’il autorise, dans certaines hypothèses, l’autorité administrative à notifier l’arrêté d’interdiction de manifester sans respecter un délai préalable de quarante-huit heures entre cette notification et la manifestation.
– enfin, le quatrième alinéa de l’article L. 211-4-1, qui permettait le prononcé d’une interdiction d’une durée d’un mois, contrevenait au principe de proportionnalité des peines.
2/ Les griefs des sénateurs contre l’article 3
Ci-dessous, séance au Sénat
 Les sénateurs requérants soutenaient également que l’ensemble de cet article méconnaissait le droit d’expression collective des idées et des opinions :
Les sénateurs requérants soutenaient également que l’ensemble de cet article méconnaissait le droit d’expression collective des idées et des opinions :
– dès lors qu’il permettait à l’autorité administrative, en application de critères imprécis, de prononcer une interdiction de manifester pouvant présenter un caractère disproportionné ;
– l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi était également méconnu au motif que les conditions de prononcé d’une interdiction de manifester étaient imprécises et ambiguës ;
– s’agissant du quatrième alinéa de l’article L. 211-4-1, les sénateurs faisaient valoir que la possibilité pour le préfet de prononcer une interdiction de manifester sur l’ensemble du territoire pour une durée d’un mois renouvelable était contraire au droit d’expression collective des idées et des opinions dans la mesure où cette interdiction pouvait s’appliquer à toute manifestation et être renouvelée indéfiniment ;
– enfin, dès lors qu’une interdiction de manifester pouvait s’accompagner, pour la personne soumise à cette interdiction, d’une obligation de répondre au moment de la manifestation aux convocations de toute autorité désignée par le préfet, il en résultait aussi une méconnaissance de la liberté d’aller et de venir.
B/ L’inconstitutionnalité de l’article 3 (voir §§ 18 à 26 de la décision)
Le Conseil constitutionnel va se livrer à un raisonnement en 4 étapes.
Il commence d’abord par énoncer le principe selon lequel la sauvegarde de l’ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle (1).
Il reconnaît ensuite à chaque personne le droit à une expression collective des idées et opinions (2). Il va vérifier ensuite si le nécessaire compromis entre la « sauvegarde de l’ordre public » et le respect du « droit à une expression collective des idées et opinions » a bien été opéré par le législateur (3).
Il constate enfin qu’une latitude d’appréciation excessive a été laissée à l’autorité administrative et donc qu’une atteinte a été portée au droit d’expression collective des idées et des opinions (4).
1/ La poursuite de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle
En prononçant à l’encontre d’une personne constituant une menace grave pour l’ordre public une interdiction de participer à une manifestation, le législateur a entendu prévenir la survenue de troubles sur la voie publique et a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
 L’ordre public n’est mentionné que très incidemment au sein de l’article 10 de la Déclaration de 1 789: “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
L’ordre public n’est mentionné que très incidemment au sein de l’article 10 de la Déclaration de 1 789: “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
Il y a lieu de noter que cette notion n’est pas autonome, ce qui signifie que normalement elle n’est pas une fin en soi car elle est définie par la loi.
Elle est devenue aujourd’hui une construction jurisprudentielle concurrente des libertés et droits fondamentaux énoncés dans nos textes constitutionnels.
Le Conseil constitutionnel n’a jamais défini la notion d’ordre public sauf à l’appréhender de manière négative en indiquant ce qui lui porte atteinte : « les troubles sur la voie publique », des « atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens » par exemple.
De manière plus positive, mais aussi très floue, les notions qui tournent autour sont « le bon ordre », « la sécurité », « la salubrité et la tranquillité publiques ».
L’on a déjà rencontrée dans la décision du Conseil constitutionnel N° 94-352 du 18 janvier 1995 cette notion d’ordre public comme « objectif de valeur constitutionnelle » :
 « Considérant que la prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d’infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle ; qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et la liberté d’aller et venir ainsi que l’inviolabilité du domicile ; que la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle. »
« Considérant que la prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d’infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle ; qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et la liberté d’aller et venir ainsi que l’inviolabilité du domicile ; que la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle. »
Mais c’est à partir de la décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 relative à la Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes que l’on trouve la référence à la fois à la notion « d’ordre public » et à la « prévention d’atteintes » pouvant lui être portées qui sont mises sur le même niveau de concurrence que les « libertés constitutionnellement reconnues » : « Considérant, dès lors, que les dispositions des articles 76, 77 et 78 de la loi déférée à l’examen du Conseil constitutionnel ne sont pas, sous les conditions de forme et de fond énoncées par ces articles, contraires à la conciliation qui doit être opérée entre l’exercice des libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la recherche des auteurs d’infractions et de la prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, nécessaires, l’une et l’autre, à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle. » [10]
Par la suite, la sauvegarde de l’ordre public comme un « objectif de valeur constitutionnelle » est énoncée de manière plus nette et ferme en 1982, dans une décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 [11] relative à la Loi sur la communication audiovisuelle [12].
2/ La reconnaissance au profit d’une personne du droit à une expression collective des idées et opinions
En même temps qu’il reconnaît à une personne le droit de manifester pour exprimer, dans un cadre collectif, ses idées et opinions, le Conseil constitutionnel constate qu’il n’est guère contestable que les dispositions contestées de l’article 3 de la loi confèrent à l’administration le « pouvoir de priver une personne de son droit d’expression collective des idées et des opinions ».
3/ le Conseil constitutionnel examine ensuite si le nécessaire compromis entre la « sauvegarde de l’ordre public » et le respect du « droit à une expression collective des idées et opinions » a bien été opéré par le législateur
 Il commence d’abord par relever qu’aux termes de la loi contestée « la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public nécessaire au prononcé de l’interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d’un « acte violent » soit d’« agissements » commis à l’occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens.
Il commence d’abord par relever qu’aux termes de la loi contestée « la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public nécessaire au prononcé de l’interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d’un « acte violent » soit d’« agissements » commis à l’occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens.
Mais dès lors, en légiférant ainsi, le Parlement n’a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l’intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l’occasion de cette manifestation.
Il n’a pas davantage imposé que la manifestation visée par l’interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages.
En outre, l’interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences.
Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d’une interdiction de manifester.
Par ailleurs, lorsqu’une manifestation sur la voie publique n’a pas fait l’objet d’une déclaration ou que cette déclaration a été tardive, l’arrêté d’interdiction de manifester est exécutoire d’office et peut être notifié à tout moment à la personne soumise à cette interdiction, y compris au cours de la manifestation à laquelle il s’applique.
Enfin, les dispositions contestées permettent à l’autorité administrative d’interdire à une personne, dans certaines hypothèses, de participer à toute manifestation sur la voie publique sur l’ensemble du territoire national pendant une durée d’un mois.
4/ Une latitude d’appréciation excessive laissée à l’autorité administrative portant atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions
De tout ceci il résulte que les dispositions contestées laissent à l’autorité administrative une latitude d’appréciation excessive portant atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée.
Le Conseil constitutionnel estime donc que l’article 3 est contraire à la Constitution.
CONCLUSIONS
1/ L’on ne peut certes que se réjouir que l’article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations ait été censuré par le Conseil constitutionnel comme portant une atteinte excessive au droit d’expression collective des idées et des opinions, même si cette victoire n’est pas très franche et résulte d’un processus de raisonnement laborieux dans lequel la référence à l’ordre public a failli l’emporter, comme ce fut le cas pour les articles 2, 6 et 8 de la même loi.
2/ L’importance donnée par le Conseil constitutionnel, depuis le début des années 80, à la notion d’ordre public comme une notion autonome, souveraine et concurrente des libertés individuelles et publiques devrait enfin nous interroger car elle est bien éloignée du texte et de l’esprit de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
C’est, en effet – et la lecture de l’article 10 DDHC ne peut laisser aucun doute à ce sujet – chaque fois la loi qui, dans les différents champs sociaux et politiques où elle intervient, doit dire, explicitement ou implicitement, ce qu’est l’ordre public. C’est dire que la notion d’ordre public est une notion légale qui n’est donc pas supérieure à la loi et ne saurait indéfiniment s’y substituer en la recouvrant d’une chape de plomb, comme le fameux et triste manteau en recouvrait les prisonniers…
Ce manteau jurisprudentiel qu’on enfile sur la loi pour la maîtriser et la dominer est incontestablement discutable quant à son statut.
Il l’est encore davantage quand il enserre et corsette les libertés individuelles et publiques pour leur donner un contenu restrictif.
3/ Depuis longtemps, la critique est faite au Conseil Constitutionnel de n’être pas toujours convaincant dans ses solutions et argumentations. Invoquant le flou du contenu du bloc de constitutionnalité, Danielle LOCHAK, dans son article « Le Conseil constitutionnel, protecteur des libertés ? » [13], s’exprime ainsi : « On ne s’étonnera pas de ce que le Conseil constitutionnel, sur des principes insaisissables, ne réussisse à construire qu’une argumentation fragile » [14].
Mais les principes et leur insaisissabilité ne sont pas seuls en cause, comme d’ailleurs elle-même le montre par la suite de manière pertinente et implacable :
« Si l’argumentation juridique idéale-typique emprunte les voies du syllogisme, le caractère fuyant des règles entraîne ici la défection de la « majeure » et, par voie de conséquence, la fragilité du raisonnement syllogistique dans son ensemble. De sorte que les solutions auxquelles parvient le Conseil constitutionnel, même lorsqu’elles apparaissent opportunes au regard de la protection des libertés, n’emportent pas l’adhésion franche et entière au plan juridique. Parfois ce sont les prémisses qui sont contestables ; parfois c’est la conclusion qui ne s’impose pas à l’évidence : la décision finale, sans être incompatible avec la règle invoquée au départ, n’en apparaît pas comme la conséquence logique et nécessaire. On a de ce fait l’impression que la pétition de principe prend le pas sur le raisonnement déductif rigoureux. » [15]
Près de 30 ans après cet article, la décision du Conseil constitutionnel – que nous venons bien modestement essayer d’analyser et commenter ci-dessus – illustre parfaitement cette critique tout à fait fondée de la professeure Danièle LOCHAK.
Comme nous l’avons vu, en effet, le raisonnement du Conseil constitutionnel n’est pas toujours décisif ni encore moins convaincant lorsqu’il aboutit à rejeter l’inconstitutionnalité des articles 2, 6 et 8 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations. Le Conseil utilise le plus souvent l’argument d’autorité qui lui permet davantage d’affirmer au lieu de démontrer de manière rigoureuse la solution retenue. Ainsi, par exemple, la simple reprise du texte de loi contestée pour dire qu’il n’est pas contraire à la Constitution ne saurait être considérée comme la réponse juridictionnelle opposée aux députés et sénateurs.
Louis SAISI
Paris, le 27 novembre 2019
SIGLES ET ABRÉVIATIONS :
DDHC = Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789) ;
JORF = Journal Officiel de la République Française ;
LREM = La République En Marche.
NOTES
[1] Cf. sur ce site la prochaine publication de notre article suivant « NOAM CHOMSKY ET SON COMBAT POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ».
[2] En janvier 2015, à la suite de l’attentat contre Charlie Hebdo, le Traité sur la tolérance de Voltaire s’était pourtant placé au sommet des ventes de librairie un peu partout dans le monde, et notamment en France.
[3] Cf. JORF n°0086 du 11 avril 2019, texte n° 2
[4] La proposition de loi fut déposée au Sénat par M. RETAILLEAU et certains de ses collègues sénateurs, du groupe LR, le 14 juin 2018.
[5] Voir infra.
[6] Point que nous n’aborderons pas dans ce commentaire pour mieux nous concentrer sur les problèmes de fond.
[7] Cf. Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344.
[8] Ainsi, par exemple, la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l’espace public.
[9] Source : W Grenade GLI-F4 – Wikipédia.
[10] Cf. Journal officiel du 22 janvier 1981, page 308.
[11] Cf. Journal officiel du 27 juillet 1982, page 2422.
[12] Décision dans laquelle le Conseil constitutionnel affirme : « il appartient au législateur de concilier […] l’exercice de la liberté de communication telle qu’elle résulte de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme, avec […] les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels auquel ces modes de communication, par leur influence considérable, sont susceptibles de porter atteinte. »
[13] LOCHAK (Danièle) : « Le Conseil constitutionnel, protecteur des libertés ? », in Pouvoirs – Revue française d’études constitutionnelles et politiques Le Seuil, 1991, Le Conseil constitutionnel ; voir également HAL, archives ouvertes, https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01659362.
[14] Op. cit., pp. 42-43.
[15] Op. cit., pp. 45-46.
ANNEXE : Conseil constitutionnel n° 2019-780 DC du 4 avril 2019
Décision rendue à propos de la Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, sous le n° 2019-780 DC, le 13 mars 2019, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Philippe VIGIER, Joël AVIRAGNET, Mmes Ericka BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mmes Michèle VICTORY, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mmes Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, Huguette BELLO, MM. Moetai BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR, Gabriel SERVILLE, Jean-Félix ACQUAVIVA, Sylvain BRIAL, Michel CASTELLANI, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Charles de COURSON, Mme Jeanine DUBIÉ, MM. M’Jid EL GUERRAB, Olivier FALORNI, François-Michel LAMBERT, Paul MOLAC, Bertrand PANCHER, Mme Sylvia PINEL, M. François PUPPONI, Mmes Delphine BATHO, Frédérique DUMAS, MM. Sébastien NADOT et André VILLIERS, députés.
Il a également été saisi, le même jour, par M. Patrick KANNER, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. Claude BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Jacques BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN, Michel BOUTANT, Henri CABANEL, Thierry CARCENAC, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Jacques-Bernard MAGNER, Christian MANABLE, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, M. Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD, sénateurs.
Il a également été saisi, le même jour, par le Président de la République.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code de la sécurité intérieure ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 29 mars 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Les députés et les sénateurs requérants et le Président de la République défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations. Le Président de la République demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la liberté de manifester, à la liberté d’expression et à la liberté d’aller et venir des articles 2, 3 et 6 de cette loi. Les députés et sénateurs requérants contestent ses articles 3 et 6. Les députés contestent également sa procédure d’adoption et son article 2. Les sénateurs contestent en outre son article 8.
– Sur la procédure d’adoption de la loi :
- Les députés requérants reprochent au Gouvernement d’avoir déposé tardivement des amendements relatifs aux libertés fondamentales, lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale. Ils y voient une « forme de contournement » du droit d’amendement des députés, qui n’auraient pu réagir que par voie de sous-amendements, dans des délais très contraints. Ils critiquent également l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi à l’origine du texte déféré, alors qu’elle s’apparenterait à un « projet de loi déguisé ». Enfin, ils dénoncent l’absence de publicité d’un avis rendu par le Conseil d’État au Gouvernement, qui l’avait saisi de questions sur un amendement qu’il envisageait de présenter. Il résulterait de ces différents éléments une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
- Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
- En premier lieu, lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé quatre amendements. L’un d’entre eux, portant sur l’article 2 de la proposition de loi, devenu article 3, a été déposé après l’expiration du délai de dépôt opposable aux amendements des députés. Toutefois, cette circonstance n’a pas fait obstacle à l’exercice effectif par les députés de leur droit d’amendement, notamment sous forme de sous-amendements à l’amendement du Gouvernement.
- En deuxième lieu, l’article 39 de la Constitution et la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus n’imposent la présentation d’une étude d’impact et la consultation du Conseil d’État que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les propositions de loi.
- En dernier lieu, aucune disposition constitutionnelle n’impose au Gouvernement de rendre public l’avis qu’il sollicite du Conseil d’État sur l’un de ses projets d’amendement.
- Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire doit être écarté. La loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.
– Sur les normes de référence :
- Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d’expression et de communication, dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
- Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d’aller et venir, le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ainsi que le droit d’expression collective des idées et des opinions.
- Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Cette exigence s’impose non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions.
– Sur l’article 2 :
- L’article 2 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 78-2-5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d’une manifestation et à ses abords immédiats, à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
- Les députés requérants font valoir que ces dispositions méconnaîtraient les libertés d’aller et venir et de réunion ainsi que le droit à l’expression collective des idées et des opinions et le principe de proportionnalité des peines. Ils soutiennent notamment que ces opérations ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi dès lors qu’il existe déjà d’autres dispositions permettant de procéder à de telles opérations et que le périmètre sur lequel elles peuvent être conduites est très large.
- D’une part, les opérations d’inspection visuelle et de fouille de bagages ainsi que de visite de véhicules ne peuvent être réalisées que pour la recherche et la poursuite de l’infraction, prévue à l’article 431-10 du code pénal, de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme. Elles poursuivent donc un objectif de recherche des auteurs d’une infraction de nature à troubler gravement le déroulement d’une manifestation.
- D’autre part, les dispositions contestées prévoient que ces opérations se déroulent sur les lieux d’une manifestation et à ses abords immédiats et qu’elles sont autorisées par une réquisition écrite du procureur de la République. Il en résulte que ces opérations sont placées sous le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire qui en précise, dans sa réquisition, le lieu et la durée en fonction de ceux de la manifestation attendue. Ainsi, ces opérations ne peuvent viser que des lieux déterminés et des périodes de temps limitées.
- Enfin, il ressort des paragraphes II et III de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, auxquels renvoient les dispositions contestées, que tant les opérations d’inspection et de fouille des bagages que celles de visite de véhicules ne peuvent conduire à une immobilisation de l’intéressé que le temps strictement nécessaire à leur réalisation. Elles n’ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de restreindre l’accès à une manifestation ni d’en empêcher le déroulement.
- Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et n’a pas porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
- Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît ni le principe de proportionnalité des peines ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur l’article 3 :
- L’article 3 insère au sein du code de la sécurité intérieure un article L. 211-4-1 permettant à l’autorité administrative, sous certaines conditions, d’interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique. Le quatrième alinéa de cet article L. 211-4-1 lui permet également, dans certains cas, d’interdire à une personne de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois.
- Les députés requérants soutiennent que l’ensemble de cet article contreviendrait au droit à l’expression collective des idées et des opinions et à la liberté d’aller et venir et à celle de réunion. Ils estiment, d’une part, que cette mesure d’interdiction ne serait pas nécessaire, dès lors qu’une personne ayant suscité des troubles dans une manifestation peut déjà être sanctionnée pénalement par l’autorité judiciaire, le cas échéant par une interdiction de manifester. D’autre part, cette mesure serait disproportionnée compte tenu du champ des personnes auxquelles elle est susceptible de s’appliquer. Par ailleurs, en permettant qu’une mesure d’interdiction de manifester soit prononcée par l’autorité administrative, de manière préventive, le législateur aurait méconnu les droits de la défense et la présomption d’innocence. Cet article violerait enfin le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu’il autorise, dans certaines hypothèses, l’autorité administrative à notifier l’arrêté d’interdiction de manifester sans respecter un délai préalable de quarante-huit heures entre cette notification et la manifestation. En outre, le quatrième alinéa de l’article L. 211-4-1, qui permet le prononcé d’une interdiction d’une durée d’un mois, contreviendrait au principe de proportionnalité des peines.
- Les sénateurs requérants soutiennent également que l’ensemble de cet article méconnaîtrait le droit d’expression collective des idées et des opinions, dès lors qu’il permet à l’autorité administrative, en application de critères imprécis, de prononcer une interdiction de manifester pouvant présenter un caractère disproportionné. L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi serait également méconnu au motif que les conditions de prononcé d’une interdiction de manifester seraient imprécises et ambiguës. S’agissant du quatrième alinéa de l’article L. 211-4-1, les sénateurs font valoir que la possibilité pour le préfet de prononcer une interdiction de manifester sur l’ensemble du territoire pour une durée d’un mois renouvelable serait contraire au droit d’expression collective des idées et des opinions dans la mesure où cette interdiction pourrait s’appliquer à toute manifestation et être renouvelée indéfiniment. En outre, dès lors qu’une interdiction de manifester peut s’accompagner, pour la personne soumise à cette interdiction, d’une obligation de répondre au moment de la manifestation aux convocations de toute autorité désignée par le préfet, il en résulterait aussi une méconnaissance de la liberté d’aller et de venir.
- En application des dispositions contestées, l’autorité administrative peut, par un arrêté motivé, prononcer à l’encontre d’une personne constituant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. En prévoyant une telle mesure, le législateur a entendu prévenir la survenue de troubles lors de manifestations sur la voie publique et a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
- Ces dispositions confèrent ainsi à l’administration le pouvoir de priver une personne de son droit d’expression collective des idées et des opinions.
- Or, la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public nécessaire au prononcé de l’interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d’un « acte violent » soit d’« agissements » commis à l’occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n’a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l’intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l’occasion de cette manifestation. Il n’a pas davantage imposé que la manifestation visée par l’interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l’interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d’une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction.
- Par ailleurs, lorsqu’une manifestation sur la voie publique n’a pas fait l’objet d’une déclaration ou que cette déclaration a été tardive, l’arrêté d’interdiction de manifester est exécutoire d’office et peut être notifié à tout moment à la personne soumise à cette interdiction, y compris au cours de la manifestation à laquelle il s’applique.
- Enfin, les dispositions contestées permettent à l’autorité administrative d’interdire à une personne, dans certaines hypothèses, de participer à toute manifestation sur la voie publique sur l’ensemble du territoire national pendant une durée d’un mois.
- Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la portée de l’interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 3 est contraire à la Constitution.
– Sur l’article 6 :
- L’article 6 insère dans le code pénal un article 431-9-1 qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.
- Les députés et les sénateurs requérants dénoncent l’imprécision des éléments constitutifs de cette infraction, dont il résulterait une incompétence négative du législateur et une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Ils critiquent, à ce titre, la difficulté d’appréciation de la notion de dissimulation partielle du visage. Les députés requérants font par ailleurs valoir une caractérisation insuffisante de l’élément intentionnel, puisqu’il n’est pas exigé que la personne qui dissimule son visage participe effectivement aux troubles à l’ordre public dénoncés. En outre, selon eux, l’infraction méconnaîtrait également le principe de proportionnalité des peines. Enfin, les sénateurs requérants critiquent quant à eux l’imprécision de la circonstance de troubles à l’ordre public intervenant « à l’issue » d’une manifestation ou de celle de risque de commission de troubles à l’ordre public.
- En premier lieu, en retenant, comme élément constitutif de l’infraction, le fait de dissimuler volontairement une partie de son visage, le législateur a visé la circonstance dans laquelle une personne entend empêcher son identification, par l’occultation de certaines parties de son visage. Il ne s’est ainsi pas fondé sur une notion imprécise.
- En deuxième lieu, en visant les manifestations « au cours ou à l’issue » desquelles des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, le législateur a, d’une part, précisément défini la période pendant laquelle l’existence de troubles ou d’un risque de troubles doit être appréciée, qui commence dès le rassemblement des participants à la manifestation et se termine lorsqu’ils se sont tous dispersés. D’autre part, en faisant référence au risque de commission de troubles à l’ordre public, le législateur a entendu viser les situations dans lesquelles les risques de tels troubles sont manifestes.
- En dernier lieu, en écartant du champ de la répression la dissimulation du visage qui obéit à un motif légitime, le législateur a retenu une notion qui ne présente pas de caractère équivoque.
- Il résulte de tout ce qui précède que l’incrimination contestée ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines.
- L’article 431-9-1 du code pénal, qui ne méconnaît pas non plus le droit d’expression collective des idées et des opinions ou le principe de proportionnalité des peines ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur l’article 8 :
- L’article 8 introduit un 3° bis à l’article 138 du code de procédure pénale, qui dresse la liste des obligations auxquelles peut être soumise une personne placée sous contrôle judiciaire. Ce 3° bis y ajoute l’obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.
- Les sénateurs requérants reprochent à ces dispositions de permettre de prononcer une interdiction de manifester applicable sur tout le territoire national et sans limitation de durée autre que celle du placement sous contrôle judiciaire. Ils en concluent à la méconnaissance de la liberté d’aller et de venir, du droit d’expression collective des idées et des opinions et de l’article 9 de la Déclaration de 1789, qui prohibe « toute rigueur qui ne serait pas nécessaire ».
- En premier lieu, en application du premier alinéa de l’article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné par le juge qu’à l’encontre d’une personne qui encourt une peine d’emprisonnement.
- En deuxième lieu, le contrôle judiciaire ne peut être prononcé qu’en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté. Il revient au juge de proportionner l’interdiction de manifester prévue par les dispositions contestées aux exigences justifiant le placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cadre, il lui appartient en particulier de déterminer les lieux concernés par une telle interdiction.
- En dernier lieu, la personne soumise à l’interdiction de manifester peut à tout moment demander la mainlevée du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 140 du code de procédure pénale. Lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire d’une personne en instance de jugement convoquée par procès-verbal ou soumise aux procédures de comparution à délai différé ou immédiate, la durée de la mesure est limitée par le délai de jugement lui-même.
- Il résulte de tout ce qui précède qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et n’a pas porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Pour les mêmes motifs, ces dispositions ne soumettent pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire.
- Par conséquent, le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur les autres dispositions :
- Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – L’article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations est contraire à la Constitution.
Article 2. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi déférée ;
l’article 431-9-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi déférée ;
le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la loi déférée.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 avril 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d’ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 4 avril 2019.
JORF n°0086 du 11 avril 2019, texte n° 2