Guerre et paix…
Il arrive parfois que nos « démocraties », déjà bien imparfaites [1], s’estimant en danger, fassent sonner la trompette guerrière, et développent une série de mesures pour faire face à un péril présenté comme imminent et mortel pour elle, et surtout pour leurs citoyens qu’elles ont le devoir de protéger.
L’état d’urgence – prorogé déjà six fois depuis sa première application en novembre 2015 -, l’opération « Sentinelle » et l’opération « Barkhane » au Mali, et plus largement au Sahel, ont été mis en place pour conjurer le péril terroriste tant intérieur qu’« extérieur » [2].
Il y a lieu de rappeler ici sommairement que l’état d’urgence a été institué par la loi N° 55-385 du 3 avril du 3 avril 1955 [3] pour faire face aux événements alors liés à la guerre d’Algérie [4].
L’état d’urgence est en vigueur depuis le 14 novembre 2015 en raison des risques d’attentats en France, après ceux qui avaient déjà ensanglanté notre pays à partir de mars 2012 [5] ; prorogé plusieurs fois, sa fin est actuellement normalement prévue au 1er novembre 2017.
Les principaux effets de l’état d’urgence sont de permettre le transfert à l’autorité administrative des prérogatives normalement dévolues au juge judiciaire gardien de la liberté individuelle aux termes mêmes de l’article 66 de notre Constitution. Il s’agit donc d’interventions de l’autorité administrative ayant pour but la limitation de certaines libertés individuelles qui nécessitent habituellement l’intervention du juge judiciaire, comme les mesures d’assignation à résidence ou les perquisitions effectuées au domicile des intéressés.
Le Conseil constitutionnel – dans sa décision N° 2015-527 du 22 décembre 2015, rendue sur QPC [6] après sa propre saisine par le Conseil d’Etat, relative à la constitutionnalité de l’article 6 de la loi N° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, modifiée par la loi N° 2015-1501 du 20 novembre 2015 – a déclaré sa conformité à la Constitution.
Nous aborderons ici le dispositif de sécurité mis en place à l’intérieur de l’hexagone (plans Vigipirate et opération Sentinelle) (I) et nous analyserons, plus loin, dans un autre article, l’’opération Barkhane au Mali et au Sahel (II).
——-
Avec un peu de recul, que peut-on penser de ces dispositifs? Sont-ils efficaces et surtout convaincants pour justifier que s’instaure dans notre pays un climat de peur développant des réflexes sécuritaires chez nos concitoyens attisés par nos gouvernants au point que notre ordre public républicain – fondé sur le principe de la légalité administrative et juridictionnelle – s’efface progressivement au profit de mesures exceptionnelles et dérogatoires au droit commun qui risquent de nous habituer, imperceptiblement et à la longue, à la mise entre parenthèses des libertés publiques et de nous faire faire oublier le respect de l’état de droit.
Que penser également de ce concept de « guerre » [7] (guerre intérieure) forgé fort opportunément et un peu trop rapidement pas nos gouvernants, depuis 2012, pour justifier des opérations de lutte contre le terrorisme?
I/ L’opération « Sentinelle »…

L’opération « Sentinelle » vise à assurer la sécurité des Français et des étrangers vivant à l’intérieur de l’hexagone.
Selon le Ministère de la Défense nationale, « dans le cadre de l’opération Sentinelle lancée en janvier 2015, 10 000 soldats (dont 3000 en réserve) sont engagés sur le territoire national pour défendre et protéger les Français. » [8] Depuis cette date, l’opération « Sentinelle » est une mission de protection associée au plan Vigipirate lancé bien antérieurement, à partir de 1978, après les attentats d’Orly (20 mai) et la prise d’otages à l’ambassade d’Irak à Paris (31 juillet). Vigipirate, qui se situe dans le champ de la vigilance, de la prévention et de la protection contre la menace terroriste, mobilise l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs, les citoyens… Il s’agit d’un dispositif permanent qui s’applique en France et à l’étranger, et à tous les grands domaines d’activité de la société (les transports, la santé, l’alimentation, les réseaux d’énergie, la sécurité des systèmes d’information).
Depuis 2016, trois niveaux d’alerte sont prévus : le premier, qui repose sur une veille permanente en termes de vigilance et de sécurité, s’appuie sur la mise en place d’un socle d’une centaine de mesures de sécurité comme, par exemple, la vérification de pièces d’identité ; le second, qui correspond à un niveau de menace plus élevé dit « sécurité renforcée/risque d’attentat », se caractérise par la prise de mesures comme la mise en place d’opérations de filtrage et de fouilles s’intégrant elles-mêmes parmi toute une série de plus de 200 mesures additionnelles ; enfin, le troisième niveau, le plus élevé, qui correspond à celui d’un danger immédiat dit « urgence attentat », se veut une riposte à une situation de crise dès lors que les services de l’État estiment qu’un attentat a une forte probabilité d’être commis dans un bref délai, ou juste après sa survenue si une réplique est possible.
Il s’agit là de parer à la menace terroriste et de réagir pour y faire face. Le caractère réputé permanent et lancinant de celle-ci doit-il nous conduire à considérer que nous serions en « état de guerre » comme veulent le faire accréditer nos gouvernants?
Sur le registre de l’escalade et de l’outrance verbale, en 2015, le Premier Ministre, Manuel Valls, allait encore plus loin, n’hésitant pas à qualifier, le 28 juin 2015, lors de l’émission « Le Grand rendez-vous d’Europe 1 », la réponse française au terrorisme de « guerre de civilisation » contre les « barbares » [9].
Or, comme le notait, dès le lendemain, Blaise DUFAL [10], historien à l’EHESS et membre du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire, l’emploi du terme « civilisation » est très connoté, historiquement et politiquement.
Il note qu’il « apparaît pour la première fois durant le 18e siècle, désignant la conception du monde portée notamment par les Lumières françaises. C’est un terme qui définit ce que prétendent être les Lumières, voulant donner aux valeurs de l’Europe occidentale une portée universelle. Au cours du 19e siècle, le terme connaît un grand succès, notamment dans le discours civilisationnel et civilisateur de l’Occident colonisateur, qui se positionne par ce terme au-dessus du reste du monde. En France, on peut trouver de nombreux emplois de cette notion chez les politiciens de la IIIème République, comme Jules Ferry, lequel encourageait à apporter la civilisation au continent africain. Au cours du 19e siècle, le terme de civilisation est régulièrement associé aux théories racialistes et à la défense de l’héritage chrétien en Europe. »
Mais, surtout, ce qui pose, selon lui, problème, « c’est que le terme « civilisation » n’est pas un concept scientifique. Il ne décrit pas une réalité. Il impose une vision du monde hiérarchisante et discriminante. La plupart des anthropologues ont d’ailleurs cessé de l’utiliser depuis la seconde guerre mondiale, lui préférant celui de société ou de culture. C’est une notion qui ne devrait plus être utilisée dans le débat public, car elle n’explique rien. Ce terme a une apparence d’évidence, alors que si on analyse ses usages, on se rend compte que ce mot ne définit pas précisément un phénomène historique ou culturel. Cette notion désigne le point de vue de celui qui parle, elle stigmatise l’autre comme étant inférieur, non civilisé. Ce terme désigne l’autre comme le méchant, le barbare. Utiliser ce terme aujourd’hui témoigne d’une vision du monde scientifiquement dépassée, désormais absurde, et politiquement extrêmement problématique. »
I/ Au sein même de l’hexagone, la France est-elle en guerre ?
À l’instar de Georges BUSH, après les attentats qui ont ensanglanté Paris dans la nuit du 13 novembre 2015, le Premier Ministre, Manuel VALLS, déclarait le 14 novembre 2015 sur le plateau de TF1 :
« … nous sommes en guerre », une guerre qui pourrait « prendre des mois et peut-être même des années », affirmant qu’elle « nécessite des moyens exceptionnels pour la mener ».
 Mais si, oui, nous étions en guerre, ce serait contre qui ? Où est l’ennemi ? Serions-nous un pays occupé à notre insu?
Mais si, oui, nous étions en guerre, ce serait contre qui ? Où est l’ennemi ? Serions-nous un pays occupé à notre insu?
La réponse à toutes ces questions est « NON », bien évidemment !
Depuis trop longtemps, nos gouvernants [11] utilisent, à la légère, le concept de « guerre » pour désigner les tueries et actes terroristes qui ensanglantent notre pays et provoquent la réprobation et l’indignation légitimes de nos concitoyens excédés par tant de barbarie sur notre sol.
Mais nos gouvernants ne peuvent pas ne pas savoir qu’il ne s’agit pas d’actes de guerre et que nous ne sommes pas « en guerre »…
En effet, les attentats terroristes commis dans l’hexagone, pour aussi terribles et choquants qu’ils soient, ne sont pas des « actes de guerre », mais des actes de terrorisme. Nous n’affrontons pas une armée appartenant à un Etat précis qui occuperait à notre insu notre territoire. Le terrorisme est, par essence, toujours clandestin et masqué, et il n’obéit pas aux « lois de la guerre ». Les terroristes ne sont pas des soldats au service d’un Etat ou d’une nation, ce sont des civils qui commettent des actes barbares eux-mêmes condamnés par les lois de la guerre car ils s’en prennent à des populations civiles sans armes qui sont elles-mêmes protégées par les conventions relatives aux actes de guerre.
A/ Les tentatives pour définir le terrorisme ne sont pas nouvelles tant sa définition reste problématique [12]
Ainsi la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, adoptée par la Société des Nations (SDN) le 6 novembre 1937, fut la première tentative de codification d’une définition du terrorisme.
Les difficultés ne furent pas mineures et l’on s’orienta vers une définition générale du crime de terrorisme avec une énumération limitative d’actes qualifiés de « terroristes ».
Ainsi, la Convention de 1937 définissait le terrorisme comme des « faits criminels dirigés contre un État et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public ».
Les articles 2 et 3 du Traité incriminaient des actes spécifiques ou des modalités de participation, voire de complicité à ces actes.
Mais tant la définition générale que les incriminations spécifiques firent l’objet de sérieuses critiques.
Après la seconde guerre mondiale, avec la création de l’ONU, lors de ses travaux sur le projet de Code de Crime contre la paix et la sécurité de l’Humanité, la Commission du Droit International (CDI) [13], avait dès 1954 abordé le problème de la définition du terrorisme.
La CDI, reprenant le Traité de Genève sur le terrorisme de 1937, centra son travail sur une définition générale du terrorisme ainsi que l’incrimination d’actes spécifiques. Mais il s’agissait de terrorisme d’État, ou les sujets actifs et passifs de l’infraction étaient des États.
Ainsi, dans la version de 1990 du « projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité », le crime de « terrorisme international » y était incriminé et défini de la façon suivante :
« Tout individu qui en qualité d ‘agent ou de représentant d ‘un État commet ou ordonne que soit commis l ‘un quelconque des actes ci- après – entreprendre, organiser, aider, financer, encourager ou tolérer des actes contre un autre État, visant des personnes ou des biens et de nature à provoquer la terreur parmi des dirigeants, des groupes de personnes ou la population – sera, une fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à… ].
Mais cette définition, en 1995, ne déboucha pas sur un consensus au sein même de la Commission. C’est ainsi que la version « du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité » de 1996 n’incorpora pas le terrorisme international comme crime spécifique et autonome.
Jusqu’en 1999, le Conseil de Sécurité a abordé la question du terrorisme essentiellement sous la forme de sanctions politiques, diplomatiques, économiques ou militaires à l’encontre d’États accusés de soutenir des « groupes terroristes ».
Ce furent les attentats du 7 août 1998 contre les ambassades américaines de Nairobi et Dar el Salaam, déjà attribués à Al Quaïda, qui déterminèrent la prise de sanctions plus sévères à l’encontre de l’AFGHANISTAN des Talibans (Résolutions 1189/98, 1267/99 et 1333/00). En effet, jusqu’en 1999, le Conseil de Sécurité de l’ONU avait abordé la question du terrorisme essentiellement sous la forme de sanctions politiques, diplomatiques, économiques ou militaires à l’encontre d’États accusés de soutenir des « groupes terroristes ».
En octobre 1999, la résolution 1269 devait inaugurer une approche plus globale du terrorisme international, en particulier dans son paragraphe 4, inspiré par les Russes, désireux d’obtenir une prise de position plus forte du Conseil de Sécurité et de lancer une coopération accrue des États dans la lutte antiterroriste.
Mais c’est surtout la résolution 1368, adoptée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center, à Manhattan (New-York) et contre le Pentagone, siège du Département de la Défense, à Washington, qui marqua un véritable tournant juridique.
En effet, les actes de terrorisme international sont qualifiés, pour la première fois, de façon générique de « menaces à la paix et à la sécurité internationales ».
Antérieurement une telle qualification ne pouvait l’être qu’au cas par cas.
Mais, en amont, le problème n’était toujours pas résolu quant à la définition des actes pouvant être considérés comme terroristes.
En septembre 2005, lors de la réunion à New York de quelque 150 dirigeants politiques du monde entier pour faire le point sur les progrès accomplis depuis l’adoption par tous les États Membres, le 15 septembre 2000, de la Déclaration du Millénaire avait été proposé l’adoption d’un Rapport intitulé « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et droits de l’homme pour tous« . Le Secrétaire Général des Nations-Unies avait invité les États à adopter une stratégie globale pour lutter contre le terrorisme, ce qui passait, en premier lieu, par la nécessité de définir le terrorisme. Le Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi ANNAN avait alors invité les États à se rallier à la définition suivante, fruit du travail d’un groupe de personnalités de haut niveau et du secrétaire général de l’ONU lui-même : « toute action […] qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque le but d’un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d’intimider une population, ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à s’en abstenir » [14].
Mais aucun consensus sur la définition du terrorisme n’a été atteint lors de ce sommet de 2005, car si de nombreux États préconisaient une condamnation ferme de toutes les formes de violence contre des civils innocents, certains États islamiques voulaient que soit incluse une référence spéciale aux groupes de libération et au droit de résister à une occupation étrangère…
B/ Les conventions internationales de Genève
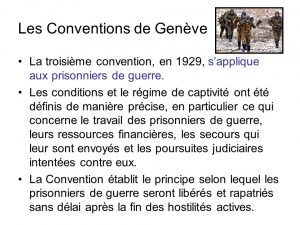
Les conventions internationales de Genève protègent à la fois les prisonniers de guerre (1929) et les populations civiles (1949).
La troisième convention, en 1929, s’applique aux prisonniers de guerre. Les conditions et le régime de captivité ont été définis de manière précise, en particulier ce qui concerne le travail des prisonniers de guerre, leurs ressources financières, les secours qui leur sont envoyés et les poursuites judiciaires intentées contre eux. La Convention établit le principe selon lequel les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives.
 Rappelons, en effet, que la protection des populations civiles découle de la Convention de La Haye de 1907, elle-même reprise par la Convention de Genève relative à la protection des populations civiles en temps de guerre (Convention IV du 12 août 1949) qui dispose notamment :
Rappelons, en effet, que la protection des populations civiles découle de la Convention de La Haye de 1907, elle-même reprise par la Convention de Genève relative à la protection des populations civiles en temps de guerre (Convention IV du 12 août 1949) qui dispose notamment :
1 Principe fondamental et règles fondamentales
« Le principe fondamental sur lequel repose le droit des conflits armés s’exprime comme suit : Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité. De ce principe découlent deux règles fondamentales. La première interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. La seconde impose aux Parties au conflit, en vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, de faire en tout temps la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, de ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. » [P. I, 35, 48]
Une déclaration de guerre entre deux (ou plusieurs) États belligérants entraîne ipso facto l’application des lois de la guerre.
II/ L’adoption d’une série de lois destinées à permettre une lutte se voulant plus efficiente contre le terrorisme
Depuis 2012, pas moins de 5 lois ont déjà été adoptées pour lutter contre le terrorisme en France et une sixième est en gestation…
Déjà, le 21 décembre 2012, l’arsenal juridique français avait été renforcé par une loi du même jour permettant de juger des ressortissants Français pour leur participation à des infractions terroristes commises à l’étranger. Cette loi, conjuguée à l’action des services de police et de renseignement, a déjà permis d’ouvrir près de 300 procédures judiciaires à l’encontre de plus de 1 200 ressortissants impliqués dans des filières djihadistes.
 Mais le Gouvernement estimait qu’il était nécessaire de devoir prendre en compte les évolutions inquiétantes concernant la nature des actes et le comportement des auteurs. C’est ainsi que depuis 2013, trois lois ont permis d’adapter le cadre législatif français aux nouvelles formes de menace. Les textes adoptés ont à la fois aggravé les mesures répressives, étendu l’application du code pénal aux infractions de nature terroriste commises à l’étranger par les ressortissants français ou par des étrangers résidant habituellement en France, introduit dans le droit français des mesures de police administrative nouvelles en matière d’accès ou de sortie du territoire ou sur les contenus illicites des sites Internet.
Mais le Gouvernement estimait qu’il était nécessaire de devoir prendre en compte les évolutions inquiétantes concernant la nature des actes et le comportement des auteurs. C’est ainsi que depuis 2013, trois lois ont permis d’adapter le cadre législatif français aux nouvelles formes de menace. Les textes adoptés ont à la fois aggravé les mesures répressives, étendu l’application du code pénal aux infractions de nature terroriste commises à l’étranger par les ressortissants français ou par des étrangers résidant habituellement en France, introduit dans le droit français des mesures de police administrative nouvelles en matière d’accès ou de sortie du territoire ou sur les contenus illicites des sites Internet.
Après les attaques terroristes du 13 novembre 2015, le président de la République et le Gouvernement, ont décidé d’instaurer l’état d’urgence pour trois mois et ont présenté un nouveau projet de loi, destiné à réformer la procédure pénale en vue de mieux lutter contre le crime organisé. Il a été adopté définitivement le 25 mai 2016, et la loi a été promulguée le 3 juin.
III/ Les plans d’action
Le Gouvernement a mis aussi en place, à partir d’avril 2014, une série de plans d’actions contre les filières djihadistes et la radicalisation. En juillet 2016, on recensait plus de 5 000 signalements de radicalisation effectués depuis la création du numéro vert, qui ont permis d’empêcher de nombreux départs. Tous font l’objet d’un suivi spécifique.
Actuellement, 2 600 jeunes sont suivis, et le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation suit également 800 familles en France. Depuis 2015, a été également constitué un fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Cette base de données rassemble les noms et coordonnées de toutes les personnes considérées comme pouvant basculer dans la violence. À ce jour, ce fichier compte pas moins de 16 000 noms dont environ le quart dit « objectif » (soit 4 000 personnes) est suivi par les services de renseignements [15].
Le 9 mai 2016, un plan exhaustif de 80 mesures pour lutter contre la radicalisation et contre le terrorisme a été présenté, avec notamment la création d’un centre de réinsertion et de citoyenneté par région d’ici fin 2017. Le premier Centre de réinsertion et de citoyenneté avait été ouvert le 1er septembre 2016 à Pontourny, situé à Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire).
Il était le seul centre français de « déradicalisation » qui visait un public « volontaire » et « sans condamnations pour faits de terrorisme ». Ses résultats n’ont pas été à la hauteur des grandes espérances qu’il avait fait naître et, le 28 juillet 2017, il a dû fermer ses portes moins d’une année après sa création. La Place Beauveau a annoncé la fermeture du centre avec ces commentaires : « Malgré la compétence, la détermination et l’investissement des personnels du centre (…) l’expérience ne s’est pas révélé concluante ». Ce dispositif n’a jamais rencontré le public recherché et tournait à vide depuis février 2017 : conçu pour recevoir 25 personnes, il n’en a jamais compté plus de 9 et aucun de ces jeunes n’a suivi le programme jusqu’ à son terme.
La fermeture de ce centre a été compensé par l’annonce d’une réflexion sur la création de « structures de petite taille » conçues pour des personnes déjà placées sous contrôle judiciaire ou faisant l’objet d’un aménagement de peine. Cette annonce correspond à une promesse de campagne de l’actuel président de la République. Une réflexion est en cours depuis de nombreux mois sur la prise en charge d’un public « intermédiaire » parmi les personnes radicalisées : celles mises en examen mais non incarcérées faute de charges suffisantes à leur encontre ou bénéficiant d’un sursis avec mise à l’épreuve. En juin 2017, il y avait une centaine de personnes correspondant à cette situation.
IV/ AU PLAN DU DROIT, LA SPIRALE REPRESSIVE
Dans son discours au Congrès du 3 juillet 2017, le Président MACRON a voulu s’orienter, à son tour, dans le sens accru d’une nouvelle modification du droit existant permettant aux autorités administratives d’intervenir de manière préventive – modifications qui avaient déjà été opérées de nombreuses fois – plutôt que de proroger d’autres énièmes fois la durée de l’état d’urgence.
C’est ainsi qu’a été déposé au Sénat le 22 juin 2017 un projet de loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » présenté par Gérard COLLOMB, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur.

Mention obligatoire « photo Sénat »
Dans l’exposé des motifs du projet, le Gouvernement a mis en avant le fait que l’état d’urgence – sous lequel la France vit depuis le 14 novembre 2015 à la suite de prorogations par périodes successives compte tenu de la persistance du « péril imminent » – est un « régime temporaire justifié par des circonstances exceptionnelles ». Il doit donc céder la place à « de nouveaux instruments permanents de prévention et de lutte contre le terrorisme » pour mieux faire « face au caractère durable des menaces liées aux nouvelles formes de terrorisme, en réservant les outils de l’état d’urgence à une situation exceptionnelle ».
Ce projet de loi en cours de gestation comporte quatre volets :
1°) un ensemble de dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme en créant dans le droit commun les outils adaptés à la lutte anti-terroriste contemporaine (chapitre Ier) ;
2°) des mesures relatives aux techniques de renseignement (chapitre II) ;
3°) des dispositions relatives aux contrôles dans les zones frontalières (chapitre III) ;
4°) des dispositions adaptant les mesures du projet de loi aux outre-mer (chapitre IV).
Sur le rapport de son rapporteur (Michel MERCIER, sénateur du Rhône), la Commission des lois du Sénat n’a pas remis en cause l’économie du dispositif gouvernemental mais d’une part a limité, dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2021, l’application des dispositions permettant de prendre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et de procéder à des visites domiciliaires et des saisies avec une évaluation annuelle de leur utilité ; d’autre part a circonscrit l’usage des périmètres de protection et renforcé les garanties relatives à la vie privée, professionnelle et familiale des personnes contrôlées au sein de ces périmètres.
Le projet de loi a ensuite été adopté par le Sénat le 18 juillet 2017 par 229 voix contre 106.
Lors de l’examen du projet au Sénat, ce sont surtout les dispositions du chapitre I du projet renforçant la prévention d’actes de terrorisme en créant dans le droit commun les outils adaptés à la lutte anti-terroriste contemporaine qui ont fait l’objet des plus vives critiques.
En effet, le côté paradoxal de ce projet de loi (adopté par le Sénat) est évident : en refusant des prorogations en cascade de l’état d’urgence comme son prédécesseur, le Gouvernement veut se donner une image libérale. Mais cette posture ne saurait faire illusion, car c’est plutôt pour n’être pas contraint par la nécessité de demander la prorogation de l’état d’urgence que l’Exécutif (Président/Premier Ministre) préfère disposer d’une loi codifiant le dispositif de l’état d’urgence pour le faire passer dans le droit commun de manière permanente, ce qui ne limite plus son action dans la durée et l’affranchit du contrôle du Parlement. C’est dire que le changement du droit, dans le sens de prérogatives accrues de l’autorité administrative au détriment du juge des libertés, n’est plus circonstanciel et limité dans le temps mais s’étire davantage, dans le temps, sinon de manière définitive (comme le voulait initialement le Gouvernement), au moins sur une durée de 4 ans, à supposer, ensuite, que ces mesures ne soient pas elles-mêmes prorogées à leur tour…
C’est ainsi que lors des débats au Sénat [16] sur le projet de loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », un certain nombre de sénateurs de l’opposition ont d’ailleurs vivement critiqué le texte du Gouvernement en faisant valoir qu’on « maintenait l’état d’urgence sans l’état d’urgence, l’état d’exception dans le droit commun », ce qui n’était guère crédible [17].
« Nous n’avons cessé, au cours du précédent quinquennat, de renforcer notre arsenal pénal ; il est désormais possible de sanctionner lourdement ceux qui envisageraient des actes terroristes. Les articles 3 et 4 sont de pur affichage, et risquent en outre d’être contraires à la Convention européenne des droits de l’homme, voire à la Constitution. Malgré l’intérêt de certains articles, nous ne pouvons voter ce texte. » [18]
D’autres ont relevé l’avènement d’une « société du soupçon permanent où préfets et ministre de l’intérieur remplacent les juges. Une fois la loi promulguée, nul besoin de l’état d’urgence : ce sera notre droit commun » [19].
D’autres, encore, ont relevé qu’ « Introduire dans le droit commun des dispositions issues de l’état d’urgence, c’est le contaminer, l’intoxiquer ; et c’est mettre à mal nos libertés fondamentales.» [20].
Conclusions
À l’unisson de toute la presse, nous pourrions dire, désolés et éplorés, que la France est aujourd’hui le troisième pays au monde le plus touché par le terrorisme islamiste, qu’avec plus de 230 morts recensés ces dernières années, l’Hexagone est en effet passé devant des pays comme l’AFGHANISTAN ou la SOMALIE, que la question lancinante que se posent de plus en plus nos compatriotes, au lendemain de l’attentat de Nice, est : mais pourquoi donc la France est-elle autant touchée? Etc.
Il est probable que nous payons le prix de notre engagement à la fois dans la coalition internationale en Irak et en Syrie, ainsi que nos opérations anti-terroristes au Mali sur lesquelles nous reviendrons sur ce site (II).
Pourtant tout un arsenal de mesures nouvelles ont été mises en place de 2012 à 2017. Leur nombre même nous invite à nous poser la question de leur pertinence et efficience, malgré les résultats annoncés.
Certes, il ne s’agit pas ici de verser dans une censure rapide de nos gouvernants d’hier et d’aujourd’hui car nous sommes bien conscients que la lutte (et non la guerre!) contre le terrorisme n’est pas facile à conduire et, bien légitimement, le premier devoir de tout gouvernement républicain est de garantir la « sûreté » des citoyens qui est inscrite, en tant que « droit naturel et imprescriptible de l’homme », dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (article 2), et donc de protéger les nationaux français et, en même temps, toute les populations étrangères appréciant notre pays et heureuses d’avoir choisi et de vivre sur le sol de la France.
Mais cette difficulté constitue précisément une raison supplémentaire faisant obligation à nos gouvernants d’évaluer de manière méthodique, critique et systématique l’existant et d’en faire le bilan. Ce même impératif commande également de développer, en amont, une réflexion sur les causes du terrorisme en France avec la mise en place rapide d’Etats Généraux s’emparant de la question sous tous ses angles (et pas seulement sous le seul angle sécuritaire et répressif) ainsi que l’élaboration d’un plan éducatif de prévention dès l’école.
En effet, la riposte par la force et le renseignement, pour aussi utile et nécessaire qu’elle soit, ne suffit pas toujours car pour combattre un mal, il faut en comprendre les causes, les racines profondes. Or nous disposons déjà, aujourd’hui, de travaux universitaires de premier plan que nos politiques seraient bien inspirés de s’approprier au lieu de vitupérer sans cesse, comme sont tentés de le faire certains, sans engager pour autant ni les réflexions nouvelles ni encore moins amorcer des perspectives de sortie de notre cauchemar collectif.
En effet, aujourd’hui, de nombreux travaux de recherche ont été consacrés à cette question [21], parfois même sous l’égide du Ministère de la Justice [22], ce qui est tout à son honneur.
Ainsi en est-il, entre autres, des travaux de recherche de Farhad KHOSROKHAVAR [23].
L’auteur, iranien, est directeur de recherche à l’EHESS et chercheur au CADIS. Ses thèmes de recherche portent sur l’Islam en France[24].
Dans son ouvrage, publié en 2014, sous le titre, La radicalisation, il analyse le processus par lequel des citoyens français épousent l’islam radical et versent parfois dans le terrorisme. Il nous montre que la radicalisation est une manifestation de violence, dont les causes qui l’alimentent sont assez habituelles et classiques : les ingrédients en sont la misère et l’humiliation, que celles-ci soit le fait de l’État ou, de manière plus impersonnelle et moins visible, de l’économie.
 Le djiadisme, en tant que phénomène de violence, n’est pas propre à l’Islam car bien d’autres phénomènes de violence ayant donné naissance à des formes de contestation aussi radicales se sont développés à travers l’histoire, notamment, pour ne rester que dans le vingtième siècle écoulé, dans les années 60 et 70, en Europe, dans les milieux d’extrême gauche. Mais l’on pourrait remonter plus haut, dans le temps, et notamment au siècle précédent, si l’on songe à la vague d’attentats anarchistes de la fin du XIXème siècle en France [25] mais aussi un peu partout dans le monde.
Le djiadisme, en tant que phénomène de violence, n’est pas propre à l’Islam car bien d’autres phénomènes de violence ayant donné naissance à des formes de contestation aussi radicales se sont développés à travers l’histoire, notamment, pour ne rester que dans le vingtième siècle écoulé, dans les années 60 et 70, en Europe, dans les milieux d’extrême gauche. Mais l’on pourrait remonter plus haut, dans le temps, et notamment au siècle précédent, si l’on songe à la vague d’attentats anarchistes de la fin du XIXème siècle en France [25] mais aussi un peu partout dans le monde.
La question est alors de s’interroger sur le sens de l’action d’un individu ou d »un groupe d’individus qui adoptent la violence politique.
Sous cet angle les motivations collectives des faits qui plongent dans l’histoire se télescopent avec leurs racines plus subjectives et psychologiques, le vécu des terroristes eux-mêmes.
C’est vrai pour le djiadisme d’aujourd’hui, mais ça l’était déjà pour l’anarchisme d’hier : le recours à la violence est la signature d’actes auxquels l’on recourt lorsque les terroristes estiment qu’il n’y plus d’espoir, plus d’issue.
Dès lors, il y aurait un lien de filiation – d’ailleurs non revendiqué par les djiadistes eux-mêmes – entre les mouvements d’extrême-gauche des années 60-70 et le djiadisme d’aujourd’hui, avec toutefois, nous semble-t-il, le fait qu’au moins au niveau de l’expression politique, si l’on sort de la sphère religieuse proprement dite, le djiadisme ne semble pas développer une aspiration à changer le monde, contrairement aux utopies anarchistes, communistes ou gauchistes.
Ainsi le renouveau djihadiste serait, selon l’auteur, « la conséquence du cumul de l’humiliation arabe et musulmane et de la permanence des autocraties. » La prise en charge politique de la misère morale et sociale des plus déshérités de la terre n’existe plus aujourd’hui dans les pays occidentaux avec la crise des partis de gauche née de la disparition des idéologies et des utopies de justice sociale susceptibles de faire rêver les jeunes – et les moins jeunes – à des lendemains meilleurs. Ceci explique que, à l’instar de ce qui se passe dans les autocraties arabe et musulmane – où le djiadisme a pris racine -, la misère et l’humiliation des banlieues génèrent parallèlement un vivier extrémiste vivant et se développant dans les banlieues de l’Europe (Paris, Londres, Bruxelles, etc.). Dès lors, comme le note Alexandre DORNA, « le ressentiment et le manque d’avenir sont trop forts pour attirer la jeunesse arabo-musulmane dans le camp de la raison » [26].
Les extrémistes islamistes, prêcheurs de haine, exploitent les failles et les carences du modèle occidental en empruntant ses propres technologies les plus avancées, via Internet, pour développer leur radicalité et l’appel au djihad.
Ils ont bien perçu combien l’individualisme exacerbé actuel érode les fondements de l’Occident sur fond de globalisation des échanges et de l’abolition des frontières : le modèle occidental se perd dans le mercantilisme et s’identifie de plus en plus à sa sphère économique, avec le développement des échanges marchands (OMC, projet de TAFTA avec les USA actuellement mis en berne, projet CETA de libre échange avec le Canada, etc.).
Or si cela peut engendrer, note Farhad KHOSROKHAVAR, le développement d’engagements « romantiques » prenant en charge de « nobles causes » (l’on pense notamment aux ONG et à l’attrait puissant qu’exerce sur les jeunes toutes les causes humanitaires) l’auteur redoute que de tels engagements puissent, un jour prochain, devenir eux-mêmes sur-radicalisés.
C’est dire que l’absence d’un projet politique qui soit susceptible, dans une démocratie, de rassembler dans un élan une nation éprise de justice et d’égalité – comme le fut le programme du Conseil National de la Résistance au lendemain de la Libération – doit nous interpeller car il risque toujours de générer, à sa périphérie (c’est-à-dire en dehors même des partis traditionnels) des ferments de contestation radicale susceptibles de miner ses fondements. Et compte tenu de la situation politique, économique et sociale des pays membres de l’Union européenne, la contestation risque, demain, de venir de partis d’extrême droite prônant des modèles sinon plus ou moins fascisants, au moins plus ou moins dictatoriaux…
C’est dire que la nature des dangers est toujours politique comme le sont leurs causes elles-mêmes.
Louis SAISI
Paris, le 7 août 2017
NOTES
[1] Sa composante centrale, qui est aussi, rappelons-le, le principe de notre République (article 2 C) – « gouvernement du peuple pour le peuple et pour le peuple » – est souvent absente dans les choix politiques de nos gouvernants, d’où la crise de représentation qui peut s’ensuivre, comme c’est le cas en France actuellement.
[2] Encore que la notion de danger « extérieur » soit plus difficile à appréhender quant à sa réalité.
[3] La loi du 3 avril 1955 fut adoptée malgré l’opposition de 255 députés de gauche.
[4] L’état d’urgence a été appliqué trois fois durant la guerre d’Algérie. Il fut ensuite appliqué trois fois en outre-mer durant les années 1980, puis en 2005, en raison des émeutes dans les banlieues.
[5] Tueries de Toulouse et de Montauban perpétrées par Mohammed MERAH les 11, 15 et 19 mars 2012.
[6] QPC = Question prioritaire de constitutionnalité permettant, au cours d’un procès devant le juge judiciaire ou administratif, la saisine du Conseil constitutionnel par la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat lorsqu’il est soutenu qu’une disposition législative en vigueur porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (article 61-1 de la Constitution). Le Conseil constitutionnel statue alors dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine (article 23-10 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution).
[7] Un sénateur l’invoquait encore récemment au Sénat ; « C’est la guerre ! » (cf. M. Alain Fouché).
[8] Source : http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/france/operation-sentinelle.
[9] L’emprunt à la rhétorique américaine est évident ici. En effet, dès 1996, Samuel HUNTINGTON, professeur à Harvard, avait publié sur le sujet son essai d’analyse politique intitulé Le Choc des civilisations (en anglais The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order). L’ouvrage fit grand bruit et engendra de vives polémiques. Il fut traduit en français en 1997 aux éditions Odile Jacob (Paris). Dans son ouvrage, HUNTINGTON se garde bien d’aborder le soutien de l’Occident aux formes de pouvoirs despotiques en raison de préoccupations d’ordre économique et géostratégique. Ainsi, il n’y a pas forcément d’Occident démocratique et d’ennemis de l’Occident non démocratiques… Alors que sa thèse a été invalidée dans les milieux universitaires – notamment, mais pas exclusivement, sous les angles géopolitiques, démographiques et anthropologiques -, la presse française a cité l’ouvrage à de nombreuses reprises à l’occasion des attentats du 11 septembre 2001 en y voyant une validation a posteriori de son analyse.
[10] Voir son interview donnée au JDD.fr du 29 juin 2015.
[11] La surenchère entre la « Gauche » dite de « gouvernement » (HOLLANDE/VALLS) et l’opposition était manifeste quant à la manière d’appréhender la lutte contre le terrorisme. Ainsi François FILLON (Les Républicains, LR), l’ancien premier ministre de Nicolas SARKOZY, et ancien candidat à la Primaire de droite, estimait dans le Journal du dimanche du 24 juillet 2016, qu’« une forme de guerre mondiale » est engagée et que « la société française tout entière doit se mobiliser contre le totalitarisme islamique ». Il estimait, en outre, que la France doit « imposer avec autorité » les valeurs de la République aux musulmans. « Nous sommes entrés dans une forme de guerre mondiale qui s’étend de l’Asie du Sud-Est jusqu’à l’Afrique occidentale, en passant par le Proche-Orient. Une fois passé l’émotion, la tentation, c’est de faire comme si on pouvait rentrer tranquillement chez soi en espérant qu’il n’y ait plus d’attentats. Sauf que l’organisation Etat islamique [EI] – qui nous fait la guerre – ne connaît ni faiblesse ni trêve », déclarait-il à l’hebdomadaire.
[12] Le terrorisme est une notion très politique et évolutive en fonction de la culture et du contexte historique d’un pays ou d’une zone géographique. En effet, tant au niveau de l’étude du terrorisme que de sa définition, la communauté internationale bute sur de nombreux problèmes, d’où la difficulté de l’émergence d’un consensus sur son appréhension rigoureuse. C’est ainsi, par exemple, que les gouvernements dictatoriaux ou totalitaires, considèrent comme « terroristes » les groupes ou les individus qui s’opposent de façon violente au pouvoir en place qui nie lui-même les libertés et les droits des minorités (politiques, ethniques, etc.), alors que des observateurs extérieurs à ces pays soulignent, bien au contraire, combien les actes de ces « terroristes » ne sont jamais que l’expression légitime d’une résistance à l’oppression. Ainsi pendant la 2ème guerre mondiale les nazis appelaient les résistants français «terroristes»… Aujourd’hui, l’actualité politique nous en donne un autre exemple avec la guerre civile en Syrie ou la chasse aux opposants en Turquie.
[13] La CDI est composée d’experts statutairement indépendants de leurs gouvernements, désignés à raison de leurs compétences techniques pour 5 ans de façon à assurer la représentation des grandes formes de civilisations et des principaux systèmes juridiques du monde ; leur nombre initialement de 15 est aujourd’hui passé à 34. La CDI se réunit en principe pour une session de plusieurs semaines à Genève.
[14] Centre d’Actualité de l’ONU, 25 juillet 2005, Kofi Annan appelle à l’adoption de la définition du terrorisme proposée par le Président de l’Assemblée générale, http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=10775&Cr=&Cr1=#.WYjV3zFlL4g
[15] Cf. Le Monde des 30/31 juillet 2017, p. 9.
[16] Voir Sénat : compte rendu analytique, https://www.senat.fr/cra/s20170718/s20170718_6.html#par_234
[17] Intervention de M. Jacques BIGOT, sénateur du Bas-Rhin, membre du groupe socialiste et républicain.
[18] Ibid.
[19 Intervention de Mme Esther BENBASSA, sénatrice du Val-de-Marne (non inscrite).
[20] Intervention de Mme Éliane ASSASSI, sénatrice de la Seine-Saint-Denis, Présidente du groupe communiste républicain et citoyen.
[21] Cf. « La prison face au djihad », revue Esprit 2016 (novembre) : Table ronde avec Antoine GARAPON, Farhad KHOSROKHAVAR, Ouisa KIES, Guillaume MONOD, Jean-Louis SCHLEGEL.
[22] Cf. GUIBET-LAFAYE (Caroline) : « Approche critique des sociologies de la radicalisation », Ministère de la Justice, Forum de la DAP, 15 octobre 2016.
[23] Cf. KHOSROKHAVAR (Farhad) : Radicalisation, Édition : Maison des Sciences et de l’Homme – Collection : Interventions 2014. Voir aussi les articles du même auteur : « Islam et nouvelles formes de racisme », in Les jeunes et le racisme, numéro thématique, de la Revue Agora, (débats/Jeunesse), 2003/volume 32, N° 1, pp. 54-63 ; « Le nouveau djiadisme européen, Revue du MAUSS, 2017/1, n° 49, pp. 31-47.
[24 Cf. également l’interview de Farhad KHOSROKHAVAR « Pourquoi de jeunes Français sombrent dans le djihad » donnée au Point.fr le 29 janvier 2015, (Propos recueillis par Armin AREFI). http://www.lepoint.fr/societe/pourquoi-de-jeunes-francais-sombrent-dans-le-djihad-19-01-2015-1897780_23.php#section-commentaires.
[25 De 1880 à 1914. Que l’on se souvienne de François Claudius Koënigstein dit RAVACHOL, surnommé le « Rocambole de l’anarchisme ». Cet un ouvrier et militant anarchiste français (1859-1892), qui s’’était rendu coupable de plusieurs délits, assassinats et attentats, fut guillotiné le 11 juillet 1892 à Montbrison.
[26] Cf. dans les Cahiers de psychologie politique, N° 27, l’excellent compte rendu établi par Alexandre DORNA, de l’ouvrage Radicalisation de KHOSROKHAVAR (Farhad) précité.




Commentaire sur “GUERRE ET PAIX : L’OPERATION SENTINELLE… par Louis SAISI”