 Il était une fois l’OTAN…
Il était une fois l’OTAN…
Once upon a time NATO
(North Atlantic Treaty Organization)
par Louis SAISI
Après 73 ans d’existence, force est de constater que l’OTAN = Organisation du traité de l’Atlantique Nord (en anglais : North Atlantic Treaty Organization ou « NATO ») est toujours là, alors que l’URSS et ses ex pays satellites d’Europe centrale et orientale – qui ont été censés, pendant toute la durée de la guerre froide, justifier son existence – se sont effondrés depuis plus de 30 ans, avec la chute du mur de Berlin et du bloc soviétique (1989-1991).
Aujourd’hui, l’OTAN, tel un marionnettiste, se cache derrière la guerre russo-ukrainienne pour mieux continuer à tirer les ficelles d’un monde pourtant unipolaire dominé par les USA avec la complicité de ses alliés européens dramatiquement suivistes, comme si la paix et la sécurité dans le monde passaient par la pérennité de l’OTAN.
Néanmoins cette réalité objective n’empêche pas nos gouvernants actuels et certains responsables politiques européens et américains, dans une belle harmonie semblable au chœur antique d’une tragédie grecque, de prétendre qu’une telle présentation des choses serait à la fois partiale et anachronique.
 Pourtant, il y a, à peine un peu plus d’un an, en mars 2021, dans une lettre ouverte à Jens STOLTENBERG, secrétaire général de l’OTAN, plusieurs hauts gradés de l’Armée française regroupés au sein du Cercle de Réflexion Interarmées [1] s’insurgeaient contre le projet « OTAN 2030 » dont ils considéraient qu’il affaiblissait la souveraineté de la France [2].
Pourtant, il y a, à peine un peu plus d’un an, en mars 2021, dans une lettre ouverte à Jens STOLTENBERG, secrétaire général de l’OTAN, plusieurs hauts gradés de l’Armée française regroupés au sein du Cercle de Réflexion Interarmées [1] s’insurgeaient contre le projet « OTAN 2030 » dont ils considéraient qu’il affaiblissait la souveraineté de la France [2].
Dans cette lettre, ils y dénonçaient le fait que…
« toute l’orientation de l’OTAN repose sur le paradigme d’une double menace, l’une russe, présentée comme à l’œuvre aujourd’hui, l’autre chinoise, potentielle et à venir. Deux lignes de force majeures se dégagent de cette étude.
La première, c’est l’embrigadement des Européens contre une entreprise de domination planétaire de la Chine, en échange de la protection américaine de l’Europe contre la menace russe qui pèserait sur elle.
La deuxième, c’est le contournement de la règle du consensus, de plusieurs manières : opérations en coalitions de volontaires ; mise en œuvre des décisions ne requérant plus de consensus ; et surtout la délégation d’autorité au SACEUR (Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, officier général américain) au motif de l’efficacité et de l’accélération de la prise de décision. »
Ces hauts gradés de l’Armée française n’hésitaient pas à voir dans cette étude un « monument de paisible mauvaise foi, de tranquille désinformation et d’instrumentalisation de cette « menace Russe », « menace » patiemment créée puis entretenue, de façon à « mettre au pas » les alliés européens derrière les États-Unis, en vue de la lutte qui s’annonce avec la Chine pour l’hégémonie mondiale. »
Après ces hauts gradés dont le métier des armes les conduit à s’intéresser de près aux problèmes de notre défense nationale, nous voudrions, à notre tour, plus modestement certes, mais légitimement en tant que citoyen, nous interroger sur cette attitude belliciste de l’OTAN, aujourd’hui, désignant la RUSSIE comme son ennemi implacable comme au temps de la guerre froide, alors que la fin de celle-ci avait été annoncée lors du sommet de MALTE de décembre 1989 à l’issue duquel l’américain G. BUSH (père) avait promis au russe M. GORBATCHEV (prix Nobel de la Paix en 1990) que si les pays d’Europe de l’Est sont autorisés à choisir leur future orientation par des processus démocratiques, les États-Unis n’essaieront pas de tirer avantage d’un tel processus et s’abstiendront d’avancer leurs pions en Europe par l’intermédiaire de l’OTAN.
Dans ce jeu, manichéen et dangereux, l’OTAN ne cherche-t-elle pas à assurer tout simplement sa propre survie inévitablement liée à l’existence d’une « menace » ? Et peu importe qu’une telle « menace » soit alors plus fictive que réelle ! Mais alors une telle pérennité ou « survie » profite-t-elle, à qui, aujourd’hui ? Car, depuis sa création, le groupe des 12 de l’OTAN, devenu aujourd’hui le club des 30 [3], ne poursuit-il pas toujours le même objectif caché, celui d’assurer l’hégémonie américaine, sans partage, sur le monde, en entraînant l’Europe dans son sillage ?
Sans doute est-il nécessaire d’étayer cette hypothèse, ce qui nous invite alors à revisiter l’histoire de l’OTAN pour cerner les temps forts au cours desquels cette Alliance s’est construite et ensuite a évolué jusqu’à sa trajectoire actuelle : depuis le contenu du Traité ayant institué l’OTAN (I), puis son organisation (II), ensuite, sa force dans le monde (III), en remontant à sa naissance, en tant que produit de la « guerre froide » et élément constitutif de celle-ci (IV), enfin sa curieuse survivance à l’issue de la guerre froide et sa non moins étrange conquête de l’Est aujourd’hui (V). Nous ferons ensuite un retour sur les temps chauds de la « guerre froide » en auscultant le grand silence et la discrétion de l’OTAN dans le monde bipolaire de la « guerre froide » (VI). Nous essaierons de cerner l’insaisissable doctrine de l’OTAN en Europe, tiraillée dans ses contradictions (VII). Nous analyserons enfin l’hyperactivité de l’OTAN et les conséquences négatives de ses interventions au sortir de la « guerre froide » avec l’avènement d’un monde unipolaire qui contraste avec le point VI précédent soulignant, à l’inverse, la discrétion de l’OTAN, de 1949 à 1991 (VIII).
Nous aborderons donc ces différents points selon le plan ci-dessous.
SOMMAIRE
I/ L’OTAN : un Traité ;
II/ L’OTAN : une organisation ;
III/ L’OTAN : une force dans le monde ;
IV/ L’OTAN : un produit de la « guerre froide » et un élément constitutif de celle-ci ;
V/ OÙ VA L’OTAN ? La survivance de l’OTAN et la conquête de l’Est ;
VI/ RETOUR SUR LES TEMPS CHAUDS DE LA « GUERRE FROIDE » : l’OTAN d’hier et son grand silence dans un monde bipolaire (1949-1991) ;
VII/ L’INSAISISSABLE NOUVELLE DOCTRINE de l’OTAN en EUROPE ;
VIII/ L’HYPERACTIVITE DE l’OTAN et ses interventions au sortir de la « guerre froide ».
———
I/ L’OTAN : un Traité
L’OTAN, c’est d’abord un traité.
Ce traité instituant l’OTAN a été signé le 4 avril 1949 à WASHINGTON [4].
Originellement, il n’y avait que 12 États signataires : les États-Unis, le Canada, la Belgique, le Danemark, la France, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni [5].
En application de ce traité, les États membres de cette organisation politique et surtout militaire s’engagent à se porter une mutuelle assistance au cas où le territoire de l’un d’entre eux serait envahi.
A/ Le contexte
1/ Les prémisses chez les européens de recherche d’un système de défense solidaire collective : du traité de Dunkerque entre la France et l’Angleterre (4 mars 1947) à L’Union Occidentale (UO) du traité de Bruxelles (1948)
 Le 4 mars 1947, la France et la Grande-Bretagne signent à Dunkerque un pacte d’assistance mutuelle.
Le 4 mars 1947, la France et la Grande-Bretagne signent à Dunkerque un pacte d’assistance mutuelle.
Dans le climat ambiant d’après-guerre, ce traité d’amitié et de coopération est ouvertement dirigé contre l’Allemagne vaincue en cas de nouvelle politique agressive de sa part.
Le gouvernement français tient, en effet, à se prémunir contre ce qu’il perçoit encore comme une menace latente au-delà du Rhin (cf. ci-contre le livre de Yann LAMEZEC : Le Traité franco-britannique de Dunkerque (Editeur SORBONNE PUPS, Paris, 15 mars 2007).
Mais au cours de l’année 1947 le statut de l’Allemagne et le plan Marshall divisent les occidentaux et les russes et une césure apparaît dans le camp des anciens Alliés.
Ceci explique qu’un peu plus tard, le gouvernement britannique présente à la France et aux pays du Benelux un projet d’alliance de défense mutuelle en cas d’agression.
| Parties |
|---|
Le 17 mars 1948, les cinq pays ci-dessus sont « parties » au traité de Bruxelles instituant l’Union occidentale (UO) qui ne prémunit plus uniquement contre l’Allemagne mais qui vise à prémunir ses signataires de toute agression armée en Europe – ce qui exclut les territoires d’outre-mer – contre l’un de ses membres. Le pacte de Bruxelles, prévoit, pour une durée de cinquante ans, d’organiser la coopération des « Cinq » dans les domaines militaire, économique, social et culturel. Un haut commandement militaire unifié de l’Union occidentale, sorte d’État-major commun, est créé. Mais le pacte de Bruxelles se trouve rapidement vidé de son contenu avec la signature du traité de l’Organisation européenne de coopération économique (16 avril 1948).
2/ L’intérêt pour l’Europe des Etats-Unis
Le 5 juin 1947, le secrétaire d’État américain, George MARSHALL, annonce un plan d’aide économique à l’Europe (en anglais : « European Recovery Program » (ERP). Ce plan d’aide, rapidement baptisé plan Marshall, est subordonné à la création d’une organisation multinationale permettant aux États européens de gérer eux-mêmes les fonds qui doivent être versés pour leur reconstruction par les États-Unis en menant à bien conjointement des réformes structurelles.
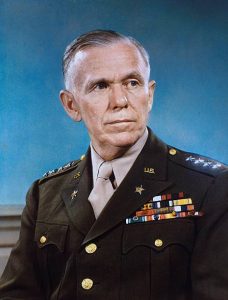 Ci-contre, le général George MARSHALL (1880-1959). De 1941 à la fin de la guerre, conseiller privilégié de Roosevelt, il participa à toutes les conférences interalliées.
Ci-contre, le général George MARSHALL (1880-1959). De 1941 à la fin de la guerre, conseiller privilégié de Roosevelt, il participa à toutes les conférences interalliées.
Secrétaire d’État auprès du président TRUMAN, en 1947, il se consacra à la réalisation du programme ERP (« European Recovery Program ») auquel il donna vite son nom.
UNITED STATES – CIRCA 2002: General George C. Marshall (Photo by Harry Warnecke/NY Daily News Archive via Getty Images)
L’approbation du plan Marshall par le Congrès des États-Unis n’est pas acquise d’avance. Le 19 décembre 1947, le président TRUMAN expose devant le Congrès les enjeux de la reconstruction économique de l’Europe et détaille l’aide que les États-Unis veulent lui octroyer pour relever son économie. Le « coup de Prague » de février 1948 achève de convaincre une majorité de membres du Congrès de voter en faveur du plan si bien que TRUMAN promulgue, le 3 avril 1948, la loi autorisant l’aide américaine, l’Economic Cooperation Act.
3/ Le changement d’état d’esprit aux USA sur l’engagement des américains dans le monde
Quant à la création de l’OTAN, elle est rendue possible par le fait qu’entre-temps, le Sénat américain a adopté la fameuse résolution dite « VANDENBERG », du 11 juin 1948, du nom du sénateur républicain du même nom qui la présenta, en tant que président de la commission des relations extérieures de l’assemblée fédérale des Etats de l’Union. Cette résolution autorise les Etats-Unis à prendre part, dans le respect de leur constitution, à des systèmes de défense collective en temps de paix, ce qu’ils ne se privent pas de faire aussitôt, entre 1948 et 1954 : charte de BOGOTA créant l’OEA (1948)[6] ; traité de l’OTAN (1949) ; traité de sécurité entre les USA et le Japon ( 8 septembre 1951) [7] ; traité de l’OTASE couvrant l’Asie du sud-est (8 septembre 1954) [8]. On a même ironisé et parlé parfois de « pactomanie » pour désigner cette période intense de la diplomatie américaine.

Ci-contre, Arthur H. VANDENBERG (1884-1951), sénateur américain républicain du Michigan (1928-1951) président intérimaire du Sénat des États-Unis de 1947 à 1949. C’est lui qui fit évoluer la doctrine isolationniste du parti républicain. Sa propre conversion de «l’isolationnisme» à «l’internationalisme» s’opéra le 10 janvier 1945 où, il l’annonça publiquement dans un discours au Sénat. En 1947, au début de la guerre froide, il devint président de la commission des relations extérieures du Sénat.
En 1921, il s’était déjà distingué par la publication d’une biographie laudative d’Alexander HAMILTON, puis, un peu plus tard, par une étude sur le nationalisme américain et la politique étrangère américaine. Avocat de formation, il participa à la création de l’ONU en 1945.
Il reste cependant que le traité de Bruxelles de mars 1948, conçu pour renforcer les liens entre ses signataires européens tout en instaurant un système de défense commun, a servi de modèle au traité de Washington.
B/ les dispositions du Traité
Le traité instituant l’OTAN est un texte assez court ne comportant que 14 articles précédées d’un Préambule en exposant la philosophie et la zone géographique d’application.
L’on peut être troublé par sa lecture attentive qui peut faire illusion car ce traité a réussi le tour de force d’être rédigé en des termes très généraux ne mettant jamais explicitement en cause la philosophie marxiste – portée alors par l’URSS et les démocraties populaires d’Europe centrale et orientale liées à l’Union soviétique -, alors que le traité a été fondamentalement conçu pour endiguer et neutraliser le communisme selon la doctrine TRUMAN.
Encore, aujourd’hui, dans « Une brève histoire de l’OTAN », le site NATO de l’organisation, parmi les trois objectifs de l’Alliance atlantique, cite comme premier objectif de celle-ci son souci d’« endiguer l’expansionnisme soviétique » ; le second étant d’« empêcher le retour du militarisme nationaliste en Europe grâce à une présence forte de l’Amérique du Nord sur le continent » ; le troisième étant d’« encourager l’intégration politique européenne » (cf. NATO « Une brève histoire de l’OTAN », 20120430_ShortHistory_fr.pdf (nato.int).
Pour revenir au Traité lui-même, il y a lieu de distinguer le préambule et les dispositions principales du Traité concentrées dans quelques articles principaux (6).
1/ Le préambule
Le préambule constitue une allégeance aux principes de la philosophie libérale du droit et de l’Etat. Mais, surtout, il se réfère fort habilement aux principes de la Charte des Nations Unies élaborée 4 ans plus tôt lors de la Conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale tenue à San-Francisco, signée le 26 juin 1945 et entrée en application le 24 octobre 1945.
Les parties au Traité de l’OTAN affirment ainsi leur « désir de vivre en paix avec tous les peuples » ainsi que leur attachement à la « liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit. »
Le préambule détermine également la zone géographique dans laquelle seront appliqués les principes du traité : « la région de l’Atlantique Nord » qui comprend les deux États d’Amérique du Nord (USA et Canada) et les États européens.
2/ Les articles clés du traité
Il y en a essentiellement 6 (ou 4 + 2) :
a) La prohibition de la guerre
Elle est énoncée à l’article 1er du traité. Les parties ont l’obligation de régler « les différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées » par des « moyens pacifiques » conformément à la Charte des Nations-Unies.
b) Le principe de solidarité entre les États membres
Aux termes mêmes de l’article 3, les parties doivent « se prêter mutuellement assistance » pour « la réalisation des buts du … traité ». Il s’agit, pour elles, de « maint(enir) et d’accroît(re) leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée. »
c) L’article 5 et le droit de riposte
Cet article dispose qu’« une attaque armée » contre l’une ou plusieurs parties au Traité – « survenant en Europe ou en Amérique du Nord » – « sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties ».
Dans une telle hypothèse, l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord, est dès lors justifié dans le cadre du droit de légitime défense individuelle ou collective reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations-Unies.
L’article 6 suivant définit la notion d’« attaque armée » ainsi que les zones auxquelles elle s’applique.
d) L’adhésion d’un Etat européen au Traité (article 10)
Selon l’article 10, l’adhésion d’un Etat européen au Traité est libre sur invitation des parties au Traité.
e) La modification du Traité (article 12)
Aux termes mêmes de l’article 12, le traité pourra être modifié après 10 ans d’application.
f) Le retrait d’une partie du Traité (article 13)
Ce retrait est possible, mais seulement à partir de 20 années d’application du Traité. L’hégémonie américaine au sein de l’OTAN se manifeste au niveau des dispositions de cet article.
En effet, la partie souhaitant se retirer du Traité ne pourra le faire, qu’un an après en avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera à son tour les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.
II/ L’OTAN : une organisation
 Au sein de l’OTAN, les organes civils (politiques) (A) priment sur les organes militaires (B).
Au sein de l’OTAN, les organes civils (politiques) (A) priment sur les organes militaires (B).
A/ Le primat des organes civils de l’OTAN
1/ L’organe décisionnel : le Conseil de l’Atlantique Nord
L’organe décisionnel de l’OTAN est le Conseil de l’Atlantique Nord (CAN), émanation des nations composant l’organisation, qui prend ses décisions par consensus.
À ce titre, le Conseil fixe les orientations politiques de l’Alliance, assure la direction politique des opérations, adopte les budgets de l’OTAN, et, de manière générale, prend l’ensemble des décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’Alliance.
Il peut se réunir aussi bien au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, lors des Sommets, des Ministres, lors des réunions ministérielles ou, comme c’est le cas, à un rythme au moins hebdomadaire, au niveau des Ambassadeurs, Représentants permanents des nations.
Les 30 États membres actuels (28 pays européens + les Etats-Unis et le Canada) abondent directement au budget de l’OTAN. Les dépenses annuelles directes de l’Organisation dépassent les 2 milliards d’euros. Ce financement des institutions et de la structure de l’OTAN est négocié tous les deux ans, tout comme la quote-part de chaque pays : les États-Unis sont les principaux contributeurs avec 22,14% ; suivent l’Allemagne avec 14,65%, puis la France (10,63%), et le Royaume-Uni (9,85%) [9]
Les « sommets » de l’OTAN permettent, de façon périodique, aux chefs d’État et de gouvernement des pays membres d’évaluer les activités de l’Alliance et de leur donner des orientations stratégiques.

Ces « sommets » ne sont pas conçus comme des réunions régulières, mais plutôt comme des points d’étape importants du processus décisionnel de l’Alliance. Les « sommets » font émerger des nouvelles politiques, sont l’occasion soit d’inviter de nouveaux pays à adhérer à l’Alliance, soit de lancer de grandes initiatives ou enfin d’instaurer des partenariats avec des pays non membres de l’OTAN.
Depuis la création de l’Alliance en 1949, l’OTAN a organisé 31 « sommets » (cf. site NATO, « Sommets », 8 juin 2022). Son prochain « sommet » aura lieu les 29 et 30 juin 2022, à MADRID, selon l’annonce qui fut faite le 8 octobre 2021 par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, après un entretien avec le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens STOLTENBERG .
C’est le secrétaire général de l’OTAN qui préside le conseil de l’Atlantique Nord, l’organisation suprême de décision de l’alliance de défense. Il est également le chef du personnel de l’organisation, et aussi son principal porte-parole.
Par tradition, le poste de secrétaire général est tenu par un européen. Cette structure est destinée à contrebalancer l’influence des États-Unis, qui nomment le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe.
Il n’existe pas de procédure formelle pour la désignation du secrétaire général. Les membres de l’OTAN traditionnellement arrivent à un consensus sur celui qui sera nommé. Le choix se fait par le biais des canaux diplomatiques informels mais cela peut aboutir parfois à des tensions entre membres. Par exemple, en 2009, une controverse naquit sur le possible choix du danois Anders Fogh RASMUSSEN, récusé par la Turquie, mais il fut finalement nommé et resta en poste jusqu’en 2014.
La durée du mandat est variable, de 15 jours, pour l’italien Alessandro MINUTO-RIZZO, secrétaire général par intérim de l’OTAN du 17 décembre 2003 au 1er janvier 2004, à 12 ans 8 mois et 24 jours pour le néerlandais Joseph LUNS qui a battu le record de longévité dans la fonction.
Généralement, ce sont d’anciens diplomates ou ministres des affaires étrangères qui sont nommés à ce poste, mais parfois aussi d’anciens chefs de gouvernement (comme l’actuel secrétaire général). C’est dire que le poste est considéré comme prestigieux par les hommes politiques, au moins à l’étranger…
À noter que de 1952 à 2022, sur les 16 secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête de l’OTAN (la plupart issus alternativement du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la Norvège, du Danemark), ce ne fut jamais un politique ou un diplomate français qui fut choisi dans la fonction de Secrétaire général de l’OTAN. Cela a été vrai de 1952 à 1966, c’est-à-dire avant le retrait de la France de l’OTAN, mais aussi, de 2009 à 2022, après son retour dans le Haut commandement militaire intégré de l’OTAN. L’on peut se demander s’il n’y a pas une forme de suspicion entretenue sur la France par les américains…
À l’opposé, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, Etats très proches des américains, donnèrent, chacun, à l’OTAN trois secrétaires généraux.

Ci-contre, le norvégien Jens STOLTENBERG, actuellement secrétaire général de l’OTAN, depuis le 1er octobre 2014. Né le 16 mars 1959 à Oslo, Jens STOLTENBERG, membre du Parti travailliste (AP) et Premier ministre entre mars 2000 et octobre 2001, puis d’octobre 2005 à octobre 2013, fut nommé secrétaire général de l’OTAN le 28 mars 2014 en remplacement d’Anders Fogh Rasmussen.
L’ancien Premier ministre norvégien a vu sa mission, en tant que secrétaire général de l’OTAN, prolongée, en 2018, pour un nouveau mandat de quatre ans, ce qui signifie qu’il dirigera normalement l’OTAN jusqu’au 30 septembre 2022.
B/ Le volet militaire
Il s’agit d’une structure qui se caractérise par une articulation conçue autour de trois niveaux.
1/ Le niveau supérieur : le Comité militaire
À ce niveau, l’on trouve le Comité militaire qui est la plus haute instance militaire de l’OTAN car il représente les plus hautes autorités militaires des nations de l’OTAN (Chefs d’état-major des armées).
Le Comité militaire supervise les deux structures militaires stratégiques de l’OTAN que sont le SACEUR et le SACT.
En effet, depuis la réforme du 12 juin 2003 de l’OTAN, la réorganisation de la structure militaire de l’OTAN porte sur la création de deux grands commandements stratégiques : l’un chargé d’assurer la conduite des opérations militaires et qui reste basé à MONS, en Belgique, où se trouve l’actuel Commandement suprême des forces alliées en Europe (Shape), et l’autre chargé de la modernisation de l’outil militaire de l’OTAN, à NORFOLK, en Virginie, aux Etats-Unis. Cette réforme a entraîné la réduction environ de la moitié du nombre de quartiers généraux subalternes de l’OTAN en Europe.
Son président (Chairman of the NATO Military Committee’s, CMC) est le porte-parole militaire de l’Alliance. Traditionnellement ancien chef d’état-major des armées d’un des alliés, il est élu par les Chefs d’État-major des Alliés pour un mandat de trois ans depuis 1968.
Il est le porte-parole militaire principal de l’alliance des 30 nations et le principal conseiller du secrétaire général. Le président est l’un des principaux responsables de l’OTAN, aux côtés du secrétaire général et du commandant suprême des forces alliées en Europe.
Actuellement, depuis le 25 juin 2021, c’est l’amiral néerlandais Rob BAUER, qui préside le comité militaire de l’OTAN, ayant succédé à l’anglais Sir STUART PEACH, général d’armée aérienne. De 1949 à aujourd’hui, l’OTAN en a compté 32.
La France, en 1954, en la personne du général et Chef d’Etat Major des Armées Augustin Léon GUILLAUME (1895-1983), présida pendant un an ce Comité (durée habituelle très brève du mandat à l’époque jusqu’à 1964), puis en fut absente de 1966 à 1995, à la suite de son retrait du Commandement militaire intégré décidé par le général de GAULLE à partir de 1966 (cf. infra) [10].
C’est le président du Conseil militaire qui propose au Conseil les appréciations et les analyses qu’il juge utiles ainsi que les options et plans militaires demandés.

Ci-contre, l’Amiral néerlandais Rob BAUER, président du Comité militaire de l’OTAN depuis juin 2021,
Il a pris la suite du britannique de l’Air Chief Marshal Sir Stuart Peach.
Dans son pays, Rob BAUER a été précédemment chef de la défense (en néerlandais : Commandant der Strijdkrachten) d’octobre 2017 à avril 2021.
2/ Le SACEUR
– SACEUR signifie « Suprem Allied Command Europe », c’est-à-dire le Commandement suprême des forces alliés en Europe. Il dirige le commandement allié opération (ACO) qui est chargé de la planification et de l’exécution des opérations militaires de l’OTAN.
Cet officier est traditionnellement américain. Il est nommé par le président des Etats-Unis et confirmé par le Sénat des Etats-Unis puis par le Conseil de l’Atlantique Nord.
Il est responsable devant le Comité militaire.
Le SACEUR a son siège à CASTEAU, près de MONS, en Belgique, au SHAPE (Suprem Headquaters Allied Powers Europe = Grand Quartier Général des puissances alliées en Europe).
Lorsque le conseil de l’OTAN se réunit à New York le 15 septembre 1950, PARIS est choisi comme siège du quartier général, en raison surtout de sa position centrale et de ses excellents moyens de télécommunications. Son siège est d’abord celui de l’ancien hôtel ASTORIA (qui était alors en haut de l’avenue des Champs Élysées [11]) qui est mis à disposition du commandement militaire et rapidement aménagé pour recevoir les officiers américains qui doivent constituer le groupe de planning du SHAPE arrivé le 1er janvier 1951 avec, à leur tête, le général Dwight David EISENHOWER, le héros du débarquement du 6 juin 1944 de la seconde guerre mondiale. Ils sont bientôt rejoints par les représentants de huit autres pays membres. À partir du 2 avril 1951, le Grand Quartier général des puissances alliées en Europe commence à fonctionner dans cet hôtel. Mais, très rapidement, à la suite de l’exiguïté des lieux, à partir de juillet 1951, l’Organisation du Traité Atlantique Nord va installer son Grand quartier général des puissances alliées en Europe à ROCQUENCOURT, à la limite de la forêt de Marly, dans les Yvelines.
À la suite du retrait de la France du commandement militaire de l’OTAN en 1966, le siège est déplacé en Belgique, sur le territoire des anciennes communes de Casteau, Maisières et de Masnuy-Saint-Jean où le nouveau SHAPE est inauguré le 31 mars 1967. Depuis la fusion des trois communes, tout le territoire du SHAPE fait partie de l’entité de MONS située dans la province de Hainaut en Belgique.

Ci-contre, le général américain d’armée aérienne Tod D. WOLTERS, Président du SACEUR de l’OTAN (Grand Quartier général des puissances alliées en Europe).
Le Commandant du SACEUR est en charge de la préparation des forces, de la planification et de la conduite des opérations conduites par l’OTAN. Outre un groupe en charge des systèmes d’information et de communication, il comprend deux états-majors de niveau opératif (Joint Forces Command, situés à Brunssum et Naples), et un commandement pour chacune des trois composantes Terre, Air et Mer.
3/ Le SACT
– SACT signifie « Suprem Allied Command Transformation », c’est-à-dire le « Commandement allié Transformation ». Ce SACT dirige le « Commandement allié Transformation » (ACT = Allied Command Transformation).
Le SACT est également responsable devant le Comité militaire. Il siège à NORFOLK, en VIRGINIE, aux USA. Il est chargé de la transformation des capacités des armées de l’OTAN, d’améliorer leur interopérabilité (= la possibilité d’opérer ensemble) et de mettre à jour la doctrine et les concepts de ces armées
Il s’appuie à la fois sur l’état-major situé à NORFOLK, en Virginie, aux Etats-Unis et sur le centre interarmées d’analyse et d’enseignements (Joint Analysis and Lessons Learned Centre – JALLC) situé au PORTUGAL, le centre d’entraînement de forces interarmées (Joint Force Training Centre – JFTC) en POLOGNE et le centre de guerre interarmées (Joint Warfare Centre – JWC) en NORVÈGE.

Ci-contre, Philippe LAVIGNE, chef d’état-major de l’Armée de l’air et général d’armée aérienne (France) Commandant suprême allié pour la transformation (de l’OTAN) depuis le 23 septembre 2021.
Depuis 2009, date de la réintégration par la France du commandement intégré de l’OTAN, le responsable du SACT est un officier français. Antérieurement à la nomination, à ce poste, du général d’armée aérienne Philippe LAVIGNE, son prédécesseur était le Général André LANATA (2018-2021).
C/ La France et l’Alliance militaire de l’OTAN
Le volet militaire de l’OTAN est désigné par l’expression « commandement intégré » duquel la France se retire en 1966 sous la présidence de Charles de GAULLE qui refuse que la France, au nom de sa souveraineté et de son indépendance, puisse être systématiquement et militairement engagée dans un conflit qui ne serait pas le sien.
1/ Le retrait de l’alliance militaire de la France (1966)
Le 21 février 1966, en effet, lors d’une conférence de presse mémorable, à Paris, Charles de GAULLE annonce au monde entier le retrait de la France du commandement militaire intégré de l’OTAN.
Selon l’Homme du 18 juin, « Il est bien clair, en effet, qu’en raison de l’évolution intérieure et extérieure des pays de l’Est, le monde occidental n’est plus aujourd’hui menacé comme il l’était à l’époque où le protectorat américain fut organisé en Europe sous le couvert de l’O.T.A.N. »

Ci-contre, le général De Gaulle annonce dans sa conférence de presse du 21 février 1966 – qui fera date – le départ de la France du commandement intégré de l’OTAN.
La seconde raison alléguée par Charles de GAULLE résidait dans le changement géographique des zones de conflit dans le monde :
« D’autre part, tandis que se dissipent les perspectives d’une guerre mondiale éclatant à cause de l’Europe, voici que des conflits où l’Amérique s’engage dans d’autres parties du monde, comme avant-hier en Corée, hier à Cuba, aujourd’hui au Vietnam, risquent de prendre, en vertu de la fameuse escalade, une extension telle qu’il pourrait en sortir une conflagration générale. Dans ce cas, l’Europe, dont la stratégie est, dans l’O.T.A.N., celle de l’Amérique, serait automatiquement impliquée dans la lutte lors même qu’elle ne l’aurait pas voulu.
Il en serait ainsi pour la France, si l’imbrication de son territoire, de ses communications, de certaines de ses forces, de plusieurs de ses bases aériennes, de tels ou tels de ses ports, dans le système militaire sous commandement américain devait subsister plus longtemps. »
Il invoquait également le statut de puissance atomique de la France :
 « Au surplus, notre pays, devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique, est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques très étendues que comporte cette capacité et que leur nature et leurs dimensions rendent évidemment inaliénables. »
« Au surplus, notre pays, devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique, est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques très étendues que comporte cette capacité et que leur nature et leurs dimensions rendent évidemment inaliénables. »
And last but not least, il invoquait la liberté et la souveraineté de la France devant toujours être maîtresse de son destin national :
« Enfin, la volonté qu’a la France de disposer d’elle-même, volonté sans laquelle elle cesserait bientôt de croire en son propre rôle et de pouvoir être utile aux autres, est incompatible avec une organisation de défense où elle se trouve subordonnée. »
Il reste que cette décision ne remettait nullement en cause l’engagement français à prendre part à la défense collective de l’Alliance : il s’agissait, selon la formulation du Général de Gaulle, de « modifier la forme de notre Alliance sans en altérer le fond ».
2/ En 1995, la France réintègre le Comité militaire de l’OTAN et, en 2009, sous la présidence de Nicolas SARKOZY, elle réintègre l’alliance militaire.
Assez paradoxalement, c’est Jacques CHIRAC qui, dès son entrée à l’Élysée en 1995, oubliant l’héritage du général de GAULLE en matière de politique étrangère, entame les négociations pour le retour de la France dans le Commandement militaire intégré de l’Alliance. En échange, il réclame l’attribution pour la France du poste de Commandement du flanc sud de l’Alliance à NAPLES, qui est le port d’attache de la 6ème flotte de l’US Navy.
Mais, à partir de 1997, la cohabitation avec la Gauche de Lionel JOSPIN – hostile au retour dans l’Alliance militaire – met vite un terme aux négociations.
La France reste néanmoins engagée dans les opérations militaires de l’Alliance. C’est ainsi qu’elle participe aux opérations en BOSNIE, de 1993 à 2004, dans le cadre de l’IFOR puis de la SFOR, et à la campagne aérienne de l’OTAN en 1999 visant à mettre fin à la guerre du KOSOVO (KFOR).
De 1990 à 2000, sur une dizaine d’années, les deux guerres des Balkans (Bosnie-Herzégovine et Kossovo) auxquelles participe la France vont précipiter, à partir de 1995, le retour partiel de la présence française dans les structures militaires de l’OTAN. Ainsi, à partir de cette date, les ministres de la Défense participent aux réunions ministérielles de l’OTAN, les chefs d’État-major français prennent part aux réunions avec leurs homologues des pays Alliés, et le représentant militaire français auprès de l’OTAN siège au Comité militaire. Des officiers français servent par ailleurs, dès cette date, au quartier général des forces alliées en Europe (SHAPE), dans les états-majors de niveau opératif et dans certains organismes du Commandement pour la Transformation à partir de 2003.
Mais c’est le président de la République Nicolas SARKOZY qui, dès son élection en 2007, décide de revenir pleinement dans le Commandement militaire intégré. C’est ainsi qu’après sa rencontre avec Georges BUSH, en août 2007 aux États-Unis [12], il annonce au Congrès, à Washington, le 7 novembre 2007, la réintégration de la France dans le commandement intégré de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord. L’affaire est entérinée en 2009 par le Parlement français, malgré le dépôt d’une motion de censure rejetée. En échange, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, la France reçoit le Commandement non directement opérationnel dit « Suprem Allied Command Transformation » (SACT) basé à NORFOLK dont la mission est une réflexion sur l’évolution militaire de l’Alliance.
III/ L’OTAN : une force dans le monde
 A/ Le rapport des forces militaires entre l’OTAN et la RUSSIE
A/ Le rapport des forces militaires entre l’OTAN et la RUSSIE
Selon « Le Monde » du 18 juillet 2018, l’OTAN dispose de capacités militaires supérieures à celles de la Russie [13]. La comparaison des forces armées en 2016 donne un net avantage à l’OTAN. En effet, les forces de l’OTAN (USA, Canada et 28 autres États membres de l’organisation) font apparaître une position militaire supérieure de l’OTAN sur la RUSSIE.
1/ Quant aux personnels militaires en service actif
OTAN : 3,2 millions de militaires ; RUSSIE : 831 000
2/ Têtes nucléaires [14]
OTAN : 7065 ; RUSSIE : 6850
3/ Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins
OTAN : 22 ; RUSSIE : 13
4/ Avions bombardiers à long rayon d’action
OTAN : 157 ; RUSSIE : 139
5/ Chars d’assaut
OTAN : 9857 ; RUSSIE : 2950
6/ Engins blindés
OTAN : 29 275 ; RUSSIE : 5900
7/ Avions de combat
OTAN : 5277 ; RUSSIE : 1065 (+ 4212 en faveur de l’OTAN)
8/ Porte-avions
OTAN : 22 ; RUSSIE : 1 (le « Kouznetsov [15] », âgé de 30 ans et en fin de vie)
9/ Frégates, destroyers [16]
OTAN : 252 ; RUSSIE : 32
B/ Les moyens financiers respectifs entre l’OTAN et la RUSSIE en 2017
Tout d’abord, une brève comparaison Russie/USA
Lors des dernières années de la Guerre froide, le budget consacré par les USA à leur défense représentait 40% du total mondial ; ce même budget total des USA atteignait même 45,8% en 1992.
Selon le SIPRI [17], le budget de la défense de la RUSSIE atteignait 48,6 milliards en 1992, alors que celui de l’URSS atteignait 227 milliards en 1990 et était donc à peu près 5 fois supérieur…
En 2000 et 2001, les dépenses de défense des USA retombent à 40% du total mondial. Avec les guerres engagées en AFGHANISTAN et en IRAK par les USA, les dépenses miliaires des USA augmentent à nouveau fortement pendant la décennie 2000 pour atteindre en 2009-2011 leur plus haut niveau historique, autour de de 775 milliards de dollars, soit 45% des dépenses de défense dans le monde.
Durant la présidence d’OBAMA, les dépenses de défense des USA décroissent régulièrement jusqu’à 606 milliards de dollars en 2017, soit 35% du total mondial. Malgré cette baisse significative, cela fait encore plus du tiers des dépenses militaires dans le monde.
1/ OTAN
L’OTAN consacre 954 milliards de dollars à son armement militaire, soit 2,43% du PIB de l’ensemble des Etats de l’organisation. En 2014, sous la pression de l’organisation, chacun des pays membres de l’OTAN s’est engagé à consacrer 2% de son PIB à sa défense nationale.
En 2017, seuls 5 pays de l’OTAN avaient atteint cet objectif : USA (3,14% de leur PIB) ; GRECE, ESTONIE, ROYAUME-UNI, POLOGNE.
La France était, quant à elle, à 1,79% de son PIB et l’Allemagne à 1,2%.
2/ RUSSIE
La RUSSIE consacre 66,3 milliards de dollars à son armement militaire, soit 4,3% de son PIB.
Du côté de l’UKRAINE – qui ne fait toujours pas partie aujourd’hui de l’OTAN mais a mobilisé les forces de l’OTAN à son secours pour résister à l’invasion russe – ce pays, selon la Banque mondiale, consacre 4,1% de son produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires, ce qui est un chiffre très élevé, supérieur à celui de la France et même des Etats-Unis. Cependant, l’UKRAINE ayant un PIB relativement faible, cela représente 5,9 milliards de dollars. Mais à ces propres dépenses militaires de l’UKRAINE, il faut ajouter l’aide fournie par les Occidentaux, en matière de matériel et de logistique. C’est ainsi que selon l’AFP les Etats-Unis auraient accordé plus de 2,5 milliards de dollars d’aide militaire à l’UKRAINE depuis 2014. Et avec l’invasion de l’UKRAINE par la RUSSIE, l’aide militaire américaine ne cesse d’augmenter, le président BIDEN ayant annoncé une nouvelle tranche d’aide d’une valeur de 800 millions de dollars (735 millions d’euros), selon un communiqué de la Maison-Blanche [18].
Par ailleurs, le président BIDEN a demandé au Congrès des Etats-Unis de débloquer 33 milliards d’aides supplémentaires. Mais bien que le soutien à KIEV des congressistes américains soit unanimement acquis, les discussions avaient achoppé pendant un certain temps sur le contenu de la loi devant étendre l’aide militaire, les démocrates ayant voulu y insérer un amendement visant l’augmentation du budget de la lutte anti-Covid aux Etats-Unis, ce que les républicains refusaient au départ énergiquement.
Ce choix des américains d’attiser le conflit ukrainien est critiqué et dénoncé comme « va-t-en-guerre » et belliciste par l’hebdomadaire italien « TPI internazionale » du 15 avril 2022, selon lequel il permettrait au président américain Joe BIDEN de justifier et souder l’OTAN, dans l’intérêt exclusif américain, mais pas dans celui de l’Union européenne à laquelle l’hebdomadaire de gauche précité reproche de ne pas conduire une politique indépendante au service de la paix [19].
Il faut noter enfin que, selon « Wall Street Journal » [20] l’aide fournie par les occidentaux n’est pas purement logistique car, par son aide à la formation militaire – se traduisant par des cours, des exercices et des manœuvres impliquant au moins 100 000 hommes chaque année sur plus de 8 ans -, les pays membres de l’OTAN ont aidé l’UKRAINE à passer de structures de commandement rigides de type soviétique à des normes occidentales où l’on apprend aux soldats à penser en pleine action. C’est, dit-on, cette « métamorphose » de l’armée ukrainienne préparée de longue date par les occidentaux qui lui aurait permis de repousser l’armée d’invasion russe pourtant plus nombreuse. Cette aide occidentale, qui ne date pas d’aujourd’hui, explique la capacité de résistance de l’armée ukrainienne aux russes.
IV/ L’OTAN : un produit de la « guerre froide » et un élément originaire, annonciateur et constitutif de celle-ci
 A/ La « guerre froide »
A/ La « guerre froide »
Avant d’être une naissance et une pratique discutables (B), le concept de « guerre froide » est, au départ, une construction intellectuelle (A).
1/ Une construction au départ intellectuelle
L’expression « guerre froide » (« cold war ») a été inventée et théorisée par l’écrivain anglais George ORWELL (1903-1950), dans son essai « You and the Atomic Bomb » (1945), dans lequel il prédit une période d ‘« horrible stabilité » où des nations puissantes ou des blocs d’alliance, chacun capable de détruire l’autre [21], refuseraient de communiquer ou de négocier.
Pour l’écrivain [22], ces pays seraient en « état permanent de guerre froide » avec leurs voisins. Une telle situation, qui mettrait fin aux « guerres de grande envergure », aurait pour effet de prolonger indéfiniment une paix qui n’en est pas une [23].
Le journaliste américain Walter LIPPMANN (1889-1974) contribua, à son tour, à populariser, dans une série d’essais, le terme de « guerre froide » qu’il employa pour la première fois en 1947.
Raymond ARON (1905-1983)
 De son côté, le français Raymond ARON (1905-1983) la définit comme une « guerre limitée » ou une « paix belliqueuse » dans un monde bipolaire où les USA et l’URSS évitent l’affrontement direct, d’où l’expression qu’il emploie en 1947 : « Paix impossible, guerre improbable »[24].
De son côté, le français Raymond ARON (1905-1983) la définit comme une « guerre limitée » ou une « paix belliqueuse » dans un monde bipolaire où les USA et l’URSS évitent l’affrontement direct, d’où l’expression qu’il emploie en 1947 : « Paix impossible, guerre improbable »[24].
Cette expression va constituer, un an plus tard, le titre du premier chapitre de son ouvrage Le grand schisme [25]. Raymond ARON, universitaire et intellectuel libéral [26] considère que dans la lutte idéologique qui oppose les USA et l’URSS, l’Europe, n’a plus de rôle déterminant à jouer, tout au moins matériellement ; elle ne peut donc, selon lui, que se ranger ou se laisser ranger dans l’un ou l’autre camp. Pour sa part, il s’enrôle, sans aucune réserve critique, dans le camp des USA [27], ce que Jean-Paul SARTRE – qui fait alors un autre choix et devient même pendant un certain temps compagnon de route du PCF – lui reproche, et les deux grands intellectuels français du 20ème siècle ne cessent de s’opposer jusqu’à la fin de leur vie [28]. Pour sa part, ARON n’hésite pas à adhérer au RPF gaulliste pendant plusieurs années car il considère, selon le chercheur historien et politologue Jean-François SIRINELLI, que « le RPF (est) le plus ferme rempart contre le communisme »[29].
2/ La rupture de la cohésion entre les Alliés du second conflit mondial marque-t-elle le début réel de la « guerre froide » ?
Un état des lieux et des forces en présence est ici nécessaire.
Tout d’abord, à l’issue du second conflit mondial ce sont les américains qui sont en Europe à des milliers de Kms de chez eux et qui « occupent », avec les « Alliés », l’Allemagne.
Or, au cours de cette période d’occupation d’une partie de l’Europe, l’on a tendance à mettre sur le même pied d’égalité les deux grands vainqueurs de la barbarie nazie : les USA et l’URSS, en insistant quasi exclusivement sur la puissance politique acquise par l’URSS en Europe.
Certes, il n’est guère discutable que l’URSS, politiquement au moins, est forte car à la faveur de la libération par l’Armée rouge des États d’Europe centrale et orientale – qui étaient tombés sous le joug des nazis – elle a, ce faisant, de fin juin 1944 à mai 1945, étendu son influence idéologique et politique sur ces pays libérés sans pour autant encore totalement les contrôler, ce qui se fera seulement entre 1945 et 1949, et de manière progressive.
En effet, ce n’est qu’au cours de l’été 1949 que STALINE imposa sa ligne politique et le choix de leurs dirigeants aux démocraties populaires accusant ceux qui avaient des velléités d’indépendance soit de déviation nationaliste soit de titisme. C’est ainsi qu’au cours de l’été 1948 sont éliminés les dirigeants de POLOGNE, de ROUMANIE, et d’ALBANIE. Fin septembre et décembre 1949 suivront ceux de HONGRIE et de BULGARIE [30].
Seul le yougoslave TITO saura résister à STALINE et va prendre son indépendance à partir de juillet 1948 pour se tourner vers l’Ouest en adoptant une politique de « neutralité positive » [31] avant d’opter, à partir de 1961, pour une posture de non alignement rejoignant ainsi la position de rejet des deux blocs (Etats-Unis et URSS) adoptée par de nombreux pays du Tiers Monde lors de la conférence de Bandoung (1955).
Il reste qu’entre 1945 et 1949, le rapport de forces, en Europe et dans le monde, entre les USA et l’URSS, incline nettement en faveur des USA car les deux puissances ne sont pas sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur puissance économique et militaire, alors que la propagande occidentale pointe régulièrement la menace impérialiste comme venant de l’URSS.
3/ La faiblesse économique et atomique de l’URSS (de 1945 à 1949)
Sur le plan humain, l’URSS a été dévastée par la guerre contre l’Allemagne nazie car la guerre a eu lieu sur son sol, ce qui n’est pas le cas des USA. Longtemps minorées par STALINE (7 millions de victimes), revues ensuite par Nikita KROUCHTCHEV dans le sens de leur triplement, les pertes de l’URSS, après l’ouverture des archives sous le dernier dirigeant soviétique Mikhaïl GORBATCHEV, s’élèveraient à 26,6 millions de morts, dont 12 millions de soldats et 14,6 millions de civils.
Sur le plan de l’habitat, les pertes matérielles subies par l’URSS n’en étaient pas moins dramatiques : plusieurs milliers de villes (1700) et de villages (70 000) détruits correspondant au logement de 25 millions de personnes [32].
Quant à l’outil de production industriel près de 32 000 usines furent détruites qui employaient 4 millions de salariés, et l’on recensait également la destruction de 65 000 kms de voies ferrées, de plus de 4 000 gares, de près de 16 000 locomotives et de 428 000 wagons [33].
En ce qui concerne l’outil de production agricole, l’on relevait l’endommagement de près de 100 000 kolkhozes et 1876 sovkhozes et de près de 3000 machines agricoles ; une perte considérable du cheptel : 7 millions de chevaux ; 20 millions de porcs, 17 millions de bovins ; 27 millions de moutons [34].
L’estimation des pertes soviétiques traduites en roubles était de l’ordre de 2 trillions 596 milliards. L’Ukraine, la Biélorussie, les Républiques baltes, la République moldave et la partie occidentale de la République russe – la plus riche et la plus peuplés – sont dévastées [35]. L’URSS sort de la guerre exsangue (= vidée de sa substance, dépourvue de force) économiquement, même si elle paraît politiquement forte au plan européen.
C’est pour pallier la faiblesse économique de l’URSS que, dans son discours du 9 février 1946 à l’adresse des électeurs de MOSCOU, STALINE annonce le quatrième plan quinquennal (1946-1950).
Ci-dessous ( photo de 1947) :
La centrale électrique de Dnieprogues,
construite sur le Dniepr (Ukraine)
en 5 ans (1927-32), avait constitué
le premier grand projet hydraulique de l’URSS.
Endommagée par la guerre, sa reconstruction
s’étagea entre 1944 et 1949 et la centrale
électrique redémarra en 1950. Elle constitue
l’une des dix premières centrales dont Staline
ait ordonné la remise en service après la guerre.
Cf. Histoire : « Grands barrages et construction du
socialisme : l’exemple de Dnieprogues »
Alain Beltran
 Ce IVe plan quinquennal et le Ve, à partir de 1950, vont mettre, comme les précédents, l’accent sur la nécessité de continuer à donner la priorité à l’industrie lourde : production d’acier, développement des machines-outils, essor de l’industrie chimique, de la politique énergétique, du réseau de transport. Enfin, la répartition géographique de l’industrie soviétique doit répondre à plus de considérations d’ordre stratégique et militaire qu’économique. La dispersion des nouvelles usines sur l’ensemble du territoire de l’Union a pour objectif, dans le prolongement des trois premiers plans quinquennaux, d’accentuer l’autonomie économique et militaire des diverses régions de l’URSS.
Ce IVe plan quinquennal et le Ve, à partir de 1950, vont mettre, comme les précédents, l’accent sur la nécessité de continuer à donner la priorité à l’industrie lourde : production d’acier, développement des machines-outils, essor de l’industrie chimique, de la politique énergétique, du réseau de transport. Enfin, la répartition géographique de l’industrie soviétique doit répondre à plus de considérations d’ordre stratégique et militaire qu’économique. La dispersion des nouvelles usines sur l’ensemble du territoire de l’Union a pour objectif, dans le prolongement des trois premiers plans quinquennaux, d’accentuer l’autonomie économique et militaire des diverses régions de l’URSS.
Les conditions de vie sont dures pour les soviétiques et le rationnement subsiste jusqu’en 1947, les rations n’étant pas toujours très fortes (400 grammes de pain pour les ouvriers et les employés).
Sur le plan militaire, malgré une démobilisation d’une partie de l’armée rouge dès la fin de la guerre contre l’Allemagne, la situation internationale ne permet pas une compression du budget militaire, vu l’avance des USA après l’explosion, en 1945, des bombes sur HIROSCHIMA et NAGASAKY. L’URSS est donc condamnée à une course aux armements avec la nécessité de créer une industrie nucléaire et spatiale.
Mais il est difficile de développer une industrie atomique et de développer en même temps des biens de consommation courante, ce qui explique que le revenu national soviétique soit très inférieur au revenu national américain (le quart en 1945) car l’URSS – considérant qu’elle ne peut pas laisser aux seuls Etats-Unis le monopole de la possession de l’arme atomique – est contrainte de dépenser 4 fois plus que les américains pour se doter de l’arme nucléaire.
Or la première bombe atomique soviétique ne va être expérimentée seulement qu’à partir de 1949.
En effet, c’est le 29 août 1949, à Semipalatinsk dans la steppe du KAZAKHSTAN que l’Union Soviétique teste sa première bombe atomique conçue à l’institut panrusse de recherche scientifique en physique expérimentale.
C’est dire que de 1945 à 1949 les USA dominent le monde.
Or l’équilibre de la Terreur – qui habituellement caractérise la « guerre froide » – ne peut être que postérieur à la possession par l’URSS de l’arme atomique qui ne se réalise, comme on l’a vu, qu’en août 1949.
B/ La date de l’expérimentation de la « guerre froide » dans un pays tiers
 L’expérimentation de la guerre froide sur un territoire tiers ne se réalise qu’à partir de 1950 avec la guerre de Corée.
L’expérimentation de la guerre froide sur un territoire tiers ne se réalise qu’à partir de 1950 avec la guerre de Corée.
Certes, comme l’a montré Henri MÉNUDIER, spécialiste des relations franco-allemandes, entre 1945 et 1949, les tensions, nombreuses, existent déjà entre les Alliés vainqueurs [36].
Et c’est d’abord le sort de l’Allemagne qui les divise [37] et entretient leurs désaccords quant à l’avenir de celle-ci. Et le divorce, à la fois idéologique et pratique, des deux superpuissances quant à la nouvelle configuration du monde post YALTA rend impossible toute solution globale du problème allemand.
Sous cet angle, 1947 est bien l’année de la rupture, celle de la naissance de deux blocs [38] dont certains historiens n’ont pas hésité à aller jusqu’à écrire qu’ils ne rejetteraient plus totalement l’hypothèse d’un affrontement armé, ce qui nous semble excessif.
En effet, la rupture d’une entente ou d’un accord ne signifie pas toujours guerre ou hostilité, mais le constat d’un échec dans un projet, ou l’existence d’un différend dans des rapports jusqu’alors relativement harmonieux, ce qui est assez fréquent dans les relations internationales.
Mais alors, comment ensuite aller jusqu’à affirmer que c’est le début de la « guerre froide » qui aura pour effet de diviser l’Allemagne et de provoquer, à partir de 1948, le processus qui va conduire, en mai puis octobre 1949, à la création de deux États allemands [39], de geler les lignes de confrontation en Allemagne et en Europe?
Bien que l’année 1947 soit généralement considérée comme le début de la guerre froide, la guerre de Corée – qui constitua un marqueur important de la naissance de la guerre froide – a été à la fois postérieure à cette date ainsi qu’au pacte de l’OTAN lui-même. En effet, la partition de la Corée intervenue le 10 août 1945, oppose, à partir du 25 juin 1950 et jusqu’au 27 juillet 1953, la République de Corée (Corée du Sud), soutenue par les USA et les Nations Unies, à la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), soutenue par la République populaire de Chine et l’Union soviétique.
Le veto de l’URSS au sein du Conseil de sécurité de l’ONU sur le règlement du conflit coréen est le début du grippage du système onusien. Pour le contourner, la résolution – dite 377 (V) (résolution « Union pour le maintien de la Paix ») – adoptée le 3 novembre 1950 à l’initiative du Secrétaire d’État américain Dean ACHESON, étend les compétences de l’Assemblée Générale de l’ONU en matière de maintien de la paix. Si sa finalité vise surtout à anesthésier l’opposition de l’URSS, sa légalité est incontestablement douteuse au regard des principes de la Charte des Nations Unies.
C/ Une naissance et une pratique déjà discutables
1/ La société internationale et le maintien de la paix
Sur le strict plan du droit, le regretté Roland WEYL – qui fut, au Barreau de Paris, un éminent avocat au service des causes justes durant toute sa vie professionnelle et militante – a rigoureusement et lumineusement démontré, dans un article intitulé « L’OTAN et la légalité internationale », l’illégalité de la constitution de l’OTAN par rapport à la Charte de l’ONU. Nous n’y revenons pas et renvoyons volontiers sur ce point à son excellent article que nous avons eu l’honneur et le plaisir de publier le 23 avril 2017, sur notre site [40].
Comme nous l’avons rappelé, l’OTAN a été d’abord créée comme un système collectif de défense contre l’expansion du communisme en Europe (doctrine TRUMAN). Dans notre droit moderne de reconnaissance d’États souverains dans la diversité de leurs régimes politiques respectifs, c’était la première fois qu’un traité d’alliance était ainsi orienté contre une doctrine politique que les membres de l’Alliance atlantique ne partageaient pas et même combattaient, idéologiquement, avec l’actif concours de la CIA.
Or la société internationale ne reconnaît que des États et non des régimes politiques, chaque Etat, en application du principe de la souveraineté des peuples, étant libre de se doter du régime politique résultant de son libre choix.
Sur le plan de la légitimité d’une telle création, la construction alternative d’une aire régionale de défense collective comme l’OTAN ne saurait défendre des principes universels, comme ceux de l’ONU, dans le cadre d’une aire régionale – l’Atlantique nord -, et avec un nombre limité d’États qui ne représentent en 2022 qu’un peu plus de 15% du nombre des États souverains membres de la communauté internationale. À cela s’ajoute que l’absence, au sein d’une telle organisation, d’États-continents comme la Chine, l’Inde ou même la Russie rendent ses bases fragiles et davantage encore ses interventions dans des théâtres d’opérations pas seulement circonscrits, comme nous le verrons, à la zone originelle de l’Atlantique nord.
Par ailleurs, la proximité des dates respectives de création de l’ONU (1945) et de l’OTAN (1949) est troublante car l’ONU ne saurait, au moins en 1949, être considérée comme ayant failli à sa mission de gardienne de la paix et de la sécurité internationale pour justifier la création de l’OTAN.
Ce n’est, en effet, qu’à partir de la guerre de Corée, en 1950, que l’ONU va montrer ses limites et ses faiblesses puisqu’il faut construire – de manière d’ailleurs illégale – la résolution Dean ACHESON pour pallier le dysfonctionnement du Conseil de sécurité en lui substituant l’Assemblée générale des Nations-Unies alors dominée par les occidentaux. Mais le dispositif onusien du veto d’un membre permanent du Conseil de sécurité – trop vite dénigré comme générant l’impuissance de l’organisation – d’une part avait été instauré pour être utilisé en cas de divergences entre les membres permanents ; d’autre part reposait sur la nécessité du maintien du consensus entre les vainqueurs du second conflit mondial car la protection et la construction de la paix semblaient être à ce prix.
2/ En 1949, l’URSS constituait-elle une menace pour les États occidentaux ?
C’est le « péril communiste » qui est souvent mis en avant pour justifier l’OTAN et qui, assez paradoxalement, bien qu’ayant disparu depuis les années 1990-1991 avec l’implosion de l’ex URSS, continue d’être le motif déterminant de sa survie.
Mais, même en 1949, ce péril est-il vraiment aux portes de l’Europe occidentale ? Ainsi, en 1963, Jean VALLUY, ancien général de l’armée française [41], s’interroge sur la pertinence de la création de l’OTAN. Le fil conducteur de sa réflexion est le suivant : « Ce qui est ainsi indirectement posé c’est le problème déterminant du péril communiste, son ampleur, son acuité qui ont été à la source de la naissance et de la croissance de l’OTAN. Il importe d’en refaire un examen clinique complet sans braquer le radioscope sur un seul organe. » [42]
En fait, les deux blocs ne se forment qu’à partir de la constitution du second bloc, le « bloc soviétique » qui ne se forme qu’à partir de la création du Pacte de Varsovie (1955) très postérieure à la naissance de l’OTAN. C’est dire que l’alliance occidentale atlantique n’était donc pas, en 1949, une « réponse » à la « guerre froide » mais en était, au contraire, un élément originaire, annonciateur et constitutif.
C/ La riposte du Pacte de Varsovie à l’entrée de l’Allemagne dans l’OTAN (1955)
Ci-dessous, ancien drapeau du Pacte de Varsovie
 C’est l’adhésion de l’Allemagne au traité de l’OTAN qui conduit l’Union soviétique, à créer, le 14 mai 1955, avec le Pacte de VARSOVIE, sa propre alliance militaire défensive.
C’est l’adhésion de l’Allemagne au traité de l’OTAN qui conduit l’Union soviétique, à créer, le 14 mai 1955, avec le Pacte de VARSOVIE, sa propre alliance militaire défensive.
En effet, par les accords de Paris de 1955 signés le 23 octobre 1954 et ratifiés le 9 mai 1955 par tous les pays européens et américains, la République fédérale d’Allemagne, « en voie de remilitarisation », est autorisée à entrer dans l’OTAN. Les accords de Paris créent également l’Union de l’Europe occidentale [43] qui donne une nouvelle vigueur au traité de Bruxelles signé le 17 mars 1948.
Réplique de l’OTAN, le Pacte de VARSOVIE regroupe les pays d’Europe de l’Est avec l’URSS dans un vaste ensemble économique, politique et militaire. Il est conclu entre l’URSS et la plupart des pays communistes du bloc soviétique sous la forme d’un traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle.
 Le Pacte de Varsovie – signé le 14 mai 1955 (ci-contre) – réunit les 8 pays suivants : 1/ Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) ; 2/ République populaire d’Albanie, (qui sort du pacte le 13 septembre 1968) ; 3/ République démocratique allemande (ex RDA) ; 4/ République populaire de Bulgarie ; 5/ République populaire de Hongrie ; 6/ République populaire de Pologne ; 7/ République populaire roumaine ; 8/ République tchécoslovaque.
Le Pacte de Varsovie – signé le 14 mai 1955 (ci-contre) – réunit les 8 pays suivants : 1/ Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) ; 2/ République populaire d’Albanie, (qui sort du pacte le 13 septembre 1968) ; 3/ République démocratique allemande (ex RDA) ; 4/ République populaire de Bulgarie ; 5/ République populaire de Hongrie ; 6/ République populaire de Pologne ; 7/ République populaire roumaine ; 8/ République tchécoslovaque.
V/ OU VA l’OTAN ? LA SURVIVANCE DE LA « GUERRE FROIDE » : l’OTAN et LA CONQUETE DE l’EST
A/ L’extension de l’OTAN
1/ Des membres originaires à l’extension des années 50 et 80
Il y a lieu de rappeler qu’à l’origine, l’OTAN compte seulement 12 pays fondateurs : ETATS-UNIS ; CANADA ; ROYAUME-UNI ; FRANCE ; BELGIQUE ; PAYS-BAS ; LUXEMBOURG ; ITALIE ; PORTUGAL ; DANEMARK ; ISLANDE ; NORVEGE.
À ses douze membres fondateurs, l’OTAN ajoute, du 18 février 1952 au 6 mai 1955, trois autres nouveaux pays : GRÈCE (1952) ; TURQUIE (1952) (# article 10 du Traité mais position stratégique car frontières à l’est avec certaines républiques de l’ex URSS) ; ALLEMAGNE (1955).
Un quatrième membre, l’ESPAGNE, rejoint l’Alliance le 30 mai 1982 [44]. À noter que sous FRANCO, à partir de 1953, l’Espagne est associée au système occidental de défense du fait de ses accords directs avec les États-Unis (accords de Madrid du 23 septembre 1953) qui prévoient l’installation sur le territoire espagnol de quatre bases militaires en échange d’une reconnaissance diplomatique et d’un soutien économique et militaire.
2/ La conquête de l’Est (14 nouveaux États entre 1997 et 2020)
Ci-dessous, carte extraite du « Monde Diplomatique »
N° 159 juillet 2018 « La nouvelle guerre froide
L’OTAN aux portes de la Russie »

L’extension de l’OTAN aux portes de la RUSSIE résulte de son élargissement aux pays de l’Est et s’effectue entre 1997 et 2002 par l’adjonction de 10 nouveaux partenaires, puis entre 2009 et 2012 par l’adhésion de 4 nouveaux partenaires à l’occasion de la série des « sommets » suivants :
- le sommet de Madrid du 7 juillet 1997 se traduit par l’élargissement à l’Est au sein de l’Alliance avec l’entrée de trois nouveaux partenaires : POLOGNE, HONGRIE et RÉPUBLIQUE TCHÈQUE.
- le sommet de Prague du 21 novembre 2002 intègre à l’OTAN les 7 nouveaux pays suivants : la BULGARIE, L’ESTONIE, LA LETTONIE, LA LITUANIE, LA ROUMANIE, LA SLOVAQUIE et la SLOVÉNIE. À propos de l’intégration des trois pays baltes, l’OTAN, sur son site « NATO » écrit, comme un bulletin de victoire, le 23 mars 2004 : « L’Alliance va étendre ses frontières aux portes de la RUSSIE en acceptant les trois républiques baltes, jadis annexées par l’Union soviétique ».
- l’ALBANIE et la CROATIE rejoignent l’Alliance le 1er avril 2009, un peu avant le sommet STRASBOURG-KEHL des 3 et 4 avril 2009 qui scelle le retour au sein de l’Alliance militaire de la France ;
- l’adhésion à l’OTAN du MONTÉNÉGRO s’opère le 7 juin 2017, et celle de la MACÉDOINE DU NORD le 27 mars
B/ Une extension à l’Est constamment contestée par la RUSSIE et contestable
1/ Le sommet de Malte (décembre 1989) et le dialogue BUSH/GORBATCHEV
Ci-dessous : au sommet de MALTE
le président américain George H. W. BUSH,
41ème président des USA (1989 à 1993),
et le dirigeant soviétique Mikhaïl GORBATCHEV
(1985-1991)
 Le sommet de Malte des 2 au 4 décembre 1989 [45] doit marquer la fin de la guerre froide. En effet, lors de cette réunion – qui se tient quelques semaines après la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989) – le président George H. W. BUSH (1989-1993) et le dirigeant soviétique Mikhaïl GORBATCHEV (1985 – 1991) déclarent mettre fin à la guerre froide [46].
Le sommet de Malte des 2 au 4 décembre 1989 [45] doit marquer la fin de la guerre froide. En effet, lors de cette réunion – qui se tient quelques semaines après la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989) – le président George H. W. BUSH (1989-1993) et le dirigeant soviétique Mikhaïl GORBATCHEV (1985 – 1991) déclarent mettre fin à la guerre froide [46].
Certes, aucun document officiel n’est signé lors de ce « Sommet de Malte » car son but principal est de permettre aux deux superpuissances – les États-Unis et l’Union soviétique -, d’échanger leurs points de vue sur la nouvelle situation et d’apprécier les changements rapides qui viennent d’avoir lieu en Europe avec la chute du mur de Berlin. Dans l’esprit des deux dirigeants, ce sommet doit prendre acte de la fin officielle de la guerre froide et des tensions dans les relations Est-Ouest [47]. Ainsi le sommet de Malte de 1989 doit se traduire par un renversement de la plupart des décisions prises en 1945 lors de la conférence de Yalta.
À l’occasion de ce sommet, comme nous l’avons déjà souligné dans notre introduction, le premier Président G. BUSH promet à GORBATCHEV que le fait que les pays d’Europe de l’Est seront conduits à choisir librement leur régime politique n’entraînera pas pour les États-Unis une attitude expansionniste visant à en profiter pour développer et conforter leur présence en Europe par l’intermédiaire de l’OTAN.
Implicitement au moins, cela revient à dire que faire entrer dans l’OTAN des pays qui étaient, hier, dans le Pacte de Varsovie, reviendrait à « profiter » de la situation nouvelle créée par l’implosion de l’URSS.
Une telle interprétation est corroborée l’année suivante (1990) par l’assurance donnée à GORBATCHEV – bien qu’elle ne figure dans aucun traité formel – que si une Allemagne unifiée était autorisée à rester dans l’OTAN, il n’y aurait pas de déplacement de la juridiction de l’OTAN vers l’Est, « pas d’un pouce vers l’est » promet le secrétaire d’État américain James BAKER concernant l’expansion éventuelle de l’OTAN lors de sa rencontre avec le dirigeant soviétique Mikhaïl GORBATCHEV le 9 février 1990.
Les choses semblaient donc objectivement bien actées des deux côtés, à partir de la force des faits.
2/ Le sommet de Washington de 1990 (31 mai-4 juin 1990)
Ci-dessous, BUSH et GORBATCHEV
au Sommet de Washington (1990)
 Quelques mois plus tard, ces assurances sont renouvelées lors du sommet de Washington de mai/juin 1990 entre le président BUSH et GORBATCHEV. Lors de ce sommet de 4 jours GORBATCHEV est reçu par les américains dans l’euphorie et fêté comme un véritable héros, en tant que père et théoricien de la « Glasnost [48] » (« transparence ») et de la « perestroïka » [49](«la reconstruction »).
Quelques mois plus tard, ces assurances sont renouvelées lors du sommet de Washington de mai/juin 1990 entre le président BUSH et GORBATCHEV. Lors de ce sommet de 4 jours GORBATCHEV est reçu par les américains dans l’euphorie et fêté comme un véritable héros, en tant que père et théoricien de la « Glasnost [48] » (« transparence ») et de la « perestroïka » [49](«la reconstruction »).
Le 1er juin, les deux hommes signent un accord sur le désarmement chimique ainsi qu’une déclaration énonçant les grandes lignes du futur accord sur la réduction des armements stratégiques (S.T.A.R.T.)
Le 3 juin, Mikhaïl GORBATCHEV effectue une visite à Saint-Paul-Minneapolis, dans le MINNESOTA, avant de gagner San Francisco où il rencontre, le 5, le président sud-coréen Roh TAE WOO : ce second sommet confirme le rapprochement soviéto-sud-coréen.
Cette rencontre entre Mikhaïl GORBATCHEV et le président sud-coréen Roh TAE-WOO, à San Francisco, a rapidement ouvert la voie à l’établissement de relations diplomatiques complètes, le 30 septembre 1990, entre les deux pays. En quelques années, la nouvelle direction soviétique accepte la présence militaire américaine en Corée (comme elle l’avait accepté en Europe), tout en montrant un intérêt accru pour le dynamisme économique de la Corée du Sud, engagée depuis 1987, sur un processus de démocratisation [50].
Cette atmosphère de détente cordiale entre les deux « Grands » conduit, en août 1990, BUSH père à annoncer la fin de l’affrontement Est/Ouest, c’est-à-dire de la guerre froide et de la bipolarisation du monde. Les États-Unis sont remplis d’un sentiment de puissance estimant l’avoir gagnée sans affrontement militaire direct. En 1991, les deux principales organisations internationales des pays communistes, le COMECON [51], qui apportait un soutien économique, et le Pacte de Varsovie, qui apportait un soutien militaire, se dissolvent à leur tour.
3/ Le dégel des relations entre l’URSS et l’Allemagne (16 juillet 1990)
Ci-dessous : Le chancelier KOHL et GORBATCHEV
Mikhaïl GORBATCHEV recevra le prix Nobel de la paix
le 15 octobre 1990 « pour son rôle important dans le
processus de paix » et pour les heureuses conséquences
internationales de sa politique de perestroïka
 Abandonnant son attitude initiale hostile, l’URSS accepte, le 16 juillet 1990, l’appartenance à l’alliance atlantique de la future Allemagne unifiée. Cette décision » historique « , selon le chancelier KOHL, fait partie de l’un des huit points d’un accord conclu entre BONN et MOSCOU et annoncé par MM. KOHL et GORBATCHEV au terme de la visite à MOSCOU du chancelier ouest-allemand. Selon cet accord, l’Allemagne unie doit conclure un traité avec l’URSS pour le retrait » avant trois ou quatre ans » des troupes soviétiques de RDA et, en attendant cette échéance, les structures de l’OTAN ne s’appliqueront pas à l’actuel territoire est-allemand. Pendant cette période, les troupes des trois puissances occidentales pourront rester à Berlin. En outre, Bonn s’engage, en trois ou quatre ans, à réduire à 370 000 hommes les effectifs de la future armée allemande.
Abandonnant son attitude initiale hostile, l’URSS accepte, le 16 juillet 1990, l’appartenance à l’alliance atlantique de la future Allemagne unifiée. Cette décision » historique « , selon le chancelier KOHL, fait partie de l’un des huit points d’un accord conclu entre BONN et MOSCOU et annoncé par MM. KOHL et GORBATCHEV au terme de la visite à MOSCOU du chancelier ouest-allemand. Selon cet accord, l’Allemagne unie doit conclure un traité avec l’URSS pour le retrait » avant trois ou quatre ans » des troupes soviétiques de RDA et, en attendant cette échéance, les structures de l’OTAN ne s’appliqueront pas à l’actuel territoire est-allemand. Pendant cette période, les troupes des trois puissances occidentales pourront rester à Berlin. En outre, Bonn s’engage, en trois ou quatre ans, à réduire à 370 000 hommes les effectifs de la future armée allemande.
Si M. GORBATCHEV, malgré son opposition originelle, se résout à accepter définitivement l’idée que l’Allemagne unifiée puisse être totalement souveraine – ce qui implique qu’elle peut choisir d’appartenir à l’alliance militaire de son choix -, en échange il obtient qu’elle s’engage à renoncer aux armes ABC : A pour atomiques, B pour bactériologiques, C pour chimiques.
À l’issue des discussions, les deux dirigeants donnent une conférence de presse commune – retransmise en direct par les télévisions russe et allemande – au cours de laquelle le chancelier allemand Helmut KOHL souligne de manière lyrique l’importance historique de cet accord :
« Je pense que cette rencontre constitue une nouvelle apogée dans l’histoire des relations germano-soviétiques. Cela concerne à la fois la densité et l’intensité de nos discussions, que ce soit à Moscou, dans l’avion ou ici sur la terre natale du président Gorbatchev ».
L’accord est bien accueilli dans toutes les capitales occidentales, et notamment à WASHINGTON où le porte-parole du département d’Etat américain n’hésite pas à déclarer que » cette solution sert au mieux les intérêts de tous les pays d’Europe « .
4/ La nouvelle administration Clinton et le problème de l’élargissement de l’OTAN : vers un changement de cap (janvier 1993-janvier 2001) [52]
Le froid et le chaud de la nouvelle administration CLINTON

Lors de son accès à la Maison Blanche, le 20 janvier 1993, Bill CLINTON démarre sa présidence moins de deux ans après la chute de l’Union soviétique ayant mis fin à la guerre froide. Très vite, l’une de ses priorités va être d’étendre l’influence de l’OTAN dans les pays de l’ancien bloc de l’Est en Europe afin d’accroître la « stabilité » (sic) de la région. Il se libéra ainsi unilatéralement du poids des assurances contraires qui, comme on l’a vu, avaient été données à la RUSSIE, au début des années 90, par son prédécesseur à la Maison Blanche.
Mais l’extension de l’OTAN aux pays d’Europe centrale et orientale voulue par la nouvelle administration CLINTON, à partir de septembre 1993, avec ses alliés européens, doit être progressive, sur une dizaine d’années, en incluant même l’adhésion simultanée de la RUSSIE, de l’UKRAINE et de la BIÉLORUSSIE.
En réponse, le président ELTSINE lui fait savoir que « l’esprit des accords de 1990 interdisait l’option d’étendre l’OTAN à l’Est ». Et publiquement, il déclare qu’il s’opposerait à une extension de l’OTAN qui exclurait la RUSSIE, ce qui serait d’autant plus « inacceptable » qu’elle saperait les bases de la sécurité en Europe.
Devant une telle détermination du dirigeant russe, le 22 octobre 1993, lors de sa visite en RUSSIE, le Secrétaire d’Etat américain s’empresse de donner tous apaisements à ELTSINE lui annonçant la création d’un « partenariat pour la paix » et l’exclusion de l’adhésion des pays de l’Est à l’OTAN en lui garantissant, en même temps, que tous les pays (dont la RUSSIE) seraient traités sur un pied d’égalité.
Non seulement ELTSINE prend acte d’une telle bonne résolution, mais il déborde même d’enthousiasme à la perspective de la création d’un partenariat pour la paix.
5/ La doctrine de la RUSSIE sur la paix en Europe : le sommet de BUDAPEST (1994)
Un an plus tard, en 1994, c’est à une totale volte-face que se livre le président CLINTON qui, lors de la réception du président ELTSINE à la Maison Blanche le 27 septembre 1994, tout en se voulant rassurant reprend le thème de l’expansion de l’OTAN en la lui présentant comme n’étant pas antirusse, ni destinée à exclure la RUSSIE, étant entendu qu’il n’y a pas de calendrier imminent. Cette situation objective explique que lors du sommet de la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) du 5 décembre 1994 à BUDAPEST, ELTSINE ne ménage pas sa critique magistrale de l’attitude de l’OTAN l’accusant de vouloir à nouveau diviser le continent européen et de vouloir instaurer une « paix froide ». De manière plus constructive, il développe l’idée de la constitution d’une « organisation paneuropéenne à part entière dotée d’une base juridique fiable ».

Ci-contre, Boris ELTSINE (1931-2007), ancien dirigeant russe (1990-1999) et adversaire coriace de Mikhaïl GORBATCHEV. Il fut notamment Président de la Fédération de Russie, de 1991 à 1999 (deux mandats successifs, dont le 2ème inachevé). Sa seconde présidence se caractérisa par des crises financières et politiques, ainsi que par des affaires de corruption.
Affaibli par la maladie, il démissionna le .
Vladimir POUTINE, qu’il avait nommé président du gouvernement quelques mois auparavant, lui succéda.
Ci-dessous : portrait officiel
Par Kremlin.ru, CC BY 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91861698
Ci-dessous les points saillants de son discours constituant les deux temps forts de son intervention :
« Notre attitude vis-à-vis des plans d’élargissement de l’OTAN, et notamment de la possibilité que les infrastructures progressent vers l’Est, demeure et demeurera invariablement négative. Les arguments du type : l’élargissement n’est dirigé contre aucun État et constitue un pas vers la création d’une Europe unifiée, ne résistent pas à la critique. Il s’agit d’une décision dont les conséquences détermineront la configuration européenne pour les années à venir. Elle peut conduire à un glissement vers la détérioration de la confiance entre la Russie et les pays occidentaux. […]
« La Russie attend également que sa sécurité soit prise en compte. […]
« Nous sommes préoccupés par les changements qui se produisent à l’OTAN. Qu’est-ce que cela va signifier pour la Russie ? L’OTAN a été créée au temps de la guerre froide. Aujourd’hui, non sans difficultés, elle cherche sa place dans l’Europe nouvelle. Il est important que cette démarche ne crée pas deux zones de démarcation, mais qu’au contraire, elle consolide l’unité européenne. Cet objectif, pour nous, est contradictoire avec les plans d’expansion de l’OTAN. Pourquoi semer les graines de la méfiance ? Après tout, nous ne sommes plus des ennemis ; nous sommes tous des partenaires maintenant. […]
« L’Europe, qui ne s’est pas encore libérée de l’héritage de la guerre froide, risque de plonger dans une paix froide. Comment éviter cela, telle est la question que nous devons nous poser. […] Les blocs de coalition militaire ne fourniront pas non plus de véritables garanties de sécurité. La création d’une organisation paneuropéenne à part entière, dotée d’une base juridique fiable, est devenue une nécessité vitale en Europe. […]
« L’année 1995 marque le cinquantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un demi-siècle plus tard, nous sommes de plus en plus conscients de la véritable signification de la Grande Victoire et de la nécessité d’une réconciliation historique en Europe. Il ne doit plus y avoir d’adversaires, de gagnants et de perdants. Pour la première fois de son histoire, notre continent a une réelle chance de trouver l’unité. Le manquer, c’est oublier les leçons du passé et remettre en question l’avenir lui-même. »
CLINTON lui fait une réponse sobre mais qui devient par la suite dans la bouche des dirigeants de l’OTAN et européens d’un grand classicisme autour du principe d’égalité des États appelés à faire partie des « élus » de l’OTAN (aucune exclusion d’Etat) ainsi qu’autour du principe de la liberté d’adhésion, aucun Etat ne pouvant opposer son veto à l’expansion de l’OTAN.
Un peu plus tard, en décembre 1994, le vice-président ALGORE part en mission à Moscou pour rassurer les russes autour des deux considérations suivantes : 1/ loin d’être rapide, l’expansion sera progressive, réfléchie, ouverte, transparente et sans surprises ; 2/ les discussions avec les russes seront franches et approfondies à chaque étape du processus.
ELTSINE n’est pas convaincu de la bonne foi des américains et le 10 mai 1995, lors du 50ème anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie il réitère son opposition : 1/ la persistance des occidentaux vers la voie de l’expansion serait une « humiliation » pour la RUSSIE ; 2/ Il est nécessaire de se doter d’une nouvelle structure pour la sécurité paneuropéenne et non revitaliser les anciennes ; 3/ s’il acceptait que les frontières de l’OTAN s’étendent vers la RUSSIE cela constituerait de sa part « une trahison envers le peuple russe ».
6/ La réaction de POUTINE en 2007 : l’avertissement du 10 février 2007 lors de la conférence annuelle sur la sécurité à MUNICH
Ci-dessous, Vladimir POUTINE
lors de son discours à la Conférence annuelle sur la sécurité
internationale le 10 février 2007 à MUNICH
NB : La Conférence de Munich sur la défense et la sécurité
fut fondée en 1962 par l’éditeur Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin.
Ell est aujourd’hui financée et organisée depuis 1998 par le service de
presse de la chancellerie fédérale allemande et se tient tous les ans
au mois de février à l’hôtel Bayerischer Hof de Munich.

– La contestation de l’ordre unipolaire américain et la dénonciation de la force dans les relations internationales (Balkans, Irak)
Le 10 février 2007, lors de son discours à la conférence annuelle sur la sécurité internationale qui se tient à MUNICH, POUTINE lance aux occidentaux un avertissement très ferme.
POUTINE met en cause l’idée, si populaire aux États-Unis dans les années 1990 et au début des années 2000, selon laquelle le système international est devenu unipolaire et la puissance de WASHINGTON incontestable. « Quelle que soit la manière dont on peut embellir ce terme, au bout du compte, il fait référence à un type de situation, à savoir un centre d’autorité, un centre de force, un centre de décision. C’est un monde dans lequel il y a un seul maître, un seul souverain ».
POUTINE rejette catégoriquement ce modèle. Ainsi visant implicitement les interventions militaires menées par les États-Unis dans les BALKANS et en IRAK, il déclare : « Aujourd’hui, nous assistons à une hyper utilisation presque incontrôlée de la force – la force militaire – dans les relations internationales, une force qui plonge le monde dans un abîme de conflits permanents. » « Et bien sûr », poursuit-il « cela est extrêmement dangereux. Cela aboutit au fait que personne ne se sent en sécurité. Je tiens à le souligner – personne ne se sent en sécurité ! »
– Les relations de la RUSSIE avec l’OTAN : l’OTAN aux frontières de la RUSSIE
Mais, surtout, c’est lorsque POUTINE passe de ces observations générales pour se concentrer sur les relations de la RUSSIE avec l’OTAN que ses objections et ses avertissements deviennent plus acides : « L’OTAN a placé ses forces de première ligne à nos frontières », bien que jusqu’à présent, nous « ne réagissions pas du tout à ces actions. » L’expansion de l’OTAN, déclare-t-il, « représente une grave provocation qui réduit le niveau de confiance mutuelle. Et nous avons le droit de demander : contre qui cette expansion est-elle destinée ? Et qu’est-il advenu des assurances données par nos partenaires occidentaux après la dissolution du Pacte de Varsovie ? »
Ci-dessous, POUTINE en 2007
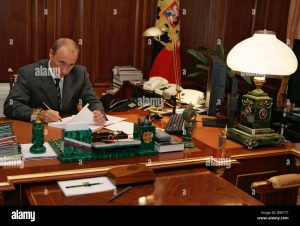 À l’objection d’un intervenant – selon lequel l’élargissement de l’OTAN (à l’Est), loin d’être un phénomène dangereux pour la RUSSIE, n’est pas une expansion mais plutôt l’expression de l’autodétermination d’États démocratiques qui le souhaitent avec le refus de l’OTAN d’accepter les États qui ne se déclareraient pas prêts à le faire, une telle expansion ayant rendu les frontières orientales plus fiables et plus sûres, ce qui implique qu’une OTAN plus grande est en fait bénéfique pour la sécurité de tous les pays d’Europe orientale, y compris la Russie -, POUTINE répond :
À l’objection d’un intervenant – selon lequel l’élargissement de l’OTAN (à l’Est), loin d’être un phénomène dangereux pour la RUSSIE, n’est pas une expansion mais plutôt l’expression de l’autodétermination d’États démocratiques qui le souhaitent avec le refus de l’OTAN d’accepter les États qui ne se déclareraient pas prêts à le faire, une telle expansion ayant rendu les frontières orientales plus fiables et plus sûres, ce qui implique qu’une OTAN plus grande est en fait bénéfique pour la sécurité de tous les pays d’Europe orientale, y compris la Russie -, POUTINE répond :
« En ce qui concerne la démocratie et l’expansion de l’OTAN, l’OTAN n’est pas une organisation universelle, contrairement à l’ONU. C’est avant tout une alliance militaire et politique, militaire et politique ! » Et il pose ensuite la question : « pourquoi est-il nécessaire d’installer des infrastructures militaires à nos frontières pendant cette expansion ? »
– Quand les critiques internes de Robert GATES rejoignent celles de POUTINE…
Déjà, en novembre 2006, à la suite des élections de mi-mandat remportées par les démocrates, Donald RUMSFELD démissionne. BUSH nomme alors l’ancien directeur de la CIA Robert GATES à ce poste. Dans ses mémoires Robert M. GATES [53] qui fut Secrétaire à la Défense sous les administrations de George W. BUSH et de Barack OBAMA (de 2006 à 2011) a fait des confidences intéressantes : « Lorsque j’ai fait part au président de mon point de vue sur la conférence de Munich, je lui ai fait partager ma conviction qu’à partir de 1993, l’Occident, et en particulier les États-Unis, avaient gravement sous-estimé l’ampleur de l’humiliation subie par la Russie en perdant la guerre froide… ».
Pourtant, même une telle appréciation tranchante donnée à BUSH n’a pas totalement rendu compte du point de vue de GATES [54] sur la question car il devait ajouter : « Ce que je n’ai pas dit au président, c’est que je pensais que les relations avec la Russie avaient été très mal gérées après le départ de [GEORGE H.W.] BUSH en 1993. ».
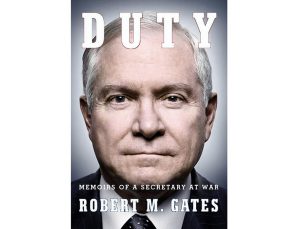
Parmi les autres erreurs, « les accords américains avec les gouvernements roumain et bulgare pour faire tourner les troupes à travers les bases de ces pays étaient une provocation inutile. » Dans un reproche implicite adressé à BUSH fils, M. GATES (ci-contre) affirme que « la tentative d’intégrer la GÉORGIE et l’UKRAINE dans l’OTAN était vraiment excessive ». Cette démarche, a-t-il soutenu, est un cas d’« ignorance imprudente de ce que les Russes considéraient comme leurs propres intérêts nationaux vitaux ».
Mais GATES n’est guère entendu par BUSH car, lors du sommet de l’OTAN à Bucarest des 2 au 4 avril 2008, BUSH persiste en intensifiant sa campagne de lobbying pour faire entrer l’UKRAINE et la GÉORGIE dans l’OTAN en demandant aux dirigeants présents au sommet annuel d’approuver la première étape du plan d’action pour l’adhésion de ces deux pays, ce que fort heureusement les gouvernements allemand et français considèrent comme trop risquée, ce qui conduit à l’adoption d’un communiqué de compromis. Toutefois cela n’empêche pas ce même document de compromis de déclarer que l’UKRAINE et la GÉORGIE deviendraient un jour membres de l’OTAN.

Ci-contre, Robert M. GATES, né en 1943 dans le KANSAS, est un homme politique américain, membre du Parti républicain et historien. Entre 1989 et 1991, durant la présidence de George H. W. Bush (père), il est conseiller adjoint au Conseil national de sécurité. Il est ensuite nommé directeur de la CIA, entre 1991 et 1993. Nommé Secrétaire à la Défense dans l’administration du président George W. Bush (fils) entre 2006 et 2009, il est maintenu à son poste par son successeur Barack OBAMA, entre 2009 et 2011.
Le discours de POUTINE à MUNICH n’était donc pas dépourvu de substance ni de pertinence, comme le montrent les critiques précitées de Robert GATES contre la ligne politique américaine postérieurement à 1993, à partir de l’arrivée de Bill CLINTON à la Maison Blanche puis de son successeur républicain George BUSH (fils) qui chaussa les mêmes bottes. Il reste que le discours de 2007 du dirigeant russe ne fut guère entendu par les occidentaux alors qu’il constituait un important avertissement diplomatique pour les États-Unis et leurs alliés, indiquant que la patience de la Russie face à l’empiètement de l’OTAN sur les frontières russes était arrivée à ses limites. Mais dans les années qui suivirent, les dirigeants occidentaux – et notamment l’Union européenne – continuèrent à griller de nombreux feux rouges.
Ainsi, en 2007, la ROUMANIE et la BULGARIE deux États bordant la Mer Noire – déjà membres de l’OTAN (2004) – deviennent membres de l’Union européenne [55]. L’ingérence scandaleusement arrogante des européens et surtout des américains dans les affaires politiques internes de l’UKRAINE en 2013 et 2014 pour aider les manifestants d’Euromaïdan à renverser le président Viktor IANOUKOVYTCH régulièrement élu le 7 février 2010 – mais étiqueté « pro-russe » – a été la provocation la plus effrontée, qui fit monter la tension en flèche entre l’UKRAINE et la RUSSIE et, en riposte, provoqua, du côté russe, l’annexion du territoire russophone de Crimée dans la nuit du 27 février 2014.
Les choses n’ont cessé d’empirer depuis lors, WASHINGTON déversant des armes et ses instructeurs et formateurs militaires en UKRAINE et traitant ce pays comme un client militaire.
Quant à la RUSSIE, inquiète pour sa sécurité et par cet incessant déploiement d’armes en Ukraine, elle commit la faute de riposter par l’invasion de l’UKRAINE le 24 février 2022, ce qui, outre la violation manifeste du droit international, eut comme effet pervers de re-légitimer un peu plus l’OTAN, à la plus grande satisfaction des « atlantistes » toujours inconditionnellement attachés à l’inféodation de la France et de l’Europe dans le bouclier américain…
Mais les choses ne s’arrêtèrent pas là, car sous la pression du conflit russo-ukrainien et des dirigeants de l’Ukraine, l’Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles le jeudi 23 juin 2022, a validé la candidature de l’Ukraine en vue de sa prochaine intégration au sein de l’Union. Il est vrai qu’une telle adhésion devrait prendre encore probablement quelques années, l’Ukraine, très en retard économiquement ainsi que dans sa lutte contre la corruption, ne répondant guère aux critères habituels de l’Union européenne pour son entrée au sein du club européen des 27.
Si les responsables de l’Union européenne se réjouirent de manière claironnante du franchissement de cette étape, à l’opposé, le porte-parole du Kremlin, Dmitri PESKOV, s’est contenté d’une déclaration aussi sobre que mesurée dans les termes suivants : « C’est une affaire interne à l’Europe… […] Il est très important pour nous que tous ces processus ne nous apportent pas plus de problèmes et qu’ils n’aggravent pas les relations entre les pays concernés et la Russie. Il y a déjà suffisamment de problèmes. Il est important que ces processus ne conduisent pas à une nouvelle détérioration de nos relations avec l’Union européenne, déjà au plus bas ».
L’extension de l’OTAN – comme aujourd’hui de l’Union européenne – à l’Est tranche avec ce que fut la discrétion de l’OTAN, hier, dans un monde bipolaire.
VI/ Retour sur les temps chauds de la « guerre froide » : l’OTAN d’hier et son grand silence dans un monde bipolaire (1949-1991)
Le grand silence de l’OTAN dans le monde bipolaire de tensions au lendemain de la libération de l’Europe du joug nazi fut le résultat logique du fait que l’OTAN – en application de son traité constitutif que nous avons analysé plus haut [56] – ne dut jamais faire face à une « menace » ni encore moins à une « agression » de l’URSS, ni davantage enfin de l’un des alliés de celle-ci contre l’un de ses États membres.
Si les moments de tension ne manquèrent pas – que ce soit en Europe lors du blocus de BERLIN (1949) ou de la construction du « MUR » (1961) ou enfin de la crise des missiles de CUBA en 1962 -, l’OTAN fut éclipsée par le face à face direct entre les USA et l’URSS qui exprimèrent deux formes d’impérialismes rivaux partout dans le monde, les USA revendiquant souvent s’exprimer au nom des occidentaux ou du « monde libre », comme s’ils étaient eux-mêmes l’émanation de l’OTAN.
La nature « bipolaire » du monde sous la domination des « deux grands » mit le couvercle de la protection de leur propre sécurité sur tous les conflits en ébullition débouchant ainsi sur la recherche de compromis.
A/ Les années de tension en Europe
De 1949 à 1990, il n’y eut aucun conflit entre États souverains en Europe, et l’OTAN ne fut jamais appelée à intervenir.
Néanmoins certains évènements disruptifs tragiques – qu’il ne faut pas oublier – se produisirent en Europe centrale au sein de certains Etats à l’intérieur desquels des révoltes populaires s’allumèrent pour libéraliser le régime communiste de ces démocraties populaires appartenant au bloc soviétique du Pace de Varsovie. Déjà, à Poznań, en Pologne, au sein des aciéries de la ville un mouvement ouvrier avait provoqué des grèves au printemps de 1956, et le 28 juin des manifestants s’insurgèrent contre les autorités. Ils furent vite réprimés par l’armée polonaise et des chars, mais leur dirigeant GOMULKA (1905-1982), premier secrétaire du comité central, réussit à obtenir le 19 octobre, des réformes de la part de Moscou. Est-ce le succès de ces négociations qui encouragea les hongrois à se révolter un peu plus tard, lors de l’insurrection de Budapest, du 23 octobre au contre le régime communiste hongrois mais elle .
Mais, même si aujourd’hui l’OTAN se plaît à célébrer l’insurrection hongroise de 1956, à l’époque, face à ces soulèvements contestant l’empire soviétique, les occidentaux s’abstinrent d’intervenir, considérant qu’il n’était pas question de remettre en cause les zones d’influence respectives entre les « deux grands », du moins en Europe (cf. Antoine MARES : « De la relativité des grands événements : l’année 1956 en Europe centrale et la révolution hongroise », in Matériaux pour l’histoire de notre temps 2006/3 (N° 83), pages 4 à 11).
En revanche, les conflits autour de BERLIN entre les « deux grands » constituèrent une menace pour la paix et à ce titre méritent d’être rappelés.
1/ Le contexte : du protocole de LONDRES (12 septembre 1944) aux accords de POSTDAM (17 juillet au 2 août 1945)
Le protocole de Londres du 12 septembre 1944 avait été signé entre l’URSS, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Celui-ci stipulait que « l’Allemagne, à l’intérieur de ses frontières telles que celles-ci existaient au 31 décembre 1937, sera divisée pour les besoins de l’occupation en trois zones, une de ces zones étant attribuée à chacune des trois Puissances, et en une zone spéciale pour Berlin, qui sera occupée conjointement par les trois Puissances » [57].
Les trois zones dites « occidentales » étaient à l’ouest du pays occupé tandis que la zone russe était à l’Est et comprenait, en son sein, BERLIN, l’ancienne capitale du Troisième Reich.
La gouvernance conjointe de l’Allemagne occupée devait être dirigée au sein du Conseil de contrôle allié (CCA). Un peu plus tard, après la conférence de YALTA de février 1945, la France finit par obtenir, elle aussi, une zone d’occupation.
Lors de la conférence de POSTDAM (17 juillet au 2 août 1945) ses participants (USA, URSS et GRANDE BRETAGNE) s’étaient mis d’accord pour démilitariser l’Allemagne, modifier ses frontières à l’Ouest, selon la ligne Oder-Neisse au profit de la POLOGNE, et conduire une politique de dénazification avec le jugement des criminels de guerre nazis
Mais à partir de 1948 avec le projet des occidentaux d’aller vers la création d’un Etat allemand au sein de leur zone, les choses se gâtèrent entre les Alliés d’hier.
Dans la vision occidentale de la guerre froide on s’abstient souvent de rappeler les causes à l’origine du blocus de Berlin par les soviétiques, alors qu’elles sont très directement liées à la question allemande et à l’application des accords de POSTDAM.
En effet, entre les Alliés, les choses se gâtèrent en 1948, lorsque la France, les USA et la Grande-Bretagne proposèrent la création d’un Etat fédéral allemand dans leur zone d’occupation.
2/ Le blocus de Berlin (24 juin 1948 au 12 mai 1949) et le statut de Berlin-Est
La résurrection d’un Etat allemand à l’Ouest était assimilée, par les Soviétiques, à la reconstruction d’une puissance centrale en Europe qui pourrait vite devenir une véritable menace pour la paix et sa sécurité. Ils s’efforcèrent donc de contrecarrer les projets relatifs à l’Allemagne de l’Ouest, car, en mars 1948, l’URSS s’était déjà retirée du CCA qui avait mis fin officiellement à la gouvernance quadripartite de l’Allemagne [58]. Par ailleurs cela revenait pour l’URSS à remettre en cause les accords de POSTDAM précités.
Ci-dessous, le « pont aérien » mis en place par les occidentaux
lors du blocus de BERLIN (24 juin 1948-12 mai 1949)
 En riposte, l’URSS décida le blocus de BERLIN, du 24 juin 1948 au 12 mai 1949. Les soviétiques coupèrent les communications terrestres entre l’enclave de Berlin-Ouest – répartie en secteurs anglais, américain et français – et la partie ouest de l’Allemagne occupée par les occidentaux. Enclavée dans la zone soviétique, BERLIN ne pouvait plus être ravitaillée ni par la route ni par le chemin de fer. Il s’agissait ainsi pour les soviétiques de mettre en échec la reconstitution d’un Etat allemand dans les zones occupées par les troupes françaises, britanniques et américaines.
En riposte, l’URSS décida le blocus de BERLIN, du 24 juin 1948 au 12 mai 1949. Les soviétiques coupèrent les communications terrestres entre l’enclave de Berlin-Ouest – répartie en secteurs anglais, américain et français – et la partie ouest de l’Allemagne occupée par les occidentaux. Enclavée dans la zone soviétique, BERLIN ne pouvait plus être ravitaillée ni par la route ni par le chemin de fer. Il s’agissait ainsi pour les soviétiques de mettre en échec la reconstitution d’un Etat allemand dans les zones occupées par les troupes françaises, britanniques et américaines.
Pour venir au secours des habitants de BERLIN, les occidentaux mirent en place un véritable pont aérien permettant aux USA le ravitaillement de la ville au cours duquel pendant la journée, toutes les deux minutes un avion ravitailleur se posait à l’aéroport de Berlin-Ouest.
De juin 1948 à mai 1949, 2,34 millions de tonnes de charbon, de produits alimentaires et de matériaux de construction furent ainsi acheminés.
Finalement, les soviétiques durent se résoudre à faire cesser le blocus en signant avec les américains, le 5 mai 1949, un accord mettant fin aux restrictions de circulation pesant sur Berlin-Ouest.
A la fin du blocus, le principe de la partition de l’Allemagne fut acté, et la République fédérale allemande (RFA) vit le jour, quelques jours plus tard, officiellement le 23 mai 1949, avec BONN pour capitale. Mais il a lieu de rappeler que le processus d’élaboration de sa « loi fondamentale » fut décidé par les occidentaux à partir du 1er septembre 1948, date à partir de laquelle le Conseil parlementaire – organe institué par les onze ministres-présidents des Länder des zones d’occupation américaine, britannique et française en Allemagne – commença ses travaux à Bonn. Ce Conseil, qui était composé de 65 délégués des onze Länder occidentaux – auxquels s’étaient ajoutés 5 représentants sans droit de vote pour Berlin-Ouest -, avait élu à sa tête le démocrate-chrétien Konrad ADENAUER. C’est ce Conseil parlemenaire qui adopta le la « loi fondamentale ». Celle-ci entra en vigueur le suivant, et le premier Bundestag, organe législatif du nouvel État, fut élu le 14 août 1949.
En réplique, quelques mois plus tard, l’URSS s’appuyant sur le Parti socialiste unifié d’Allemagne [59], son allié dans la zone occupée par l’Armée rouge, décida de créer la République démocratique allemande (RDA), le 7 octobre 1949, avec pour capitale Berlin-Est.
3/ Le mur de Berlin : le mur de la dissension sur la question allemande
Mur de Berlin (12 août 1961-9 novembre 1989)
 L’histoire du mur de Berlin a déjà été depuis longtemps écrite et sa fin justement célébrée en 1989. Encore faudrait-il, au moins aujourd’hui, en rappeler les causes profondes – pourtant connues mais volontiers occultées – et donc prendre conscience que sa construction aurait pu être évitée si un statut particulier pour BERLIN avait été décidé d’un commun accord entre l’URSS et les USA, suite à la proposition soviétique.
L’histoire du mur de Berlin a déjà été depuis longtemps écrite et sa fin justement célébrée en 1989. Encore faudrait-il, au moins aujourd’hui, en rappeler les causes profondes – pourtant connues mais volontiers occultées – et donc prendre conscience que sa construction aurait pu être évitée si un statut particulier pour BERLIN avait été décidé d’un commun accord entre l’URSS et les USA, suite à la proposition soviétique.
KHROUCHTCHEV voulait conclure la paix avec l’Allemagne et était opposé à sa division. Mais les positions occidentales et soviétiques étaient tellement figées à la suite de la constitution de l’OTAN et de la création des deux Républiques allemandes, la même année, en 1949, que ses propositions de novembre 1958 concernant BERLIN pour faire de celle-ci une « ville libre démilitarisée » ne trouvèrent guère d’écho dans le camp occidental.
En 1958, l’attitude occidentale par rapport à la proposition soviétique s’inscrivait comme la suite logique de la constitution de la RFA, le 5 mai 1949. En effet, l’article 23 de la Constitution du nouvel Etat ouest-allemand – approuvée par les Alliés – avait affirmé que la Loi fondamentale s’appliquerait aux Landers occidentaux mais aussi aux autres Landers au fur et à mesure de leur accession. Cela signifiait clairement que juridiquement la RFA s’estimait la seule héritière du Reich allemand dans ses frontières de 1937. De facto, les prétentions de la RFA étaient formulées comme ayant seule vocation à représenter toute l’Allemagne envers les pays tiers et aussi comme seule légitime à pouvoir réunifier le territoire allemand. C’est dire que de telles prétentions juridiques encourageaient la RFA à participer à la guerre froide en lui assignant un rôle agressif envers la RDA [60] et en entrant dans l’OTAN, ce qu’elle fit, comme nous l’avons vu, en 1955.
Pour les soviétiques l’enclave de Berlin dont une partie (Berlin Ouest) était sous l’administration militaire des occidentaux était devenue une anomalie d’autant moins acceptable que la ville se trouvait géographiquement en RDA érigé en Etat national est-allemand souverain à partir du 7 octobre 1949 en réplique à la constitution de la RFA, quelques mois auparavant.
Après l’échec du blocus de Berlin, l’URSS tenta, dix après, le 27 novembre 1958, de lancer un ultimatum exigeant le départ des troupes occidentales dans les six mois pour faire de BERLIN une « ville libre » démilitarisée. Mais les alliés occidentaux refusèrent tout net.
Le 10 janvier 1959, les soviétiques revinrent à la charge en proposant un Traité de paix de 48 articles selon lequel la RFA et la RDA s’engageaient à s’abstenir d’entrer dans toute alliance miliaire au sein de laquelle les USA, l’URSS, la GRANDE-BRETAGNE et la FRANCE ne seraient pas simultanément parties, ce qui était une condamnation implicite de l’organisation militaire de l’OTAN et du Pacte de VARSOVIE et appelait donc à une redistribution des cartes en Europe en invitant les deux Allemagne à sortir de l’OTAN et du Pacte de VARSOVIE avec, comme implication sous-jacente, la reconnaissance des frontières issues de la fin du second conflit mondial concernant ces deux États [61].
Devant le refus des occidentaux, KHROUCHTCHEV se dit prêt à signer deux traités séparés sur le sort des deux Allemagne, BERLIN devenant une ville libre.
En 1961, avec l’arrivée au pouvoir aux Etats-Unis du jeune Président KENNEDY, les choses n’avancèrent guère davantage, celui-ci mettant ses pas dans la politique de son prédécesseur – le prestigieux général Dwight EISENHOWER (1953-1961) – considérant qu’il était hors de question que les américains quittent BERLIN « ni progressivement ni par la force ».
La tension était encore accrue du fait que de nombreux citoyens allemands d’Allemagne de l’Est fuyaient leur pays, notamment à Berlin Est, pour passer à l’Ouest. Officiellement ce fut pour endiguer cette hémorragie démographique, que dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les autorités est-allemandes, soutenues par les soviétiques, construisirent un Mur à Berlin. Au début, ce furent des barbelés, une séparation de 155 km de long sous haute protection, qui encerclaient Berlin Ouest. Après les fils de fer barbelés qui encerclaient la moitié ouest de la ville, quelques semaines plus tard, ce fut un mur en béton, haut de 3,5 mètres, qui les remplaça, surplombé de miradors.
La RDA justifia la construction de ce mur en disant qu’il s’agissait d’un « mur antifasciste« , érigé pour des raisons de sécurité. Mais, en fait, selon Jérôme VAILLANT [62], Professeur émérite de civilisation allemande à l’Université Lille 3 et Directeur de la revue Allemagne d’aujourd’hui, la RDA estimait qu’elle « pourra se relever économiquement parce qu’elle aura mis un terme à la fuite de sa jeunesse et de ses capacités pour faire fonctionner le pays ».
Selon d’autres sources, la construction du mur de Berlin fut surtout conçue par les soviétiques pour contraindre WASHINGTON à prendre position sur les offres de paix de l’URSS [63], ce qui, compte tenu du contexte ayant précédé la construction du mur, doit être pris en considération, même si la bataille psychologique fut perdue par les soviétiques.
Vingt-huit ans après la construction du mur de Berlin, en novembre 1989, des Berlinois de l’Est le prirent d’assaut et en vinrent à bout en criant : « Nous sommes UN peuple, nous sommes le peuple ».
Les deux crises de Berlin furent les deux crises qui menacèrent la « paix européenne » au cours de la guerre froide (1949-1990) dans le monde bipolaire d’alors né au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Si l’OTAN n’intervint jamais en Europe, a fortiori n’est-elle jamais intervenue dans le reste du monde sous le contrôle des « Deux Grands », depuis YALTA, les laissant dans leur redoutable face à face.
B/ Les missiles de CUBA (octobre 1962) et les leçons d’un face à face
Le régime communiste de Fidel CASTRO à CUBA qui avait succédé, en 1959, à celui du dictateur BATTISTA devint vite la bête noire des américains.
1/ Les américains et CUBA : une longue histoire de présence et d’intérêts de la part d’une puissance impérialiste
Pour comprendre les relations complexes et ambigus que les Etats-Unis entretiennent avec CUBA un bref rappel historique est ici nécessaire.
En effet, il n’est pas inutile de se souvenir que CUBA était devenue indépendante de l’Espagne en 1898 à la suite de la guerre hispano-américaine qui fut un conflit armé opposant, d’avril à août 1898, les États-Unis d’Amérique à l’Espagne, avec pour conséquence la confirmation (à la suite de la guerre d’indépendance cubaine) de l’indépendance de Cuba jusqu’en 1901, et la prise de contrôle, par les Etats-Unis, d’anciennes colonies espagnoles dans les Caraïbes et l’océan Pacifique (Porto Rico, Guam et les Philippines) par les États-Unis d’Amérique.
Déjà, lors du traité de Paris du 10 décembre 1898 – qui marquait la fin de l’Empire colonial espagnol car les Espagnols renoncèrent à leur souveraineté sur les îles de CUBA, PORTO RICO, GUAM et les PHILIPPINES -, les États-Unis avaient empêché les délégués des anciennes colonies de participer aux pourparlers de paix, marquant ainsi un mépris total pour les luttes d’indépendance des peuples colonisés par les espagnols.
Ce ne fut que le 20 mai 1902 que naquit officiellement la République de Cuba, avec la prise de fonction de son premier président, Tomás Estrada PALMA. Mais le régime spécial américain sur CUBA, sorte de protectorat (« Gobierno de Intervención » = « gouvernement d’intervention ») ne prit fin que sous la présidence du libéral Miguel Mariano GÓMEZ qui dut d’ailleurs signer au préalable le bail du 2 juillet 1903 correspondant à la location de la base militaire dans la baie de GUANTÁNAMO.
Mais cette indépendance de l’île n’empêcha pas les USA d’intervenir à nouveau, en 1912, lors du soulèvement des populations noires de CUBA contre l’oligarchie des planteurs de l’île.
À partir de 1954 et jusqu’en 1959, le colonel BATISTA revint au pouvoir avec son élection à la présidence de la République et entretint un régime de corruption avec la MAFIA américaine et italienne faisant de l’’île un lieu de plaisir (casinos) et de transit pour le trafic de drogue grâce à l’emplacement stratégique de CUBA. Ces activités procuraient au régime des recettes considérables et BATISTA et ses proches en tirèrent des bénéfices personnels
CUBA fut longtemps considéré par les USA comme leur « chasse gardée » permettant la protection de leurs intérêts économiques locaux comme ceux de la United Fruit Compagny (UFCo) [64].
La révolution cubaine et la prise de pouvoir
par Fidel CASTRO (janvier 1959)
 Si pendant les années 1950, les États-Unis eurent une grande influence sur la politique de la république cubaine, tout changea lorsque, le 31 décembre 1958, l’avocat révolutionnaire Fidel CASTRO, appuyé par le guérillero CHE GUEVARA, s’empara du pouvoir à la suite d’une guérilla soutenue par la majorité des Cubains amorcée 5 ans plus tôt [65]. Cette prise de pouvoir contraignit Fulgencio BATISTA à s’enfuir aux États-Unis.
Si pendant les années 1950, les États-Unis eurent une grande influence sur la politique de la république cubaine, tout changea lorsque, le 31 décembre 1958, l’avocat révolutionnaire Fidel CASTRO, appuyé par le guérillero CHE GUEVARA, s’empara du pouvoir à la suite d’une guérilla soutenue par la majorité des Cubains amorcée 5 ans plus tôt [65]. Cette prise de pouvoir contraignit Fulgencio BATISTA à s’enfuir aux États-Unis.
Au début, le nouveau régime politique de CUBA fut reconnu par le gouvernement des États-Unis dès janvier 1959. Mais lorsque le nouveau régime politique de La Havane commença à entreprendre des réformes de structure, et notamment la réforme agraire du 17 mai 1959 décidant la redistribution des plantations de sucre de la UFCo (United Fruit Company), les USA firent volte-face [66]. Et à peine cinq mois après la réforme agraire, ils encouragèrent les activités contre-révolutionnaires d’octobre 1959 prenant La Havane pour cible [67].
Déjà, dès avril 1959, à l’issue du voyage officiel à Washington de Fidel CASTRO, le vice-président Richard NIXON conclut hâtivement qu’il ne serait pas possible d’entretenir des relations constructives avec le nouveau régime et qu’il fallait le renverser notamment en armant et en entraînant militairement les exilés anticastristes.
De son côté, l’URSS, à partir de février 1960 avait établi des relations diplomatiques et commerciales avec CUBA. Aussi, en juin et juillet 1960 devant le refus des entreprises américaines de raffiner le pétrole soviétique, Fidel CASTRO répliqua en nationalisant les sociétés américaines à Cuba.
Devant cette politique défavorable aux intérêts économiques américains dans l’île et le rapprochement de CUBA avec l’URSS – à ses yeux coupable -, en janvier 1961, le gouvernement de Dwight EISENHOWER rompit toutes relations diplomatiques avec CUBA et Washington mit en place un embargo économique et financier contre l’île. Un peu plus tard, sous la présidence de son successeur JF KENNEDY, en avril 1961, les USA participèrent à l’expédition de la baie des cochons [68] apparemment entreprise exclusivement par des exilés cubains [69] (les américains devant être invisibles) destinée à renverser le régime de Fidel CASTRO, laquelle, comme on le sait, fut un cinglant échec [70].
2/ La crise des fusées de CUBA (14-28 octobre 1962)
 La tentative de renversement du régime politique cubain, avec l’intervention des USA, en avril 1961, lors de l’expédition de la baie des cochons organisée par la CIA, était un acte d’ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat souverain et indépendant, et même un acte d’hostilité guerrière, nonobstant l’absence formelle d’une déclaration de guerre. Elle était la suite négative de la détérioration des relations entre les USA et CUBA du seul fait des prétentions américaines à vouloir maintenir cet Etat sous sa domination économique et politique [71].
La tentative de renversement du régime politique cubain, avec l’intervention des USA, en avril 1961, lors de l’expédition de la baie des cochons organisée par la CIA, était un acte d’ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat souverain et indépendant, et même un acte d’hostilité guerrière, nonobstant l’absence formelle d’une déclaration de guerre. Elle était la suite négative de la détérioration des relations entre les USA et CUBA du seul fait des prétentions américaines à vouloir maintenir cet Etat sous sa domination économique et politique [71].
Les relations de CUBA avec l’URSS furent complexes et ne peuvent objectivement qu’inviter « à relativiser la notion de satellisation et à analyser les intérêts nationaux et internationaux de l’URSS et de CUBA pour comprendre comment ces deux entités ont pu établir un consensus leur permettant de développer et de préserver leurs relations. » [72]
Il n’est pas inutile de rappeler qu’au départ la victoire de Fidel CASTRO contre le dictateur BATISTA s’inscrivait davantage dans la tradition nationaliste révolutionnaire cubaine que dans celle de la révolution léniniste de 1917, ce qui explique que dès sa nomination comme Premier ministre, le 13 février 1959, Fidel CASTRO, qualifiant lui-même sa révolution d’« humaniste », revendiqua la recherche d’une troisième voie autonome rejetant à la fois le capitalisme et le communisme,
Ci-dessous, le prosélytisme de Fidel CASTRO
prônant la révolution cubaine comme modèle
pour les autres pays latino-américains devant
conquérir leur libération par des luttes armées
 À travers son soutien aux luttes armées dans les autres pays latino-américains (PANAMA, République de SAINT-DOMINGUE, HAÏTI), CASTRO, en même temps qu’il s’efforçait d’offrir une digue protégeant CUBA de l’impérialisme nord-américain, espérait également, bien que sans le dire tout haut, prendre la tête d’un mouvement non aligné latino-américain mais il se heurta à son manque de moyens à mettre au service de ces États, à la méfiance des pays et acteurs concernés quant aux buts visés et à la constante vigilance des USA pour contrecarrer une telle visée contestataire généralisée de leur présence et de leur rôle dans un aussi vaste cadre géographique dont ils comptaient bien demeurer l’Etat gendarme sourcilleux de cette région des CARAÏBES et d’Amérique latine.
À travers son soutien aux luttes armées dans les autres pays latino-américains (PANAMA, République de SAINT-DOMINGUE, HAÏTI), CASTRO, en même temps qu’il s’efforçait d’offrir une digue protégeant CUBA de l’impérialisme nord-américain, espérait également, bien que sans le dire tout haut, prendre la tête d’un mouvement non aligné latino-américain mais il se heurta à son manque de moyens à mettre au service de ces États, à la méfiance des pays et acteurs concernés quant aux buts visés et à la constante vigilance des USA pour contrecarrer une telle visée contestataire généralisée de leur présence et de leur rôle dans un aussi vaste cadre géographique dont ils comptaient bien demeurer l’Etat gendarme sourcilleux de cette région des CARAÏBES et d’Amérique latine.
Ci-dessous, rencontre de Fidel CASTRO
et Nikita KHROUCHTCHEV en 1960
 L’on peut comprendre qu’après la tentative d’invasion de CUBA, en avril 1961, Fidel CASTRO ait décidé de se tourner vers l’URSS pour y trouver aide et protection. Une telle attitude n’a rien d’exceptionnel et fait même banalement partie des relations internationales et de l’histoire diplomatique de tous les pays de la planète, et ce, depuis des lustres, sans que pour autant il y ait perte d’identité de part et d’autre.
L’on peut comprendre qu’après la tentative d’invasion de CUBA, en avril 1961, Fidel CASTRO ait décidé de se tourner vers l’URSS pour y trouver aide et protection. Une telle attitude n’a rien d’exceptionnel et fait même banalement partie des relations internationales et de l’histoire diplomatique de tous les pays de la planète, et ce, depuis des lustres, sans que pour autant il y ait perte d’identité de part et d’autre.
Les Etats-Unis étaient eux-mêmes assez coutumiers d’une telle pratique dans leurs relations avec certains pays dits « amis » ou « alliés ». Déjà, à la fin de l’année 1961, les Etats-Unis avaient profité de leurs bases en TURQUIE et en ITALIE pour installer des rampes de missiles Jupiter dont les premières, en TURQUIE, constituaient une menace directe pour l’URSS.
Très vite, devant l’activisme des USA contre CUBA, comme en EUROPE contre l’URSS, les soviétiques comprirent que la défense de CUBA et de l’URSS se rejoignaient.
 C’est ainsi qu’en 1962 Nikita KHROUCHTCHEV et Fidel CASTRO décidèrent d’un commun accord de protéger l’île de CUBA de toute nouvelle intrusion américaine en y installant des rampes de missiles à tête nucléaire susceptibles d’atteindre directement le territoire des Etats-Unis, et notamment, les côtes de Floride dont MIAMI est situé à 425 km de CUBA [73].
C’est ainsi qu’en 1962 Nikita KHROUCHTCHEV et Fidel CASTRO décidèrent d’un commun accord de protéger l’île de CUBA de toute nouvelle intrusion américaine en y installant des rampes de missiles à tête nucléaire susceptibles d’atteindre directement le territoire des Etats-Unis, et notamment, les côtes de Floride dont MIAMI est situé à 425 km de CUBA [73].
La « crise des fusées de Cuba » éclata lorsqu’en avril 1962 des avions espions américains U2 détectèrent des travaux pour l’installation d’une base aérienne [74]. Sept mois plus tard, le 14 octobre 1962, les services américains acquirent la conviction qu’il s’agissait de rampes de lancement pour des missiles que l’URSS était en train de livrer à Fidel CASTRO.
Ci-dessous, le Président J.-F. KENNEDY
en octobre 1962 lors de la crise de CUBA
 Le 16 octobre 1962, le président KENNEDY convoqua le Conseil de sécurité national, qui prônait une action militaire directe. Mais Robert MCNAMARA, Secrétaire à la Défense (de 1961 à 1968) proposa un blocus maritime de l’île jusqu’au retrait des missiles de CUBA. Il s’agissait d’un blocus ne visant que l’approvisionnement en armes offensives. Il recommanda également au Président de ne pas porter l’affaire devant l’Organisation des Nations unies.
Le 16 octobre 1962, le président KENNEDY convoqua le Conseil de sécurité national, qui prônait une action militaire directe. Mais Robert MCNAMARA, Secrétaire à la Défense (de 1961 à 1968) proposa un blocus maritime de l’île jusqu’au retrait des missiles de CUBA. Il s’agissait d’un blocus ne visant que l’approvisionnement en armes offensives. Il recommanda également au Président de ne pas porter l’affaire devant l’Organisation des Nations unies.
La tension monta ensuite très rapidement jusqu’au 24 octobre, jour où KENNEDY prit la décision d’informer le peuple américain de la situation conflictuelle russo-américaine et du blocus maritime qu’il avait mis en place autour de CUBA. Pendant plusieurs jours, le monde vécut avec le spectre d’une guerre nucléaire, KENNEDY s’étant assuré du soutien de ses alliés (notamment du général de GAULLE) et KHROUCHTCHEV refusant de revenir sur sa position. KENNEDY se fit alors plus menaçant en lançant l’ultimatum suivant : si les Soviétiques ne démantelaient pas leurs installations avant le 29 octobre, les États-Unis lanceraient une attaque aérienne sur les sites de missiles.
Dans la soirée, Robert KENNEDY, procureur général des États-Unis (membre du Cabinet du président, son frère John, et dirigeant le département de la Justice) alla à l’ambassade de l’URSS à WASHINGTON pour une rencontre de la dernière chance avec le tout nouvel ambassadeur d’URSS, Anatoli DOBRYNINE.
Un compromis fut finalement trouvé le 28 octobre 1962 aux termes duquel, finalement, l’URSS acceptait de démanteler les rampes de lancement cubaines contre le démantèlement des rampes américaines en TURQUIE et en ITALIE et aussi la promesse que les USA renonçaient définitivement à envahir CUBA. Dès la mi-novembre, la promesse russe fut tenue, et la crise fut résolue pacifiquement. Le fameux téléphone rouge, ligne directe entre la Maison Blanche et le KREMLIN, fut installé peu de temps après.
3/ Les enseignements de la crise de CUBA
– Une pratique et une doctrine pour la paix dans le monde
Ci-dessous, le face à face KENNEDY-KHROUCHTCHEV
lors de la crise des missiles de CUBA (octobre 1962)
 L’issue de la crise des fusées de CUBA a insuffisamment été méditée au niveau de la pratique qu’elle a instaurée dans les relations internationales entre les « Deux Grands », de 1962 à 1975, au point de devenir une doctrine pour la paix bien que non écrite dont on serait bien avisés de s’inspirer aujourd’hui.
L’issue de la crise des fusées de CUBA a insuffisamment été méditée au niveau de la pratique qu’elle a instaurée dans les relations internationales entre les « Deux Grands », de 1962 à 1975, au point de devenir une doctrine pour la paix bien que non écrite dont on serait bien avisés de s’inspirer aujourd’hui.
L’enseignement des fusées de CUBA est que les systèmes d’alliances, quels qu’il soient, ne sauraient mettre en péril l’existence de l’un des « Deux Grands », et donc la paix dans le monde.
Certes, juridiquement, la société internationale étant composée d’États souverains et égaux, a priori, les systèmes d’alliance économique et militaire relèvent de la libre appréciation de ceux-ci, libres de nouer entre eux des systèmes d’alliances défensives.
CUBA, menacé par les américains, pouvait ainsi se placer sous la protection des fusées soviétiques et les soviétiques, à leur tour, étaient libres de répondre favorablement à cette demande d’aide et de protection.
Mais si au départ, CUBA, en tant qu’Etat indépendant et souverain – qui avait été de surcroît l’objet d’une tentative d’invasion fomentée par les services secrets américains avec l’aide de la guérilla anticastriste – était libre de rechercher l’appui des soviétiques pour se défendre, cette posture ne pouvait aller jusqu’à la mise en cause de la paix dès lors que les missiles russes étaient seulement à un peu plus de 400 kms des côtes de Floride, ce qui pouvait être considéré comme une menace pour la sécurité des américains.

Ci-contre, carte dessinant la portée des missiles de CUBA sur les Côtes de Floride américaines et sur le territoire des USA.
L’URSS fut sensible à l’argument et accepta de retirer ses fusées de CUBA trop près des côtes américaines. En effet, si les USA pouvaient accepter – d’ailleurs à contrecœur – l’aide que l’URSS apportait à CUBA, ils ne pouvaient se résoudre que dans le domaine militaire cela mette en péril leur propre sécurité dès lors que les côtes américaines de l’Atlantique seraient devenues vulnérables aux fusées soviétiques dont ne manquerait pas, en cas de besoin, faire usage CUBA.
Pourtant, l’argument exclusivement juridique de la souveraineté des États – invoqué constamment par les USA ainsi que par l’Organisation atlantique accueillante – est l’argument développée, aujourd’hui encore, par l’OTAN ainsi que par les candidats à l’entrée dans l’organisation militaire tels que l’UKRAINE, et tout récemment les États neutres que sont la FINLANDE et la SUEDE.
Déjà, comme on l’a vu, l’OTAN – avec l’accession en son sein des trois États baltes – s’était énorgueillie d’être arrivée aux portes de la RUSSIE (cf. supra V/ A, 2/ La conquête de l’Est), ce qui n’était pas, convenons-en, d’une grande cordialité ni encore moins finesse par rapport à leur interlocuteur russe.
– Charles de GAULLE et la prise de distance de la France par rapport au camp occidental « otanien » (1964-1969)
Pour ce qui est de la position de la FRANCE, si pendant la crise des missiles de CUBA le général de GAULLE ne manqua pas d’apporter son soutien immédiat et indéfectible au président KENNEDY (contrairement aux Britanniques), après la crise, en revanche, la FRANCE en tira les salutaires leçons qui s’imposaient. Comme nous l’avons vu, d’une part, la FRANCE prit ses distances à l’égard de l’Amérique, qui, sans consulter ses alliés, réglait les affaires du monde directement avec l’Union soviétique, et en fonction de ses propres intérêts. D’autre part, par l’intermédiaire de l’OTAN – qu’ils dominaient -, les USA pouvaient aussi nous entraîner dans un conflit hors des frontières de l’Europe et contraire à nos intérêts de puissance souveraine indépendante.
Deux ans plus tard, à l’automne 1964, le voyage de Charles de GAULLE en Amérique du Sud [75] lui donna l’occasion de positionner la FRANCE contre les « hégémonies » soviétiques et nord-américaines en Amérique du Sud.
En 1966, devait suivre, comme nous l’avons déjà analysé précédemment, le retrait de la FRANCE de l’alliance militaire de l’OTAN.
VII/ L’insaisissable « nouvelle doctrine » de l’OTAN en Europe
A/ Les prémisses (1953-1990)
 Dans un numéro des « Cahiers de la Fondation pour les études de Défense nationale » (Ed. Institut de stratégie comparée, collection « les sept Epées, cahier N°3, 112 pages) publiés en avril 1976, Janet FINKELSTEIN (1946-2011) avait essayé de dessiner ce qu’était l’existence d’une « nouvelle doctrine de l’OTAN aux Etats-Unis », entamée, selon elle, à partir de 1971, soit vingt ans avant la fin de la guerre froide. L’échec des USA en Indochine, leur parité nucléaire avec l’URSS, l’affirmation des pays européens et du Japon comme puissances économiques, puis la « détente » et la crise économique constituent autant d’éléments créant une situation internationale différente qui invitait les américains à adopter une nouvelle manière de penser les alliances.
Dans un numéro des « Cahiers de la Fondation pour les études de Défense nationale » (Ed. Institut de stratégie comparée, collection « les sept Epées, cahier N°3, 112 pages) publiés en avril 1976, Janet FINKELSTEIN (1946-2011) avait essayé de dessiner ce qu’était l’existence d’une « nouvelle doctrine de l’OTAN aux Etats-Unis », entamée, selon elle, à partir de 1971, soit vingt ans avant la fin de la guerre froide. L’échec des USA en Indochine, leur parité nucléaire avec l’URSS, l’affirmation des pays européens et du Japon comme puissances économiques, puis la « détente » et la crise économique constituent autant d’éléments créant une situation internationale différente qui invitait les américains à adopter une nouvelle manière de penser les alliances.
Cette nouvelle situation internationale devait conduire les américains à reconsidérer quelle place ils entendaient assigner à l’Europe dans leur stratégie globale et donc à étudier la portée de leur offensive sur l’Europe de la CEE et de l’OTAN. Ce sont les réponses à ces questions que s’emploie à recenser Janet FINKELSTEIN dans son étude publiée dans les Cahiers précités.
L’auteure de l’étude a séjourné en 1975 aux Etats-Unis en côtoyant de nombreux experts américains de la côte Est. Sur le plan de ses investigations propres, elle s’est appuyée sur le dépouillement systématique de la littérature américaine consacrée au sujet. C’est ainsi qu’elle a pu recenser des informations fines sur les orientations de la politique de défense américaine telles qu’elles s’expriment notamment à travers les rapports gouvernementaux, les débats budgétaires, les consultations, réunions, travaux et délibérations (« hearings« ).
Sont également analysées dans son étude un état détaillé des recherches militaires en cours ainsi que des programmes en cours de réalisation, de même que les décisions relatives à l’acquisition de matériel de guerre.
A partir du milieu des années 70 – qui correspond, rappelons-le, à la crise des économies occidentales après le premier choc pétrolier -, la nouvelle stratégie des USA s’inscrit dans un modèle qui privilégie le rôle des facteurs socio-économiques faisant de l’OTAN l’instrument essentiel de la sauvegarde des intérêts américains en Europe, zone jugée vitale tant par l’importance de leurs investissements privés, que par sa dépendance dans laquelle elle se trouve par rapport aux pays producteurs de pétrole, ce qui explique, selon Janet FINKELSTEIN, le souci manifesté par les dirigeants américains de se doter des moyens d’intervenir en Méditerranée [76], à la fois pour garantir la continuité des approvisionnements énergétiques et préserver l’homogénéité idéologique de la communauté atlantique. C’est d’ailleurs moins la valeur intrinsèque de la Méditerranée qui est en cause et au centre des préoccupations américaines que son importance stratégique relativement aux espaces eurasiatiques où se concentrent les intérêts vitaux américains, comme le montra d’ailleurs plus tard l’intervention américaine en Irak en 2003 comme nous le verrons plus loin. Quant au discours tenu aux européens, il insiste sur l’avantage découlant des progrès réalisés dans la précision des tirs ainsi que dans la miniaturisation des armes de type classique PGM (= precisions guided munitions), la production de celles-ci étant essentiellement guidée par la prise en compte de considérations commerciales (« cycle de production industrielle et de reproduction du capital »)
Janet FINKELSTEIN a intégré également dans son analyse la « doctrine Schlesinger », du nom donné par la presse à la révision majeure de la politique de frappe nucléaire des États-Unis annoncée en janvier 1974 par le secrétaire américain à la Défense James SCHLESINGER nommé le 10 mai 1973 par Richard NIXON.
Mais cette doctrine est elle-même le résultat d’une évolution de la doctrine nucléaire américaine.
1/ L’évolution des doctrines nucléaires américaines de 1953 aux années 80 : DULLES, McNAMARA, SCHLESINGER
– La doctrine DULLES (1953-54-1962) : les « représailles massives »
La première doctrine de dissuasion nucléaire adoptée pendant la guerre froide par les États-Unis, de 1953-54 à 1962, était la doctrine Dulles, dite des « représailles massives », du nom de John FOSTER DULLES (1888-1959), secrétaire d’État des États-Unis entre 1953 et 1959 dans le gouvernement du président Dwight D. EISENHOWER. Son principe était qu’en cas d’attaque des États-Unis ou de leurs alliés par l’URSS, les États-Unis riposteraient de toutes leurs forces. Cette doctrine devint officiellement celle de l’OTAN en
Mais à partir de 1957 les choses changèrent car, avec l’envoi de spoutnik dans l’espace, les russes démontrèrent leur capacité à envoyer, à leur tour, un engin sur orbite, et donc à lancer un projectile sur un point de la Terre arbitrairement éloigné.
La doctrine des représailles massives était devenue d’autant moins crédible que les ennemis des États-Unis comme leurs alliés s’accordaient sur le fait qu’en cas d’invasion de Allemagne de l’Ouest par les troupes du Pacte de Varsovie, les États-Unis renonceraient vite à mettre en péril leur territoire et leur population, en n’hésitant pas à lâcher leurs alliés Européens, en s’abstenant d’utiliser leur arsenal stratégique pour leur venir en aide. Dans l’une de ces formules saisissantes dont il avait le secret, Charles de Gaulle résumait ainsi le dilemne : « les Américains ne sacrifieront pas Boston pour les beaux yeux des Hambourgeoises ».
– 1962 : la doctrine McNAMARA (1916-2009) : la « réponse graduée »
Secrétaire à la Défense de 1961 à 1968 sous les présidences KENNEDY et JOHNSON, Robert McNAMARA s’employa à faire abandonner la précédente doctrine Dulles, dite des représailles massives, pour éviter d’avoir à choisir entre laisser les Soviétiques attaquer l’Europe sans réagir et une destruction massive des deux camps. Apparue en 1962, cette nouvelle doctrine de l’utilisation graduée de l’arme nucléaire américaine (avec plus ou moins de puissance) s’attachait à prendre en compte le niveau de la menace présente et réelle.
En cas d’attaque limitée des Soviétiques en Europe, la doctrine avait pour but d’éviter le déclenchement d’une apocalypse nucléaire démesurée au regard de l’enjeu, et d’éviter l’utilisation immédiate de tout l’arsenal nucléaire américain, afin de n’employer la bombe contre les villes qu’en dernier recours. Il s’agissait de rechercher une riposte graduée proportionnelle à l’attaque et sans risque de destruction planétaire.
La nouvelle doctrine constituait la réponse adaptée au fait qu’un conflit impliquant une invasion de territoires de l’un des deux grands ne déboucherait pas nécessairement sur un conflit nucléaire généralisé maximum, ce qui était certes rassurant pour la sécurité du monde, mais pas forcément rassurant pour la sécurité européenne dès l’instant que les USA cherchaient d’abord à se protéger eux-mêmes sans une prise de risque excessive mettant en jeu leur propre sécurité.
Pour les Soviétiques, la nouvelle doctrine signifiait la détermination des États-Unis à riposter à tout type d’attaque, et à utiliser leurs armes nucléaires comme moyens de destruction et non plus comme instrument de dissuasion. De ce fait, la menace était beaucoup plus crédible.
Assez paradoxalement cela déclencha une nouvelle course à des armements nucléaires plus sophistiqués et de portée plus réduite car il devenait nécessaire de disposer d’un important arsenal d’armes nucléaires plus faibles et d’armes classiques conventionnelles. La course aux missiles nucléaires succédait à la puissance de la bombe atomique.
– 1974 : la » nouvelle doctrine stratégique » SCHLESINGER » : la « réponse flexible »
La nouvelle doctrine stratégique « Schlesinger », du nom de James SCHLESINGER (1929-2014), secrétaire à la Défense de 1973 à 1975 sous les présidents Richard NIXON et Gerald FORD s’inspire de la doctrine McNamara des années 60 ainsi que des déclarations successives de M. Nixon à partir de 1970. Mais le concept central de la stratégie nucléaire de SCHLESINGER est celui de « réponse flexible ». Elle permet au président des États-Unis d’avoir à sa disposition, en cas de crise, d’autres options que celle qui consisterait à attaquer immédiatement les villes de l’ennemi, attirant ainsi sur son pays la destruction de ses propres cités. Poursuivant l’analyse, M. Schlesinger faisait valoir qu’une telle menace était trop peu crédible pour convaincre un adversaire décidé que les États-Unis seraient prêts à employer la force pour défendre leurs intérêts, notamment dans une crise affectant l’un de leurs alliés. Il conviendrait donc de viser d’autres cibles que les villes ennemies, et de pouvoir aussi modifier rapidement l’inventaire de ces cibles suivant la nature et la localisation de la crise : c’est le principe du « retargeting », admis et mis en pratique par le Pentagone à partir de 1974. Ces autres cibles ne sont pas forcément les silos dans lesquels sont abritées les fusées adverses, mais plutôt des objectifs militaires, nucléaires ou non, des concentrations industrielles ou des nœuds de transports, la précision plus grande donnée aux fusées permettant, même dans ces cas, de limiter les » dommages collatéraux « , autrement dit les pertes excessives de vies humaines. Cette nouvelle stratégie était basée sur un certain nombre d’attaques de contre-force limitées qui «limiteraient les chances d’escalade incontrôlée» et «toucheraient des cibles significatives» sans causer de dommages collatéraux étendus.
 SCHLESINGER (ci-contre), économiste et fonctionnaire rompu aux questions d’énergie atomique et aux systèmes nucléaires, porta beaucoup d’attention à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Il préconisa impérativement de renforcer ses capacités conventionnelles en critiquant la vieille thèse selon laquelle l’OTAN n’aurait pas besoin de contrer directement les forces conventionnelles du Pacte de Varsovie car elle pouvait s’appuyer sur des armes nucléaires tactiques et stratégiques. Il objecta que la parité nucléaire approximative entre les États-Unis et les Soviétiques dans les années 1970 rendait une telle position tout à fait inappropriée. Il rejeta également l’argument selon lequel l’OTAN ne pouvait pas se permettre un contrepoids conventionnel aux forces du Pacte de Varsovie. Dans ses discussions avec les dirigeants de l’OTAN, SCHLESINGER a promu le concept de partage des charges, soulignant les problèmes auxquels les États-Unis étaient eux-mêmes confrontés au milieu des années 1970 en raison d’une balance des paiements internationaux défavorable. Il a appelé à des améliorations qualitatives dans les forces de l’OTAN, y compris la normalisation des équipements, et une augmentation des dépenses de défense par les gouvernements de l’OTAN préconisant d’aller jusqu’à 5% de leur produit national brut.
SCHLESINGER (ci-contre), économiste et fonctionnaire rompu aux questions d’énergie atomique et aux systèmes nucléaires, porta beaucoup d’attention à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Il préconisa impérativement de renforcer ses capacités conventionnelles en critiquant la vieille thèse selon laquelle l’OTAN n’aurait pas besoin de contrer directement les forces conventionnelles du Pacte de Varsovie car elle pouvait s’appuyer sur des armes nucléaires tactiques et stratégiques. Il objecta que la parité nucléaire approximative entre les États-Unis et les Soviétiques dans les années 1970 rendait une telle position tout à fait inappropriée. Il rejeta également l’argument selon lequel l’OTAN ne pouvait pas se permettre un contrepoids conventionnel aux forces du Pacte de Varsovie. Dans ses discussions avec les dirigeants de l’OTAN, SCHLESINGER a promu le concept de partage des charges, soulignant les problèmes auxquels les États-Unis étaient eux-mêmes confrontés au milieu des années 1970 en raison d’une balance des paiements internationaux défavorable. Il a appelé à des améliorations qualitatives dans les forces de l’OTAN, y compris la normalisation des équipements, et une augmentation des dépenses de défense par les gouvernements de l’OTAN préconisant d’aller jusqu’à 5% de leur produit national brut.
Les grandes lignes de la doctrine Schlesinger sont restées en vigueur jusqu’à la période de désarmement des années 1980, bien qu’elles aient subi de nombreuses modifications.
2/Les relations OTAN/RUSSIE : leur dégradation
Ces relations virent le jour dès 1991, mais elles furent suspendues dès l’annexion, en 2014, de la Crimée (Ukraine) par la RUSSIE.
Au départ, les relations entre l’alliance militaire OTAN et la Fédération de Russie avaient été établies en 1991 dans le cadre du « Conseil de partenariat euro-atlantique ».
C’est ainsi qu’ en 1994, la Russie adhéra au programme du « Partenariat pour la paix » et signa ensuite avec l’OTAN plusieurs accords de coopération importants.
En 2000, Vladimir POUTINE, avait même proposé l’idée d’une adhésion à l’OTAN de la Russie au président CLINTON, lors d’une visite à Moscou. Bien avant lui, ELTSINE avait fait la même proposition en 1994 en subordonnant l’entrée des pays d’Europe centrale et orientale à l’entrée préalable de la RUSSIE dans l’OTAN. Mais sans jamais dire explicitement « non », les occidentaux furent toujours réticents. Ainsi, quant à lui, Malcolm RIFKIND, à l’époque, ministre britannique de la Défense, n’hésitait pas à exprimer ses craintes en ces termes : « En mon for intérieur, je n’avais aucun doute que la Russie ne pourrait jamais devenir membre à part entière de l’OTAN sans détruire l’objectif même de l’OTAN. »
C’est dire que l’OTAN a toujours constamment maintenu à distance la RUSSIE en lui fermant la porte de l’organisation : coopération, « oui » ; adhésion, « non ».
Mais faute d’une intégration de la RUSSIE dans l’organisation, et avec l’expansion à l’Est de l’OTAN sans la RUSSIE, les choses ne pouvaient que se dégrader. Et le brûlot ukrainien fit le reste.
En effet, le Conseil Russie-OTAN avait été créé en 2002 pour traiter des questions de sécurité et des projets communs. La coopération entre la Russie et l’OTAN se développait dans plusieurs secteurs importants : lutte contre le terrorisme, coopération militaire, coopération en Afghanistan (y compris le transport par la Russie de fret non militaire de la Force internationale d’assistance et de sécurité et la lutte contre la production locale de drogue), coopération industrielle et non-prolifération des armements.
Mais, suite à l’annexion de la Crimée par la Russie dans le cadre du conflit russo-ukrainien, le 1er avril 2014, l’OTAN décida, à l’unanimité, de suspendre la coopération avec la Fédération de Russie. Le 18 février 2017, Sergueï LAVROV, ministre russe des Affaires étrangères, déclara qu’il souhaitait la reprise de la coopération militaire avec l’OTAN. Les relations se dégradent encore plus significativement durant la crise diplomatique russo-ukrainienne débutée en mars 2021, suivie par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.
Lors du 28ème sommet de l’OTAN à Bruxelles (2021), le communiqué final de l’organisation atlantique déclare que « Tant que la Russie ne montre pas qu’elle respecte le droit international et qu’elle honore ses obligations et responsabilités internationales, il ne peut y avoir de retour à la normale ».
Parallèlement, l’OTAN manifeste à nouveau son « soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Ukraine, de la Géorgie et de la République de Moldova à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues ».
Enfin, l’Alliance condamne le renforcement du potentiel militaire conventionnel et nucléaire de la Russie et l’augmentation de ses activités militaires.
B/ Quelques sommets où l’OTAN se cherche un futur après la chute de l’URSS…
Depuis la fin de la chute de l’URSS, en Europe, la « nouvelle doctrine » de l’OTAN est d’autant plus difficile à appréhender qu’elle n’est guère visible entre les déclarations concluant les sommets de l’Alliance et la pratique de l’organisation qui n’a pas tiré toutes les conséquences logiques de ce qui aurait dû constituer la fin de la guerre froide. Cette tension entre « déclarations » et « pratique » résulte de l’héritage peu confortable et confus du positionnement de Bill CLINTON et de ses successeurs oscillant entre d’une part une politique de détente affirmant vouloir associer l’URSS à la construction d’un nouveau monde post guerre froide – et notamment à la carte d’une nouvelle Europe ; d’autre part, l’ouverture de l’OTAN à des pays de l’ancien bloc soviétique, ce qui engendre comme conséquence directe et principale de porter l’OTAN aux frontières de la RUSSIE, ce qui n’est pas un facteur de détente mais plutôt un acte de défiance vis-à-vis du Kremlin, comme en attestent d’ailleurs les réactions critiques et indignées de la RUSSIE que nous avons analysées plus haut…
1/ Le sommet de Londres de juillet 1990 : une main incertaine tendue à l’URSS
 Si la chute du mur de Berlin, en 1989, avait radicalement modifié la sécurité en Europe, l’URSS n’était pas encore dissoute et ne le sera qu’un an après. Dès juillet 1990, les dirigeants des pays de l’OTAN avaient évoqué l’impact de cet événement historique, en présentant, au sommet de Londres, des propositions pour développer la coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale. « (…) La Guerre froide appartient à l’histoire, notre Alliance est en train de passer de la confrontation à la coopération » déclarait le secrétaire général de l’OTAN Manfred WÖRNER dans son allocution d’ouverture.
Si la chute du mur de Berlin, en 1989, avait radicalement modifié la sécurité en Europe, l’URSS n’était pas encore dissoute et ne le sera qu’un an après. Dès juillet 1990, les dirigeants des pays de l’OTAN avaient évoqué l’impact de cet événement historique, en présentant, au sommet de Londres, des propositions pour développer la coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale. « (…) La Guerre froide appartient à l’histoire, notre Alliance est en train de passer de la confrontation à la coopération » déclarait le secrétaire général de l’OTAN Manfred WÖRNER dans son allocution d’ouverture.
Les débats se concentrent principalement sur le désarmement et sur les relations avec l’Union soviétique et les autres pays d’Europe centrale et orientale. Les dirigeants des pays de l’OTAN ont également envisagé une coopération passant par des activités politiques et militaires, ainsi que par l’établissement de liaisons diplomatiques régulières avec ces pays. Une autre conclusion, exprimée par le président américain George BUSH lors d’une intervention au Conseil, était que : « (…) nous devons construire une Alliance transformée pour la nouvelle Europe du XXIe siècle ».
Mais comment construire cette « nouvelle Europe du 21ème siècle »?
À Londres, l’OTAN voulait tendre une « main amicale » aux anciens pays du Pacte de Varsovie, en les invitant à nouer de nouvelles relations avec l’OTAN. Le compte rendu textuel exprime également le souhait de l’OTAN de s’ouvrir aux pays d’Europe centrale et orientale, sans pour autant isoler l’Union soviétique.
Le président français François MITTERRAND avait déclaré, « (…) nous devons tenir compte des intérêts de tous les pays européens, y compris ceux qui sont encore membres du Pacte de Varsovie, et (…) – je l’affirme sans hésitation – de l’Union soviétique ».
Pourtant, au fil des différents sommets de l’OTAN qui vont suivre, cet objectif d’intégrer l’URSS puis la RUSSIE dans la nouvelle Europe va être perdu de vue.
2/ Le sommet de Rome et le nouveau concept stratégique de l’OTAN du 7 novembre 1991 : un « ample concept de sécurité »
La réunion des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Alliance les 7 et 8 novembre 1991 à Rome a entretenu et accentué le flou quant aux objectifs de l’OTAN, mais aussi de l’Europe.
Ce qui fut mis en avant, lors de ce sommet, c’est que la diversité des défis auxquels était confrontée l’Alliance nécessitait l’adoption d’une conception large de la sécurité. La transformation du contexte politique et stratégique devait permettre à l’Alliance de changer un certain nombre de caractéristiques importantes de sa stratégie militaire et de dresser de nouvelles orientations, tout en maintenant ses principes fondamentaux déjà éprouvés. Au Sommet de Londres, il a donc été décidé d’établir une nouvelle stratégie militaire et un dispositif de forces révisé en fonction de l’évolution de la situation.
En temps de paix, les forces armées alliées ont pour rôle de protéger les pays membres contre les risques pesant sur leur sécurité, de contribuer au maintien de la stabilité et de l’équilibre en Europe et d’assurer la préservation de la paix. Elles peuvent apporter une contribution au dialogue et à la coopération dans l’ensemble de l’Europe en participant aux activités destinées à accroître la confiance, y compris celles qui augmentent la transparence et améliorent la communication, ainsi qu’à la vérification des accords de maîtrise des armements.
Les alliés pourraient, en outre, être appelés à contribuer à la stabilité et à la paix dans le monde en fournissant des forces pour des missions des Nations Unies.
C/ L’OTAN et l’UKRAINE : la déclaration de Washington du 24 avril 1999
Il s’agissait de la réunion des dix neuf Chefs d’Etat et de gouvernement et de l’Ukraine participant à la Commission OTAN-Ukraine Washington, le 24 avril 1999, pour son premier Sommet afin de faire le point sur la mise en oeuvre de la Charte de partenariat spécifique qui avait été signée à Madrid, en juillet 1997, et sur son rôle dans la sécurité euro-atlantique. Ceux-ci signèrent et publièrent le 24 avril 1999 à Washington une déclaration rappelant d’une part les avancées du partenariat de l’OTAN avec l’UKRAINE ; d’autre part la continuité de la politique d’expansion de l’OTAN.
1/ L’entente cordiale de l’OTAN avec l’Ukraine : coopération
a/ Côté OTAN :
Les chefs d’Etat et de gouvernement des pays de l’OTAN ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine, à son intégrité territoriale, à son évolution démocratique, à sa prospérité économique et au principe de l’inviolabilité des frontières, facteurs clés de la stabilité et de la sécurité en Europe centrale et orientale et sur l’ensemble du continent. Dans ce contexte, ils ont souligné une fois encore l’importance historique de la décision prise par l’Ukraine de retirer volontairement ses armes nucléaires de son territoire.
Les pays alliés ont salué la contribution importante de l’Ukraine aux opérations de maintien de la paix dirigées par l’OTAN en Bosnie-Herzégovine et à la mission de vérification de l’OSCE au Kosovo.
Ils se sont félicités des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de leur partenariat spécifique depuis la signature de la Charte à Madrid et souhaitent voir celui-ci exprimer toutes ses potentialités. Une satisfaction totale est affirmée quant au développement de toute une gamme de consultations et d’activités de coopération entre l’OTAN et l’Ukraine, au Sommet, aux niveaux des Ministres et des Ambassadeurs comme à celui des comités et organes gouvernementaux appropriés, tels que la Commission interministérielle de l’Ukraine pour les relations avec l’OTAN.
b/ Côté UKRAINE : l’objectif d’intégrer l’OTAN et les structures européennes
Le Président de l’Ukraine réaffirma que son pays est résolu à poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre les réformes politiques, économiques et de défense démocratiques, et pour parvenir, selon son objectif, à l’intégration dans les structures européennes et transatlantiques. Il a affirmé que la récente adhésion à l’Alliance de la Pologne et de la Hongrie, pays voisins de l’Ukraine, et de la République tchèque, constitue une contribution importante à la stabilité en Europe.
2/ La continuité de la politique d’expansion de l’OTAN (vers l’Est)
L’Alliance affirme rester ouverte à toutes les démocraties européennes, quelle que soit leur situation géographique, désireuses et capables d’assumer les responsabilités liées au statut de membre et dont l’admission accroîtrait la sécurité et la stabilité générales en Europe. L’OTAN est un pilier essentiel d’une communauté plus large de valeurs et de responsabilités partagées. Œuvrant ensemble, Alliés et Partenaires, y compris la RUSSIE et L’UKRAINE, développent leur coopération et effacent les divisions imposées par la Guerre froide, afin d’aider à construire une Europe entière et libre, de la sécurité et la prospérité sont un bien commun et indivisible (point 8 de la Déclaration).
L’OTAN doit pouvoir faire face aux nouveaux défis de l’avenir aussi efficacement qu’elle a fait face à ceux du passé. Ainsi, au moment d’entrer dans le XXIe siècle, le cap de l’OTAN est fixé : ce doit être une Alliance résolue à assurer la défense collective, capable d’affronter les risques présents et futurs pour notre sécurité, renforcée par de nouveaux membres et ouverte de futures adhésions, et œuvrant avec d’autres institutions, avec les Partenaires et avec les pays participant au dialogue méditerranéen, dans un souci de renforcement mutuel, pour accroître la sécurité et la stabilité euro-atlantiques (point 5 de la Déclaration).
Les contradictions de la posture de l’OTAN, à l’occasion de la déclaration de Washington du 24 avril 1999, sont ici manifestes car d’une part, l’OTAN travaille activement à l’intégration de l’Ukraine en son sein et affirme être ouverte à d’autres nouveaux membres et à de futures adhésions ; d’autre part, l’Alliance revendique vouloir englober la RUSSIE pour dépasser les divisions de la guerre froide, alors que l’OTAN ne fait que les accentuer en opposant les anciens Etats du bloc soviétique (Ukraine, pays baltes) à la RUSSIE d’aujourd’hui.
D/ Le discours de 2010 d’Anders Fogh RASMUSSEN, Secrétaire général de l’OTAN à la conférence de Varsovie du 12 mars 2010 : « Le nouveau concept stratégique de l’OTAN – défis et tâches futurs à l’échelle mondiale, transatlantique et régionale »
Anders Fogh RASMUSSEN, homme politique danois, est souvent considéré comme un libéral « foncièrement américanophile ». D’abord parlementaire, il fut plusieurs fois ministre dans le gouvernement conservateur de Poul SCHLÜTER (1982-1993), puis il devint en 1998 président du parti libéral VENSTRE (Venstre, Danmarks Liberale Parti) [77], avant d’être nommé Premier ministre de son pays le 27 novembre 2001. Proche de l’administration BUSH, il soutint, en 2003, la guerre en IRAK en y envoyant des troupes danoises, mettant fin à près de 100 ans de non engagement militaire du DANEMARK. Il démissionna de ses fonctions, le 5 avril 2009, après sa nomination, à la fonction de secrétaire général de l’OTAN, intervenue lors du sommet de l’OTAN Strasbourg-Kehl en 2009. Il resta dans ce poste jusqu’en 2014 pour y être remplacé par le norvégien Jens STOLTENBERG.
Entamant sa première visite officielle en Pologne le 12 mars 2010, à l’occasion de la conférence internationale ayant pour thème « Le nouveau concept stratégique de l’OTAN – défis et tâches futurs à l’échelle mondiale, transatlantique et régionale », Anders Fogh RASMUSSEN, Secrétaire général de l’OTAN, y prononça une conférence articulée autour des principaux thèmes suivants :
- La notion de défense du territoire est en train de changer : les trois nouveaux défis : terrorisme, cybersécurité, défense antimissiles efficace ;
- La transformation de l’Alliance, entreprise en 2003, doit s’accélérer : besoin de forces armées plus souples, plus mobiles et plus facilement déployables ;
- L’ouverture à de nouveaux membres doit se poursuivre [78];
- La nécessité de nouvelles relations avec la RUSSIE : l’OTAN n’est pas une menace pour la RUSSIE ; la RUSSIE n’est pas une menace pour l’OTAN ;
- Les intérêts communs de la RUSSIE et de l’OTAN : l’avenir de l’Afghanistan, la lutte contre le terrorisme et la prévention de la prolifération des armes nucléaires [79].
Ici aussi, les contradictions contenues dans cette conférence internationale du 12 mars 2010 de M. Anders Fogh RASMUSSEN, Secrétaire général de l’OTAN alors en poste, sont manifestes car, d’une part, sont prônées, pour l’OTAN, de « nouvelles relations avec la RUSSIE », alors que, d’autre part, il est affirmé que « l’ouverture à de nouveaux membres doit se poursuivre ». C’est dire que, comme nous l’avons déjà souligné, l’avertissement de 2007 de POUTINE n’a pas du tout été entendu par l’OTAN pour qui c’est POUTINE qui doit céder et abandonner son opposition quant à l’accès de nouveaux membres dans l’organisation au bord des frontières russes, et non à l’OTAN de revoir les siennes.
VIII/ L’hyperactivité de l’OTAN et ses interventions au sortir de la guerre froide
Ces trente dernières années, les interventions de l’OTAN ont rompu avec la longue période précédente de grand silence de la guerre froide (1949-1990) – se caractérisant par un monde bipolaire – au cours de laquelle l’OTAN ne fit jamais le choix des armes contre le bloc de l’URSS et de ses alliés, les démocraties populaires, au sein de l’Europe centrale et orientale.
L’on a tendance à croire volontiers que la fin de la guerre froide – qui avait pourtant impliqué deux parties opposées – pouvait se réaliser ipso facto du seul fait de l’implosion de l’URSS ce qui revient à faire rétroactivement et implicitement de celle-ci l’agresseur potentiel selon le schéma entretenu par les américains au moyen de leur propagande relayée par leurs bons élèves du camp occidental. Si une telle vision des choses était pertinente et correcte, elle eut donc dû conduire d’une part à ne pas voir dans la RUSSIE l’héritière de l’ex URSS mais un nouvel Etat plus réduit et surtout fondamentalement européen. En effet, le 25 décembre 1991, la RSFSR change d’appellation et devient la Fédération de Russie. Pour la première fois de son histoire en tant qu’État moderne, la Russie perd sa dimension « impériale », tout en étant néanmoins confrontée à une forte hétérogénéité culturelle sur son territoire.
D’autre part, si c’était la seule existence même de l’URSS qui était porteuse de tensions internationales et de germes de guerre, selon la vision développée par les américains et les occidentaux, sa disparition, en 1991, aurait dû aboutir, sur la scène internationale, à la naissance de nouvelles relations internationales apaisées, expurgées de leurs anciennes tensions au profit de relations plus détendues et pacifiques ouvrant une nouvelle ère de paix confortée.
Or les faits sont têtus car force est de constater que c’est l’inverse qui se produisit quant à l’accélération des tensions dans le monde car avec la chute du mur de Berlin suivi par l’implosion de l’ex URSS, les américains mais aussi leurs alliés européens occidentaux dans l’OTAN considérèrent que le monde était devenu unipolaire sous hégémonie américaine.
Cette mise hors-jeu de l’URSS dans l’incapacité de peser sur les évènements autorisa les américains et les forces de l’OTAN à intervenir partout dans le monde, et en dehors même du cadre géographique et juridique du Traité de l’Atlantique Nord.
Les américains prirent chaque fois la tête d’expéditions militaires soit conduites dans le cadre de l’OTAN, et parfois même avec l’aval de l’ONU, soit à la tête de coalitions qui bien que non estampillées formellement « OTAN » comptaient surtout en leur sein la quasi-totalité des États membres de l’OTAN.
Rompant avec sa prudence antérieure, à partir de la fin du bloc communiste, l’OTAN, sous la houlette des USA, intervient dans plusieurs points de tension géographique dans le monde : BOSNIE et KOSOVO ; IRAK ; AFGHANISTAN.
A/ La guerre des Balkans (1992-1999)
Ci-dessous,
Frontières de l’ex YOUGOSLAVIE TITISTE
de 1945 à 1992
 L’OTAN, entre 1992 et 1999, est intervenue militairement dans la guerre des Balkans, en YOUGOSLAVIE [80], confrontée au réveil des nationalités (Bosnie-Herzégovine et Kosovo) au lendemain de l’éclatement de l’Etat fédéral communiste.
L’OTAN, entre 1992 et 1999, est intervenue militairement dans la guerre des Balkans, en YOUGOSLAVIE [80], confrontée au réveil des nationalités (Bosnie-Herzégovine et Kosovo) au lendemain de l’éclatement de l’Etat fédéral communiste.
Josip BROZ, dit TITO (1882-1980), avait réussi, en 1945, à créer la République socialiste fédérative de YOUGOSLAVIE sur les décombres de l’ancien royaume yougoslave. Il se plaisait à dire, non sans une certaine fierté, que son pays comptait « six républiques, cinq nations, quatre langues, trois religions, deux alphabets et un seul parti ».
La YOUGOSLAVIE, Etat communiste non orthodoxe par rapport à MOSCOU [81] – ayant mis en place, du vivant de son illustre dirigeant TITO, un système politique autogestionnaire – n’appartenait pas au glacis soviétique et, contrairement aux autres démocraties populaires, elle avait lutté dès son invasion contre l’occupant nazi, et l’URSS n’avait joué qu’un rôle mineur et d’appoint dans sa libération.
Malgré le rôle de ferment fédérateur dévolu au parti communiste yougoslave par TITO, même pendant les années glorieuses du titisme, les différents nationalismes ancestraux inoxydables s’avérèrent irréductibles à l’idéologie communiste et attendirent plus ou moins patiemment des jours meilleurs pour se manifester et exploser au grand jour [82].

Ci-contre, Josip BROZ, dit TITO, nom de guerre accolé à son nom de naissance (1882-1980), « maréchal de Yougoslavie » (du à sa mort, en 1980), grade le plus élevé de l’armée dans ce pays, et dont il était aussi le seul titulaire. C’est lui qui fonda, après la seconde guerre mondiale, le régime communiste yougoslave, dont il fut le principal dirigeant jusqu’à sa mort en 1980.
Il porta successivement les titres officiels de président du Conseil exécutif (chef du gouvernement), puis de président de la République (président à vie à partir de 1974).
C’est ainsi que très vite, et seulement 10 ans après la mort de TITO (1980), et surtout dans le contexte international de la chute du communisme, la YOUGOSLAVIE – Etat fédéral indépendant non aligné [83] et non lié à l’OTAN de même que chacune des six républiques fédérées qui la constituaient – fut en proie à un mouvement sécessionniste des nationalités qui la composaient.
En effet, avec l’arrivée des nationalistes au pouvoir, en 1990, les nations fédérées, d’abord de CROATIE et SLOVÉNIE puis de BOSNIE et MACÉDOINE exprimèrent leur soif d’indépendance.
Ces indépendances furent mal acceptées par les serbes qui demeuraient acquis au caractère fédéral de l’Etat yougoslave, et dès lors s’ensuivirent des guerres intestines entre les diverses nationalités. On a parlé de « guerre des 10 jours » pour la SLOVENIE (27 juin 1991 au 7 juillet 1991) et de « guerre de CROATIE » (selon la vision serbe) ou, selon la vision croate, de « guerre d’indépendance » ou « patriotique » de la CROATIE (17 août 1991 au 12 novembre 1995).
Après l’indépendance de la SLOVÉNIE le 25 juin 1991 – suivie d’une courte guerre [84] – et de la CROATIE, le même jour, la mettant également aux prises militairement avec les forces militaires yougoslaves (1991-1992) [85], la BOSNIE-HERZÉGOVINE, à son tour, obtint, fin février 1992, son indépendance par référendum avec l’assentiment de 62 % de la population.
Mais l’indépendance de la BOSNIE-HERZEGOVINE, contestée par les forces de l’Etat fédéral yougoslave, fut suivie d’un cortège d’atrocités et d’exactions qui appelèrent l’intervention de l’ONU, ce qui était en soi déjà discutable, mais ensuite, plus encore curieusement, celle de l’OTAN dont aucun des États membres n’était pourtant partie au conflit yougoslave.
En effet, tout comme, entre 1861 et 1865, la guerre de sécession sudiste qui ravagea les jeunes Etats-Unis d’Amérique relevait de la compétence exclusive de l’Etat fédéral nord-américain, sans que l’Europe ni le reste du monde ne s’en soient jamais mêlés, a priori les secousses internes sécessionnistes qui agitèrent l’Etat fédéral yougoslave et ses composantes internes relevaient en principe de la pleine souveraineté interne de l’Etat fédéral précité. Aujourd’hui – plus encore qu’au milieu du 19ème siècle, lors de la guerre de sécession aux USA -, cette règle internationale a été fort opportunément consacrée par les dispositions du § 7 de l’article 2 de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945.
1/ En Bosnie Herzégovine, un conflit qui aurait pu être rapidement réglé
 En septembre 1991, le diplomate portugais José CUTILEIRO et le britannique Peter CARINGTON avaient proposé un projet de cantonalisation de la Bosnie-Herzégovine (sur le modèle suisse des cantons), où chaque canton se verrait attribuer une ethnicité croate, bosniaque ou serbe. Le 18 mars 1992, Alija IZETBEGOVIĆ, pour les Bosniaques, Radovan KARADŽIĆ, pour les Serbes et Mate BOBAN, pour les Croates, signèrent l’accord avant qu’IZETBEGOVIĆ, ne retire sa signature le 28 mars 1992 en déclarant son opposition à toute partition ethnique de la Bosnie-Herzégovine.
En septembre 1991, le diplomate portugais José CUTILEIRO et le britannique Peter CARINGTON avaient proposé un projet de cantonalisation de la Bosnie-Herzégovine (sur le modèle suisse des cantons), où chaque canton se verrait attribuer une ethnicité croate, bosniaque ou serbe. Le 18 mars 1992, Alija IZETBEGOVIĆ, pour les Bosniaques, Radovan KARADŽIĆ, pour les Serbes et Mate BOBAN, pour les Croates, signèrent l’accord avant qu’IZETBEGOVIĆ, ne retire sa signature le 28 mars 1992 en déclarant son opposition à toute partition ethnique de la Bosnie-Herzégovine.
En effet, après l’avoir signé, IZETBEGOVIC était rentré à Sarajevo et, lors d’un entretien téléphonique avec Warren ZIMMERMAN, ambassadeur des Etats-Unis à Belgrade, il s’était, semble-t-il, laissé convaincre, par celui-ci, de la nécessité de revenir sur sa signature.
– Le rejet par la communauté internationale d’une nouvelle fédération yougoslave
Le 27 avril 1992, la SERBIE et le MONTÉNÉGRO, c’est-à-dire les deux seules républiques non-sécessionistes, formèrent la République fédérale de Yougoslavie, mais celle-ci ne fut pas reconnue comme successeur et noyau restant de l’ancienne Yougoslavie (comme ce fut le cas pour la Russie lors de l’implosion de l’URSS [86]).
– La guerre de l’OTAN et les accords de DAYTON (14 décembre 1995)
L’OTAN considérait que la présence en Bosnie de l’armée de la république serbe constituait un danger pour les « zones de sécurité » des Nations unies. Il est vrai qu’à SREBRENICA, au mois de juillet 1995, des exactions [87] et tueries nombreuses furent commises par des unités de l’armée de la république serbe de Bosnie (VRS) sous le commandement du général Ratko MLADIĆ, appuyées par une unité paramilitaire de Serbie, dans une ville qui pourtant avait été déclarée « zone de sécurité » par l’Organisation des Nations unies [88]. En réplique, entre 1993 et 1995, des exactions semblables furent commises par les croates [89].
Ci-dessous,
Bombardement de la Bosnie-Herzégovine
par l’OTAN en 1995.
Photo prise par un avion américain
(source : Le Parisien)
 Pour venir à bout du conflit avec son sinistre cortège d’atrocités, l’OTAN décida d’entreprendre une campagne aérienne de bombardements baptisée Deliberate Force. Entre le 30 août 1995 et le 20 septembre 1995, près de 300 avions bombardiers de la coalition militaire s’attaquèrent aux positions militaires de l’Armée de la république serbe de Bosnie [90].
Pour venir à bout du conflit avec son sinistre cortège d’atrocités, l’OTAN décida d’entreprendre une campagne aérienne de bombardements baptisée Deliberate Force. Entre le 30 août 1995 et le 20 septembre 1995, près de 300 avions bombardiers de la coalition militaire s’attaquèrent aux positions militaires de l’Armée de la république serbe de Bosnie [90].
Ces avions effectuèrent plus de 3500 « sorties » (dont 2500 pour les seuls USA) ciblées sur plus de 300 sites sur lesquels furent larguées 1 026 bombes. Par ailleurs, des missiles air-sol furent employés par l’OTAN.
Cette action militaire de l’OTAN se révéla déterminante quant à l’issue du conflit. C’est ainsi que le 14 décembre 1995 les accords de DAYTON procédèrent à la partition de la Bosnie-Herzégovine, de manière à peu près égale entre la fédération de Bosnie-et-Herzégovine (croato-bosniaque) et la république serbe de Bosnie (serbe), ainsi que le déploiement d’une force de paix multinationale, l’IFOR : un système de gouvernance tripartite complexe permet de conserver l’intégrité territoriale de la Bosnie, laissant une large autonomie aux entités croato-musulmane d’une part et serbe d’autre part.
Ainsi il fallut près de quatre ans et la mort de cent mille personnes pour revenir à un plan similaire à celui de septembre 1991 proposé par les deux diplomates européens précités, mais il est vrai que cette fois le promoteur de la paix était américain…
2/ La guerre du KOSOVO (mars 1998- juin 1999)[91]
 Le KOSOVO dans l’ex-Yougoslavie (carte ci-contre), était une province de Serbie, elle-même l’une des six Républiques de la Fédération yougoslave.
Le KOSOVO dans l’ex-Yougoslavie (carte ci-contre), était une province de Serbie, elle-même l’une des six Républiques de la Fédération yougoslave.
Cette province, composée d’une grande majorité albanaise, bénéficiait d’un statut autonome spécial qui lui conférait le droit de former son gouvernement, et d’être représentée au gouvernement fédéral et à la présidence.
Le KOSOVO avait aussi le contrôle de l’éducation, de la justice et de la police.
En mars 1989, à la veille de l’éclatement sanglant de l’ex Yougoslavie, Slobodan MILOSEVIC, alors président de la Serbie, supprima l’autonomie du KOSOVO.
Cette décision entraîna de vives protestations et une série de manifestations très suivies de la part de la population albanaise, notamment à PRISTINA, avec des affrontements avec la police qui firent 24 morts, dont deux policiers.
– Résistance non violente –
Les Albanais kosovars qui résistaient et refusaient la perte de leur autonomie perdirent leur emploi dans les écoles, les hôpitaux, les médias, la police ou les forces de sécurité.
Le chef de l’Union des écrivains du KOSOVO, Ibrahim RUGOVA, prit alors l’initiative de lancer un mouvement de résistance pacifique avec la création de structures d’Etat parallèles.
Il fonda un gouvernement de l’ombre qui fournit pendant la quasi-totalité des années 1990 des services essentiels au domicile des gens (éducation, santé), financés essentiellement par la diaspora.
– Le début de la guerre
Autour de l’UCK – armée de libération du Kosovo – se développa, à partir de 1997, une guérilla séparatiste, reprochant au mouvement non violent de RUGOVA d’être inefficace.
En mai 1998, l’UCK contrôlait le quart de la province, autour de la région de DRENICA.
Lors de l’été 1998, BELGRADE lança sa première offensive contre l’UCK dans la région centrale de DRENICA, l’un des principaux bastions des indépendantistes.
Après plusieurs heures de siège, les forces armées serbes attaquèrent les maisons où était retranché le commandant Adem JASHARI dans le village de PREKAZ. Environ 80 Albanais, dont une vingtaine de femmes et d’enfants, furent tués par les forces serbes. La moitié des victimes appartenaient à la famille JASHARI.
Après l’échec de paix de Rambouillet au début de l’année 1999, l’OTAN demanda à la Serbie de signer un traité de paix faute de quoi elle déclencherait un bombardement massif sur la nation serbe.
Ci-dessous : 1999, les bombes de l’OTAN
tombaient sur la SERBIE.
 La Serbie refusa de signer le traité et s’opposa à toute participation de l’OTAN à la guerre. L’OTAN, sans consulter l’ONU, lança, entre les mois de mars et juin 1999, pendant 78 jours, un bombardement contre la population serbe en justifiant la campagne au KOSOVO comme une « guerre humanitaire ».
La Serbie refusa de signer le traité et s’opposa à toute participation de l’OTAN à la guerre. L’OTAN, sans consulter l’ONU, lança, entre les mois de mars et juin 1999, pendant 78 jours, un bombardement contre la population serbe en justifiant la campagne au KOSOVO comme une « guerre humanitaire ».
Les bombardements de l’OTAN contraignirent l’homme fort de Belgrade à ordonner le retrait des troupes serbes.
Le 9 juin 1999, les accords de Kumanovo signés entre la Force internationale de sécurité de l’OTAN (KFOR) et les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie mirent fin aux bombardements de l’OTAN sur la Serbie et le Kosovo en imposant le retrait des troupes serbes de cette province septentrionale de la Serbie.
Le KOSOVO fut placé sous administration de l’ONU par la résolution 1244 du 10 juin 1999 votée par le Conseil de sécurité. En 2008, l’ancienne province serbe déclarait unilatéralement son indépendance avec le soutien des Etats-Unis et de la plupart des pays occidentaux, notamment membres de l’OTAN. Ce que n’a jamais accepté Belgrade [92].
Le journaliste et géopoliticien Renaud GIRARD a fortement critiqué l’intervention militaire de l’OTAN au Kosovo. Pour lui, la participation de la France à cette action a été un contresens historique majeur, les Serbes étant les alliés des Français de longue date. L’indépendance du Kosovo, selon lui, n’a mené qu’à la constitution d’un club de criminalité et de trafics au cœur de l’Europe [93].
Pendant la guerre, les forces armées yougoslaves et serbes provoquèrent le déplacement de 1,2 à 1,45 million d’Albanais du Kosovo.
Après la guerre, environ 200 000 Serbes, Roms et autres non-Albanais ont fui le Kosovo et nombre des civils restants ont été victimes d’abus. La Serbie est devenue le foyer du plus grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées en Europe.
– Brefs commentaires
La campagne de bombardements de l’OTAN fut et reste toujours controversée [94], car elle n’a pas obtenu l’approbation du Conseil de sécurité des Nations unies et aussi parce qu’elle a causé au moins 488 morts parmi les civils yougoslaves, y compris un nombre substantiel de réfugiés.
En 2000, des enquêtes permirent de retrouver les restes de près de trois mille victimes de toutes les ethnies tandis qu’en en 2001 une Cour suprême administrée par les Nations unies, – basée au Kosovo – constata qu’il y avait eu « une campagne systématique de terreur, comprenant des meurtres, des viols, des incendies et de graves mauvais traitements ». Mais le crime de génocide ne fut pas retenue par cette même enquête qui estima que les troupes yougoslaves avaient tenté d’expulser plutôt que d’éradiquer la population d’origine albanaise.
Le diagnostic de cet organisme juridictionnel agissant sous l’autorité de l’ONU rejoint ainsi un rapport officiel du ministère allemand des affaires étrangères qui, quinze jours avant la guerre, déclarait : » Il n’y a pas de persécution ethnique contre les Albanais en tant que groupe » (cité par Michel COLLON).
Pour le journaliste belge Michel COLLON [95], cette guerre de l’OTAN ne fut pas propre, contrairement à ce que l’on a dit, l’OTAN ayant employé des armes interdites par les conventions de Genève : bombes à fragmentation, au graphite, à l’uranium appauvri.
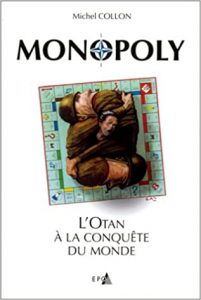 Dans son ouvrage Monopoly, l’OTAN à la conquête du monde (éditions EPO, mars 2000, 247 pages), Michel COLLON dresse le bilan de la couverture médiatique de la guerre du KOSOVO en mettant en avant la manipulation des occidentaux pour justifier le démantèlement de l’ex YOUGOSLAVIE.
Dans son ouvrage Monopoly, l’OTAN à la conquête du monde (éditions EPO, mars 2000, 247 pages), Michel COLLON dresse le bilan de la couverture médiatique de la guerre du KOSOVO en mettant en avant la manipulation des occidentaux pour justifier le démantèlement de l’ex YOUGOSLAVIE.
Ainsi, selon lui, la thèse du massacre (quarante-cinq civils abattus de sang-froid par les Serbes deux mois avant la guerre) ne tient pas la route. Il n’y avait pas de douilles, pas de sang sur place. La bataille avait été observée par une équipe de l’OSCE, filmée par l’agence de presse AP (Associated Press). Tous ces gens n’avaient rien constaté. L’armée yougoslave s’étant retirée à la fin de la journée, l’OSCE est entrée dans le village de RACAK. Personne ne leur a parlé de massacre. Mais le lendemain on découvrit des cadavres qui en réalité étaient ceux d’un combat qui avait eu lieu entre les deux armées. Il n’y a pas eu de génocide, et des crimes ont été commis des deux côtés des belligérants
De son côté, dans son ouvrage Bombes et bobards. Propagande, bourrage de crâne, mensonges et manipulations de la guerre du Kosovo 24 mars-10 juin 1999. Le sottisier du mondialisme (Ed. L’âge d’homme, Paris, avril 2000, 144 pages), le journaliste David MATHIEU a consigné les déclarations des hommes politiques et des journalistes occidentaux. Il ressort de cet ouvrage un réquisitoire irréfutable contre le “complexe militaro-médiatique” occidental.
 Quant à Régis DEBAY, il a consacré un numéro spécial des Cahiers de médiologie à » l’effet Kosovo » (1999) dans lequel il conteste l’existence d’un génocide au KOSOVO taxant les journalistes de « fonctionnaires du sacré ». L’idée de son livre est le passage du pouvoir spirituel, essentiellement religieux, des mains du clergé à celles des journalistes, devenus les nouveaux » fonctionnaires du sacré social « .
Quant à Régis DEBAY, il a consacré un numéro spécial des Cahiers de médiologie à » l’effet Kosovo » (1999) dans lequel il conteste l’existence d’un génocide au KOSOVO taxant les journalistes de « fonctionnaires du sacré ». L’idée de son livre est le passage du pouvoir spirituel, essentiellement religieux, des mains du clergé à celles des journalistes, devenus les nouveaux » fonctionnaires du sacré social « .
Et dans une interview dans l’Espace des Amis de l’Humanité, donnée le 14 septembre 1999, Régis DEBRAY devait dire, à part, L’Humanité, Le Monde diplomatique et Marianne, les médias ont fonctionné comme le journal unique d’une pensée unique. » S’agissant plus précisément du journal de JAURÈS, il ajouta : » En publiant les uns et les autres, vous avez pu apparaître comme une sorte de havre « , quand les questions éminemment complexes posées par le conflit – les nationalismes, leurs enracinements, leurs affrontements, les problèmes touchant au droit international… – étaient la plupart du temps traités au travers du prisme du « travail de communication de l’OTAN ».
B/ La guerre en Afghanistan (2001-2022) [96]
 C’est à la suite des terribles attentats terroristes du 11 septembre 2001 – au moyen de deux avions de ligne dirigés contre les « twin towers » du World Trade Center à New York, un autre avion de ligne venant percuter le Pentagone à Washington, et un quatrième en Pennsylvanie, faisant au total près de 3 000 victimes – qu’une intervention américaine fut lancée en AFGHANISTAN, ce pays étant accusé d’être responsable d’abriter Oussama BEN LADEN et son état-major, dénoncés tout de suite comme étant les responsables des attentats. En vertu de la résolution 1368 des Nations-Unies et avec l’appui politique de l’OTAN (par application de l’article 5 de sa Charte), les Etats-Unis et l’Angleterre lancèrent la première offensive le 8 octobre 2001.
C’est à la suite des terribles attentats terroristes du 11 septembre 2001 – au moyen de deux avions de ligne dirigés contre les « twin towers » du World Trade Center à New York, un autre avion de ligne venant percuter le Pentagone à Washington, et un quatrième en Pennsylvanie, faisant au total près de 3 000 victimes – qu’une intervention américaine fut lancée en AFGHANISTAN, ce pays étant accusé d’être responsable d’abriter Oussama BEN LADEN et son état-major, dénoncés tout de suite comme étant les responsables des attentats. En vertu de la résolution 1368 des Nations-Unies et avec l’appui politique de l’OTAN (par application de l’article 5 de sa Charte), les Etats-Unis et l’Angleterre lancèrent la première offensive le 8 octobre 2001.
Selon les États-Unis et leurs alliés, le but de l’invasion de l’Afghanistan était de capturer Oussama ben LADEN, détruire l’organisation Al-Qaïda qui possédait des bases dans le pays avec la complicité des talibans, et renverser ces derniers.
1/ L’ONU et l’étrange résolution unanime 1368 du Conseil de sécurité
On ne l’évoque presque jamais mais, sans doute sous l’emprise de l’émotion, l’ONU a jeté elle-même de l’huile sur le feu pour justifier l’invasion de l’Afghanistan et porte une lourde responsabilité dans le traitement du problème en ayant contribué elle-même au développement du nouveau concept discutable de « culture de guerre » [100] (en l’occurrence punitive).
En effet, la résolution 1368 du Conseil de sécurité des Nations Unies fut adoptée à l’unanimité le 12 septembre 2001, le lendemain des actes terroristes contre l’Amérique.
Le Conseil y affirmait sa détermination à lutter contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales provoquées par de tels actes de terrorisme.
Il reconnaissait le droit de légitime défense individuelle et collective, et condamnait les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis en exprimant sa compassion aux victimes, à leurs familles et à la nation américaine.

Ci-contre, Attentats du
11 septembre 2001 à New-York
Vue du World Trade Center
et de la Statut de la Liberté
La France prit toute sa place dans cet unanimisme émotionnel car la résolution précitée fut conçue par le diplomate français Jean-David LEVITTE (première présidence de Jacques CHIRAC,1995-2002).
La résolution appelait tous les pays à coopérer pour traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires des attentats en retenant également la responsabilité de tous ceux qui soutiennent ou hébergent leurs auteurs, organisateurs et commanditaires.
La communauté internationale était invitée à intensifier ses efforts pour réprimer et prévenir les activités terroristes grâce à la coopération et à la mise en œuvre de conventions antiterroristes ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1269 (1999).
La résolution 1368 concluait que le Conseil était prêt à prendre des mesures pour répondre aux attaques et lutter contre toutes les formes de terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies.
Avec cette résolution et en donnant sa bénédiction à l’invasion de l’Afghanistan, l’ONU a franchi, en 2001, un pas dangereux. Quelque odieux que soient les actes de terrorisme, légitimer ainsi la poursuite et la punition d’actes de terrorisme en exerçant des représailles sur un pays souverain dont on ne possédait pas la preuve qu’il était complice des attentats a de quoi surprendre de la part de l’organisation internationale chargée de la paix dans le monde.
En droit international, les représailles sont admises du bout des lèvres et sous certaines conditions. Elles doivent en principe demeurer un moyen ultime d’obtenir réparation, tous les moyens pacifiques possibles pour arriver à un accord ayant dû préalablement être tentés, et, en cas d’échec, une mise en demeure devant toujours être faite. C’est aussi la philosophie de la Charte des Nations-Unies.
Or, selon Le Monde du 18 novembre 2001, ce n’est que le 17 novembre 2001 que le New York Times a fait état d’informations qui attesteraient de l’existence de liens entre les attentats du 11 septembre, Ben LADEN et les talibans.
Ce n’est, en effet, que lors de la chute de KABOUL et son abandon par les Talibans (13 novembre 2001), que de telles informations auraient été trouvées dans la capitale afghane dans deux maisons, l’une appartenant au ministère de la défense du gouvernement taliban, à KABOUL, l’autre privée.
Mais la connaissance formelle de telles informations, à la supposer sérieusement établie, fut postérieure à l’invasion de l’Afghanistan par les USA et l’OTAN qui démarra le 7 octobre 2001.
De même, l’ONU, lors de l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité 1368 du 12 septembre 2001, ne possédait pas la preuve formelle de la collusion du régime taliban avec les attentats commandités par Ben LADEN.
Or, selon ARAB NEWS [97], les talibans n’ont jamais reconnu publiquement avoir jamais accueilli le groupe Al-Qaïda, son ancien chef, Oussama ben Laden, ou que l’Afghanistan ait été utilisé pour préparer les attentats du 11-Septembre, ou d’autres opérations.
2/ Tous derrière les Etats-Unis
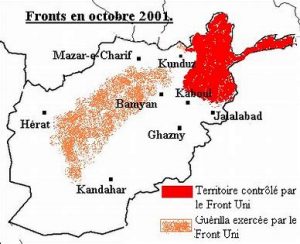 La guerre d’Afghanistan (2001-2021) commença par la campagne de l’automne 2001 qui permit aux États-Unis d’obtenir un succès rapide, en menant une opération aérotransportée qui renversa le régime taliban et détruisit des bases d’Al-Qaïda, jugée responsable des attentats du 11 septembre 2001.
La guerre d’Afghanistan (2001-2021) commença par la campagne de l’automne 2001 qui permit aux États-Unis d’obtenir un succès rapide, en menant une opération aérotransportée qui renversa le régime taliban et détruisit des bases d’Al-Qaïda, jugée responsable des attentats du 11 septembre 2001.
En effet, le 13 novembre 2001, à la suite d’une campagne éclair – commencée le 7 octobre 2001 -, les hommes de l’Alliance du Nord, alliés des Etats-Unis, plus d’un mois plus tard, entraient dans KABOUL, tombée sans combats.
Un gouvernement provisoire (en attendant des élections démocratiques) dirigé par Hamid KARZAI fut mis en place, à la suite des accords de Bonn du 5 décembre 2001.
Mais les talibans entreprirent alors une longue guérilla à laquelle la coalition USA/OTAN dut faire face.
À partir de 2006, les forces armées talibanes furent très actives, alors que de son côté le gouvernement afghan de KARZAI, élu président en octobre 2004, n’avait que peu de légitimité et ne contrôlait, en 2006, que le secteur de KABOUL.
Ci-dessous, la guerre de l’OTAN
en Afghanistan (2001-2014)
Pas moins de 48 nations engagées en 2011
 En application des accords de Bonn précités, l’OTAN accepta de s’engager sur le théâtre afghan avec la création et l’envoi de la FIAS (Force internationale d’assistance et de sécurité – ISAF en anglais).
En application des accords de Bonn précités, l’OTAN accepta de s’engager sur le théâtre afghan avec la création et l’envoi de la FIAS (Force internationale d’assistance et de sécurité – ISAF en anglais).
Avec un effectif assez important atteignant 140.000 hommes venant de plus de 48 nations en janvier 2011, l’ISAF s’était donné pour mission d’aider le gouvernement afghan à établir son autorité sur l’ensemble du territoire. L’OTAN en prit le commandement dès août 2003. Deux opérations militaires distinctes furent conduites sur le territoire afghan ; d’une part quant à leur commandement, l’une était rattachée à un commandement régional américain (USCENTCOM), l’autre étai sous commandement militaire de l’OTAN, avec un état-major spécial ; d’autre part, quant à leur approche et leurs méthodes : l’opération « Liberté immuable» poursuivait la recherche et la destruction des terroristes et de leurs alliés, alors que l’ISAF ne se consacrait, au moins initialement, qu’à l’aide apportée aux forces de sécurité afghanes et au développement.
Mais les troupes de l’OTAN, comme les troupes américaines, s’enlisèrent dans un pays lointain et n’arrivèrent pas plus à contrôler l’Afghanistan que ne l’avaient fait les Soviétiques (1979-1989).
La France, surtout à partir de 2008 avec son retour dans l’alliance militaire, s’engagea les yeux fermés dans cette coalition miliaire aventureuse – davantage destinée à redorer la bannière étoilée de « l’Oncle Sam » qu’à éradiquer le pays de ses forces obscurantistes et fanatiques – en mobilisant, entre 2002 et 2014, environ 70 000 militaires qui se succédèrent dans ce pays (avec 4000 hommes au plus fort du conflit en 2011). Les missions de l’armée française évoluèrent, du retour à la paix vers des combats de plus en plus importants, au prix de 90 tués, plus de 700 blessés, sans parler des nombreux blessés psychologiques dont le décompte précis n’a jamais été effectué.
Mais ce furent les Etats-Unis qui fournirent tout au long du conflit, le plus gros contingent militaire, comptant, d’après près les chiffres du Pentagone, 98 000 soldats en 2011.
3/ Le retrait programmé de l’OTAN d’Afghanistan
La conférence de l’OTAN à Lisbonne, le 20 novembre 2010, avait fixé à la fin de l’année 2014 la date de son retrait pour passer le relais de la responsabilité des opérations à l’armée afghane.
La mission de la FIAS prit fin en décembre 2014, lorsque les forces de défense et de sécurité nationales afghanes eurent endossé l’entière responsabilité de la sécurité de leur pays.
Pour autant, la présence de l’OTAN fut maintenue sur le sol afghan avec le lancement, en janvier 2015, de la mission « Resolute Support » (RSM), mission de formation, de conseil et d’assistance au profit des forces et des institutions de sécurité afghanes afin de combattre le terrorisme et de sécuriser le pays.
Ainsi l’Otan qui, comme on l’a vu, s’était engagé en Afghanistan dès décembre 2001, vingt ans plus tard, en février 2020, était encore présente sur le territoire afghan avec quelque 16.500 militaires en provenance de pas moins de 38 pays dans le cadre de la mission précitée.
4/ L’échec de l’OTAN
Le 29 février 2020, les États-Unis signèrent avec les talibans l’accord de Doha, dans lequel ils s’engagèrent à retirer l’ensemble de leurs troupes du pays en échange de l’engagement des Talibans d’empêcher les groupes terroristes tels qu’Al-Qaïda d’opérer dans les zones sous leur contrôle..
En avril 2021, les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense des pays de l’OTAN décidèrent de retirer l’intégralité des troupes de l’Alliance présentes en Afghanistan dans un délai de quelques mois.
Pendant l’été 2021, suite à la chute du gouvernement afghan et à la débâcle des forces de défense et de sécurité nationales afghanes, l’OTAN se donna comme priorité de faire en sorte que le personnel des pays de l’Alliance et des pays partenaires, ainsi que les Afghans ayant eu des liens avec l’OTAN, soient évacués en toute sécurité. En août 2021, plus de 120 000 personnes – quelque 2 000 Afghans ayant travaillé pour l’OTAN, et leurs familles – furent évacuées par transport aérien OTAN depuis l’aéroport de Kaboul dans le cadre de l’action de la coalition.
La raison de l’échec des Etats-Unis et de l’OTAN réside dans le fait que les troupes étrangères armées de la coalition internationale furent perçues par les populations afghanes comme des armées d’occupation.
En effet, ce que déclarait, le 2 janvier 1792, Robespierre devant la Société des amis de la Constitution demeure toujours vrai et d’actualité (pensons au Mali) :
« La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d’un politique est de croire qu’il suffise à un peuple d’entrer à main armée chez un peuple étranger, pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n’aime les missionnaires armés ; et le premier conseil que donnent la nature et la prudence, c’est de les repousser comme des ennemis. »
Or, selon Gérard FUSSMAN, professeur au Collège de France, pour battre les talibans, il aurait fallu « d’abord les couper de la population. Cela impliqu(ait) que les troupes occidentales se fassent discrètes dans leur action, que les Afghans aient au moins l’impression d’être maîtres chez eux, et que l’idéologie des talibans soit combattue, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. » [98]
Ce fut la plus longue occupation américaine sur un sol étranger car elle dura plus de 20 ans, avec un piètre résultat si l’on fait abstraction de l’éliminations de Ben LADDEN le 2 mai 2011 au Pakistan.
5/ Le retour des Talibans
L’objectif de la coalition miliaire USA/OTAN de chasser les talibans, malgré l’importance des moyens déployés, n’a pas été atteint. Et ce, malgré une pluie de bombes larguées par l’US Air Force sur l’Afghanistan qui, entre 2001 et avril 2009, atteignit le chiffre exorbitant de 12 742 tonnes (de bombes).
Quant au coût financier, en avril 2017, le Pentagone a évalué à 800 milliards de dollars les dépenses engagées par les États-Unis seulement pour les seize premières années de guerre en Afghanistan (2001-2017).
 À l’été 2021, vingt ans après avoir été chassés par une coalition internationale menée par les États-Unis, le groupe islamiste fondamentaliste a repris le pouvoir, rétablissant l’Émirat islamique d’Afghanistan.
À l’été 2021, vingt ans après avoir été chassés par une coalition internationale menée par les États-Unis, le groupe islamiste fondamentaliste a repris le pouvoir, rétablissant l’Émirat islamique d’Afghanistan.
Seulement deux mois après la prise de pouvoir des talibans, et malgré leurs promesses, le changement le plus notable était que les femmes avaient disparu de l’espace public, quasiment du jour au lendemain. Désormais, les filles ne peuvent aller à l’école que jusqu’en primaire et les femmes ont seulement le droit de travailler dans la fonction publique. Toutes les autres doivent rester à la maison.
Les médias sont muselés. Contrôlés, les journalistes ont peur, et il n’y a plus de liberté de la presse ou de liberté d’expression.
Selon « Le Point », et « Le Monde », les présentatrices des principales chaînes de télévision afghanes sont passées à l’antenne le dimanche 22 mai 2022 en se couvrant le visage, alors qu’elles avaient tenté, la veille, de défier l’ordre des talibans leur intimant de dissimuler leur apparence.
À l’instar de toutes les femmes afghanes, elles ont dû porter la burqa laissant uniquement voir leurs yeux pour présenter les journaux sur les chaînes TOLOnews, Ariana Television, Shamshad TV et 1TV.
Depuis que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan en août 2021, les attentats à la bombe ont diminué, mais les djihadistes et le groupe Etat islamique poursuivent leurs attaques contre des cibles qu’ils jugent hérétiques.
Économiquement aussi, les talibans ont du mal à gérer. La crise économique fait rage et la famine menace. Les caisses de l’État sont vides, les denrées alimentaires ont du mal à passer les frontières. Résultat, les prix s’envolent : cinq à dix fois plus cher pour certains aliments. L’ONU estime que 14 millions de personnes sont en insécurité alimentaire.
Au total, cette guerre « occidentale » contre un Etat souverain, au sens du droit international, s’étira sur plus de 20 ans et se solda par le retour des Talibans en Afghanistan que les américains et l’OTAN étaient venus en principe chasser pour aider à l’instauration d’un régime démocratique…
Le fiasco des américains, de l’OTAN et des occidentaux en général
C/ La guerre d’Irak : une guerre mensongère (mars 2003-2011)
 Ci-contre, la carte de l’invasion de l’Irak en 2003
Ci-contre, la carte de l’invasion de l’Irak en 2003
Progression (en vert) des forces de la coalition.
Légende :
![]() – 3e division d’infanterie US
– 3e division d’infanterie US
![]() – 1re division de Marines
– 1re division de Marines
![]() – 101e division aéroportée US
– 101e division aéroportée US
![]() – 173e brigade aéroportée
– 173e brigade aéroportée
![]() – 82e division aéroportée
– 82e division aéroportée
![]() –
– ![]() – Special Forces – Special Air Service
– Special Forces – Special Air Service
Officiellement l’OTAN n’a certes pas participé à la guerre d’IRAK. C’est ainsi que selon le site NATO de l’OTAN, la campagne de mars 2003 contre l’IRAK fut menée par une coalition de forces de différents pays, dont certains appartenaient à l’OTAN et d’autres non. Ainsi l’OTAN, en tant qu’organisation, n’aurait joué aucun rôle ni dans la décision de lancer la campagne, ni dans sa conduite.
Mais ce même site admet lui-même qu’en février 2003, face à l’aggravation des tensions ayant précédé ces événements, la TURQUIE avait demandé de l’aide à l’OTAN, en invoquant l’article 4 du Traité de l’Atlantique Nord. L’Alliance avait alors pris un certain nombre de mesures défensives de précaution pour assurer la sécurité de ce pays, dans l’éventualité d’une menace contre son territoire ou sa population du fait de la crise. Par ailleurs, toujours selon l’OTAN elle-même (site précité), le 21 mai 2003, l’Alliance a également décidé d’apporter un soutien à la POLOGNE, pays membre de l’OTAN, dans son rôle de direction d’un secteur de la force multinationale de stabilisation en IRAK conduite par les États-Unis.
 Déclenchée le 20 mars 2003, l’invasion militaire de l’IRAK conduisit très vite à la chute du gouvernement baassiste le 9 avril avec la prise de BAGDAD. Huit mois plus tard Saddam HUSSEIN fut capturé par les américains le 13 décembre 2003. Son procès fut précipité, contrôlé et orchestré par les américains qui aboutit à son jugement et à sa condamnation à mort le 26 décembre 2003 et à sa pendaison expéditive quelques jours plus tard [99], à l’aube du 30 décembre. La guerre elle-même ne s’acheva officiellement que le 19 août 2010, mais réellement seulement au 18 décembre 2011.
Déclenchée le 20 mars 2003, l’invasion militaire de l’IRAK conduisit très vite à la chute du gouvernement baassiste le 9 avril avec la prise de BAGDAD. Huit mois plus tard Saddam HUSSEIN fut capturé par les américains le 13 décembre 2003. Son procès fut précipité, contrôlé et orchestré par les américains qui aboutit à son jugement et à sa condamnation à mort le 26 décembre 2003 et à sa pendaison expéditive quelques jours plus tard [99], à l’aube du 30 décembre. La guerre elle-même ne s’acheva officiellement que le 19 août 2010, mais réellement seulement au 18 décembre 2011.
1/ Radioscopie de la coalition :
Il reste qu’en mars 2003, les 48 pays de la coalition cités par la Maison-Blanche sont : l’Afghanistan, l’Albanie, l’Angola, l’Australie, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, Colombie, la Corée du Sud, le Danemark, la République dominicaine, le Salvador, l’Érythrée, Espagne, l’Estonie, les États-Unis, l’Éthiopie, la Géorgie, le Honduras, la Hongrie, l’Italie, l’Islande, le Japon, le Koweït, Lituanie, la République de Macédoine, les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, la Mongolie, le Nicaragua, l’Ouganda, l’Ouzbékistan, les Palaos, Panama, les Philippines, la POLOGNE, le Portugal, la Roumanie, le Rwanda, Singapour, la Slovaquie, la République tchèque, le Royaume-Uni, les Tonga, la TURQUIE, L’UKRAINE.
Or sur ces 48 pays belliqueux, on relève que 18 pays sont membres de l’OTAN, l’organisation comptant alors, en 2003, 26 membres.
2/ La scission des pays du bloc occidental
Les pays membres de l’OTAN réticents ou franchement hostiles à l’invasion de l’IRAK étaient la France et l’Allemagne qui, avec la CHINE et la RUSSIE, faisaient partie des pays de l’axe de la paix pour lesquels tous les moyens pacifiques n’avaient pas encore été exploités, notamment donner encore du temps à la mission des inspecteurs chargés de détecter si l’Irak possédait véritablement des armes de destruction massive (biologique, chimique et nucléaire) ainsi que des missiles à longue portée et d’autres armements nocifs.
 En la personne de son Ministre des Affaires Étrangères Dominique de VILLEPIN, la France s’opposa finalement au sein du Conseil de sécurité aux Etats-Unis en dénonçant une guerre contre l’Irak comme « la pire des solutions ».
En la personne de son Ministre des Affaires Étrangères Dominique de VILLEPIN, la France s’opposa finalement au sein du Conseil de sécurité aux Etats-Unis en dénonçant une guerre contre l’Irak comme « la pire des solutions ».
La France et l’Allemagne rappelèrent notamment le 22 janvier 2003 que « seul le Conseil de sécurité des Nations unies est habilité à […] engager une opération militaire contre l’Irak ».
De son coté, assumant le risque de heurter la frange catholique la plus conservatrice qui, aux USA, en ITALIE et en ESPAGNE, poussait à la guerre, le pape JEAN-PAUL II s’opposa à une « croisade » contre l’IRAK.
Si les motifs ultimes pour lesquels JEAN-PAUL II adopta une telle attitude pacifiste échappèrent le plus souvent à la plupart des » vaticanologues » et des catholiques des Etats précités, les observateurs avertis de la politique et de la géopolitique du Saint-Siège mettaient en avant le motif de « guerre juste » d’ailleurs rappelé par cardinal LAGHI lui-même quand il rencontra le président BUSH : cette guerre était » illégale et injuste « , affirmations renvoyant au concept de » guerre juste « , qui est au cœur de la pensée catholique en matière de relations internationales (Saint THOMAS d’AQUIN). De même, de son côté, SAINT AUGUSTIN, de manière encore plus radicale, écrivait : » Le désir de nuire, la cruauté dans la vengeance, la violence et l’inflexibilité de l’esprit, la sauvagerie dans le combat, la passion de dominer et autres choses semblables, voilà ce qui dans les guerres est jugé coupable par le droit « .
Pourtant en 2003, la position du Pape aurait pu être encore plus radicale car depuis la seconde moitié du XXe siècle, le concept de « guerre juste » n’est plus utilisé mais abandonné pour rappeler que toute guerre est un mal. C’est dire qu’aujourd’hui l’Eglise catholique condamne toute forme de guerre, juste ou pas. C’est ainsi que dans son encyclique Fratelli Tutti publiée le 4 octobre 2020, le pape François, écrit :
« Nous ne pouvons donc plus penser à la guerre comme une solution, du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l’utilité hypothétique qu’on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd’hui de défendre les critères rationnels, mûris en d’autres temps, pour parler d’une possible « guerre juste». Jamais plus la guerre ! »
À l’opposé des positions concordantes de l’Eglise, de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de la Chine, en 2003, l’axe de la guerre était incarné par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne, pour lesquels l’Irak ne « jouait pas le jeu » et restait détenteur d’armes de destruction massive.
Ci-dessous, l’axe de la guerre et les étendards nationaux des quatre faucons précités à la tête de la coalition de l’invasion de l’Irak en 2003 :
ETATS-UNIS d’AMERIQUE ROYAUME-UNI


ESPAGNE ITALIE


3/ Posture des pays d’Europe centrale et orientale et baltes dans la coalition
Parmi les pays d’Europe centrale et orientale et les pays baltes membres de la coalition, 6 pays sont d’Europe centrale et deux sont des pays baltes (parmi les trois), soit 8 pays sur 10 parmi ceux ayant adhéré à l’OTAN entre 1997 et 2002.
Par ailleurs, dans la coalition, l’on relève deux pays ayant entamé des démarches pour entrer dans l’OTAN (l’Albanie et la République de Macédoine) et qui en deviendront membres respectivement en 2009 et 2017.
La Pologne, la Hongrie et la Tchéquie font partie du groupe « va-t-en-guerre » dit des « Huit » qui, avec l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, et le Danemark, rappellent le 29 janvier 2003, que « le lien transatlantique est une garantie de notre liberté. Grâce au courage, à la générosité et à la perspicacité américaine, l’Europe a été libérée des deux formes de tyrannie qui dévastèrent notre continent au vingtième siècle : le nazisme et le communisme. » L’allégeance aux USA est ici affirmée très explicitement par ces pays.
Quant aux pays baltes et autres pays d’Europe centrale membres du « Groupe de Vilnius » – Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie, Albanie, Croatie et Macédoine – ils apportent, le 5 février 2003, leur appui à une intervention militaire.
Il y a lieu de rappeler que le « groupe de Vilnius »- du nom de la capitale de la Lituanie – fut créé en mai 2000 entre les dix pays précités en vue de mettre en place une coopération visant à l’intégration de ces pays au sein de l’OTAN.
Aujourd’hui, tous ces pays sont intégrés dans l’OTAN.
4/ Le cas particulier de l’UKRAINE
Selon les américains, l’UKRAINE a participé à la coalition, car ses premières relations avec les Etats-Unis et l’OTAN avaient officiellement démarré en 1992, lorsque l’Ukraine rejoignit le Conseil de coopération nord-atlantique – rebaptisé plus tard le Conseil de partenariat euro-atlantique – après avoir accédé à l’indépendance,
En février 1994, l’Ukraine fut le premier pays post-soviétique à conclure un accord-cadre avec l’OTAN conformément à l’initiative Partenariat pour la paix, soutenant l’initiative des pays d’Europe centrale et orientale d’adhérer à l’OTAN.
Le 7 mai 1997, un centre officiel d’information et de documentation de l’OTAN fut ouvert à KIEV, dans le but de favoriser la transparence au sujet de l’alliance. Un sondage d’opinion ukrainien du 6 mai avait montré que seulement 37% des ukrainiens se prononçaient en faveur de l’adhésion à l’OTAN contre 28% opposés, et 34% d’indécis. Aujourd’hui, les choses n’ont pas manqué d’évoluer dans un sens opposé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie [100].
Le 6 avril 2004, la Verkhovna Rada adopta une loi sur le libre accès des forces de l’OTAN au territoire de l’Ukraine.
5/ Épilogue
La Coalition militaire en Irak aura duré 3 207 jours, soit 8 ans et neuf mois. Les forces américaines se retirèrent du pays le 18 décembre 2011. Elle aura abouti à la destruction du seul régime politique non religieux au Moyen Orient.
Selon les estimations, cette guerre aurait fait entre 100 000 à plus d’un million de morts irakiens pour la période 2003-2011, tant parmi les combattants que parmi les civils.
La guerre aurait provoqué l’exode d’au moins deux millions à 2,5 millions d’Irakiens réfugiés à l’étranger depuis 2003 (principalement en Syrie et en Jordanie, mais également en Europe et aux États-Unis). Par ailleurs, selon le HCR, 1,8 million d’Irakiens auraient été déplacés à l’intérieur du territoire national.
– Retour sur un mensonge des Etats-Unis
La constitution de la coalition originelle reposait sur un mensonge car GW BUSH avait trompé le monde entier, et notamment ses alliés, en affirmant que l’IRAK de Saddam HUSSEIN possédait des armes de destruction massives. Même les plus fidèles alliés des américains découvrirent – mais seulement après-guerre – l’abominable supercherie meurtrière [101]. C’est ainsi qu’en octobre 2015, l’ancien Premier Ministre britannique Tony BLAIR (1997-2007) [102], dans un éclair de lucidité assez tardif, regretta d’avoir engagé le Royaume-Uni dans la guerre en IRAK, notamment à la suite des fausses informations ayant conduit à l’option militaire.
En effet, dans un entretien exclusif donné le 24 octobre 2015 à la chaîne américaine CNN Tony BLAIR s’était excusé “pour les erreurs commises dans la planification de la guerre en Irak et pour le manque d’anticipation de ce qui pouvait arriver si on éliminait le régime de Saddam Hussein”. Il a également demandé pardon “pour avoir utilisé des renseignements erronés”, faisant allusion aux allégations sur les “armes de destructions massives” irakiennes qui ont permis de justifier l’intervention de la coalition.

Ci-contre, TONY BLAIR (en 2010). Membre du Parti travailliste, il incarna une nouvelle version du travaillisme dans la recherche d’ une « troisième voie » entre la gauche et la droite traditionnelles, parfois brocardée sous le terme de « blairisme ». A la tête du parti travailliste, BLAIR annonça son intention de changer la charte du parti qui datait de 1918 en supprimant les clauses typiquement « socialistes » comme la mise en commun des moyens de production. Il résuma le nouveau visage de son parti par l’expression « New Labour » ayant souvent quelque peine à le distinguer fondamentalement du libéralisme. Il alla même jusqu’à envisager un partenariat avec les libéraux-démocrates, n’hésitant pas à suggérer que la création du « Labour » avait été une erreur dans la mesure où elle avait affaibli le Parti libéral, puis l’avait progressivement supplanté dans le fonctionnement du « two party system » anglais. Mais ce rapprochement échoua car Charles Kennedy, le dirigeant des libéraux-démocrates, considérait le « New Labour » comme trop ancré à droite…
Le cas du travailliste Tony BLAIR, Premier Ministre du Royaume-Uni, du 2 mai 1997 au 27 juin 2007, est significatif et assez exemplaire de l’évolution des partis sociaux démocrates européens vis-à-vis de l’OTAN et plus généralement de l’hégémonie américaine par leur allégeance culturelle et politique vis-à-vis des USA. Sur le plan des relations internationales – qui nous intéresse ici -, BLAIR engagea, souvent à la suite des Etats-Unis et sans grand discernement politique, son pays dans pas moins de cinq conflits en six ans : en Irak en 1998 ; au Kosovo en 1999 ; en Sierra Leone en 2000 ; en Afghanistan en 2001 ; et à nouveau en Irak en 2003.
En juillet 2016, différentes conclusions de la publication du fameux rapport britannique de la « commission CHILCOT » montrèrent que les informations des services de renseignements n’avaient pas été suffisamment vérifiées et que le Royaume-Uni avait été abusivement trompé par les États-Unis.
En 2017, à son tour, Gordon BROWN – Premier Ministre travailliste du Royaume-Uni, de 2007 à 2010, et chancelier de l’Échiquier (ministre des finances) en 2003, à l’époque de l’invasion de l’Irak – expliquait dans son livre My Life, Our Times que le Pentagone avait volontairement menti au sujet de la possession d’armes de destruction massive par l’IRAK.
Non seulement l’état-major américain était conscient que l’IRAK n’était pas en mesure de produire des armes de destruction massive mais il avait maintenu son allié britannique dans l’ignorance de cette vérité. Ainsi, estima Gordon BROWN, cette guerre « ne pouvait pas se justifier comme un dernier recours » et l’invasion « ne pouvait pas être vue comme une réponse proportionnée ».
Pour excuser l’aveuglement des travaillistes alors au pouvoir, G. BROWN expliqua dans son livre précité que régnait à l’époque, au Royaume-Uni, « une fièvre de guerre ».
Mais peut-être cette « fièvre de guerre » prenait-elle sa source dans une autre raison – moins avouable – que celle attachée à la supposée détention d’armes de destruction massives par l’IRAK, comme le montre le livre d’enquête Fuel on The Fire, publié par le militant britannique Greg MUTTITT, en avril 2011 (Penguin Random House edition), qui met en avant l’accès au « brut irakien » qui aurait été au cœur de la décision britannique de s’engager aux côtés des Etats-Unis lors de l’invasion de l’Irak en 2003 [103]. En effet, la ministre du commerce britannique, la baronne Elisabeth SYMONS [104], déclarait aux représentants des majors britanniques qu’elle ferait en sorte que ces dernières aient accès aux réserves d’hydrocarbures dans l’Irak de l’après Saddam Hussein. Et c’est ainsi que le compte-rendu d’une réunion avec BP, Shell et BG (British Gas), datée du 31 octobre 2002, indiquait : «
La baronne SYMONS a reconnu qu’il serait difficile de justifier que les compagnies britanniques puissent sortir perdantes en Irak (…) si la Grande-Bretagne devait être un allié proéminent du gouvernement américain durant la crise. »

Ci-contre, la baronne Elisabeth SYMONS, Elizabeth Conway Symons, baronne Symons de Vernham Dean (née le ) est une femme politique et syndicaliste britannique. Membre du Parti travailliste, elle fut, au sein du gouvernement de Tony BLAIR, Ministre d’Etat au Commerce (11 juin 2001-13 juin 2003). Ell est membre de la Chambre des Lords depuis le 7 octobre 1996 et membre du Conseil privé du Royaume-Uni.
La ministre précitée avait alors promis « de rendre compte aux compagnies avant Noël » du résultat de ses tractations auprès de l’administration Bush à Washington…
Cette « fièvre de guerre » entretenue par les Etats-Unis fut contagieuse et comme une épidémie atteignit de nombreux autres États membres de la coalition guerrière qui – bien qu’eux-mêmes très jaloux de leur souveraineté fraîchement acquise (États baltes [105], Ukraine [106]) – n’hésitèrent pas à participer à la destruction d’un Etat souverain, sans aucune autre raison que les raisons obscures – non avouées car inavouables – liées aux intérêts américains.
Selon certains commentateurs critiques, l’objectif des Etats-Unis aurait été un objectif économique mercantile. En effet, le conflit avec l’IRAK permettrait à beaucoup d’entreprises américaines proches de l’administration BUSH de profiter du pétrole irakien. Et même, pourquoi pas, de prendre le contrôle des puits de pétrole du 2ème producteur mondial.
Ainsi, selon le politologue, et directeur de l’Institut d’études et de recherche Europe – Méditerranée Sami NAIR [107] :
« Le pétrole est la clef de voûte du système économique mondial et commande sur le long terme les rapports de force entre les puissances … Ce n’est donc pas un hasard si les Etats-Unis sont au centre de tous les réseaux de domination qui enserrent l’or noir depuis la Seconde Guerre mondiale, couronnant ainsi leur implication dans les luttes d’influence entre les pays producteurs depuis le début du XXe siècle. Le Moyen-Orient, le Maghreb, l’Iran et plusieurs pays de l’Asie musulmane concentrent à eux seuls la majeure partie des réserves pétrolières et gazières, de quoi faire de ces pays des cibles inévitables pour les plus grandes puissances. »
Or, poursuit-il, s’agissant du Moyen-Orient, cette région contient 65 % des réserves mondiales tandis que le pétrole représente aujourd’hui 40 % de la consommation d’énergie totale dans le monde.
Ainsi dans les trente prochaines années le pétrole restera la première énergie primaire, les experts étant d’accord pour affirmer que la demande mondiale de pétrole devrait croître de 50 % au cours des vingt prochaines années, avec une forte croissance de la demande asiatique.
Celle-ci, alors qu’elle représente aujourd’hui un tiers de la consommation totale, devrait s’élever à 60 % de la consommation mondiale d’ici à trente ans.
Avec l’arrivée de la Chine dans le commerce et les échanges internationaux, l’exploitation intensive de l’or noir devrait s’accélérer au point que les multinationales et les stratégies des grandes puissances économiques ont déjà intégré cette donnée.
Dans un tel contexte, le contrôle du Moyen Orient est devenu une nécessité géopolitique pour les Etats-Unis dont les immenses besoins représentent le quart de la consommation mondiale, alors que selon l’EIA (Agence d’information sur l’énergie [108]) la production de pétrole brut des États-Unis s’élevant à 11,1 millions de barils par jour (Mb/j) en 2021, a subi une baisse d’environ 200 000 barils par jour par rapport à 2020 (11,3 Mb/j) et de plus d’un million de barils par jour par rapport à 2019 (12,2 Mb/j). Cette baisse résulte « d’un déclin de l’activité de forage lié aux faibles prix du pétrole », précise l’EIA, leur production de pétrole ne cessant de baisser.
En fait les USA avaient connu une lente baisse, sur 25 ans (1983-2008) de leur production pétrolière, en pétrole conventionnel – qui aurait pu motiver leur intervention en Irak – alors qu’elle était confrontée à la hausse de leur propre demande intérieure.
Cela pouvait expliquer leur volonté de contrôler les champs pétrolifères irakiens, et cela d’autant plus que, comme le montre leur rejet du protocole de Kyoto et de toutes les contraintes environnementales, ils ne se sont pas engagés dans la voie de la diversification de leurs sources d’énergie.
Il reste que cette baisse a été suivie d’une rapide hausse intervenue à partir de 2010 et jusqu’à 2019 leur donnant ainsi la première place de producteur pétrolier, à la suite de la révolution technologique du pétrole de schiste.
Mais si, à partir de 2021 cette tendance à la baisse de leur production se confirmait elle conforterait encore davantage aujourd’hui leurs craintes et renforcerait leur désir de contrôler les champs pétrolifères irakiens.
Il n’est guère contestable que le pétrole constitue une arme redoutable entre les mains des pays producteurs qui se sont d’ailleurs fédérés dans l’OPEP dès 1960 [109] pour mieux défendre leurs intérêts en régulant les flux de production, garantir un équilibre des marchés pétroliers et enfin garantir une production de pétrole suffisante, régulière, efficace et compétitive. Mais il reste que la dépendance de certains producteurs – notamment des pétromonarchies du Golfe – se manifeste à travers les avoirs qu’ils ont investis massivement en Occident (environ 800 milliards de dollars contre 160 milliards investis dans les économies nationales de ces pays). En effet, les revenus tirés de ces investissements sont souvent plus importants que la rente pétrolière elle-même. Le revers de la médaille est que ces pétromonarchies ont besoin que l’Occident se porte bien à travers des économies florissantes dopées par une forte croissance, ce qui a pour effet de faire naître une interdépendance correctrice perverse, sans que pour autant la pérennité de la rente pétrolière soit toujours suffisamment garantie [110]…
D’autres, tels que Paul CRAIG ROBERTS et STEPHEN J. SNIEGOSKI [111], écartent la thèse de la « guerre pour le pétrole » et soutiennent que la guerre d’Irak était une guerre conçue dans l’intérêt d’Israël.
En effet, selon l’économiste CRAIG ROBERTS [112], il faudrait rechercher dans une autre raison plus pertinente que celle de la « guerre du pétrole », la véritable cause de l’invasion de l’Irak, à savoir une « guerre préventive » pour protéger Israël.
En 2016, cette « explication (qui est) la plus probable de l’invasion étasunienne de l’Irak » valide la thèse de l’historien américain Paul W. SCHROEDER (1927-2020). C’est en elle que résiderait « l’engagement du Régime néoconservateur de BUSH à la défense de l’expansion territoriale israélienne. » [113]

L’éminent historien américain Paul W. SCHROEDER (ci-contre) – reconnu pour ses contributions à l’histoire diplomatique et aux relations internationales et comme un bon connaisseur des rouages et subtilités de la diplomatie américaine -, dans un long article intitulé « Irak : Le procès contre une guerre préventive » publié dans « The American Conservative » du 21 octobre 2002, se livrait à une critique des raisons d’une attaque préméditée des USA contre l’Irak. Selon lui, « La vraie raison ainsi que la motivation cachée derrière cette politique est vraisemblablement : la sécurité d’Israël ».
Ces deux thèses sur les vraies raisons de l’invasion de l’IRAK et aussi de sa destruction (contrôle des champs pétroliers irakiens et guerre préventive au bénéfice d’Israël) ne s’excluent pas forcément.
Dans le « Prologue » de son livre précité Irak. Le mensonge. Histoire d’une guerre préventive contestée, à propos de la première guerre du Golfe (2 août 1990 au 28 février 1991), l’ancien ambassadeur Michel CARLIER rappelle que :
« Max GALLO déclarait, le 30 janvier 1991 (peu après la démission de Jean-Pierre Chevènement de son poste de ministre de la défense du gouvernement français) [114] : « est-ce que nous sommes toujours dans les mêmes buts de guerre, c’est-à-dire la libération du Koweït, ou est-ce que nous sommes dans la destruction de l’Irak ? Est-ce que nous sommes dans la recomposition totale du Moyen-Orient avec un gendarme unique local ? »
Michel JOBERT, ancien ministre des affaires étrangères de G. Pompidou, abondait dans le même sens, devant un journaliste tunisien, il parlait de la fiction du droit international arborée par certains états occidentaux pour justifier la guerre dans le golfe, dont le but ultime est de détruire l’Irak, d’assurer le leadership militaire d’Israël dans la région et enfin de contrôler la route du pétrole. Deux hommes qui, douze ans avant l’invasion de l’Irak, avaient vu clair ! »
Quant à J.-P. CHEVÈNEMENT, lors de sa démission, le 30 janvier 1991, il devait déclarer à propos de la première guerre du Golfe conduite par feu BUSH père « qu’il n’y avait pas de gloire à frapper un petit peuple qu’on a déjà ramené cinquante ans en arrière ».
– Les conséquences de cette guerre sont mortifères pour l’Etat irakien
La guerre d’Irak a eu pour principale conséquence la fin de la paix religieuse qui résultait de l’instauration par le parti baas de Saddam HUSSEIN d’un régime laïc. À l’issue de la guerre, après la chute de Saddam HUSSEIN, renaissent les anciens conflits religieux entre chiites et sunnites pour la prise du pouvoir et l’installation d’un régime religieux dominé par l’une de ces deux communautés,
Ainsi, pour le géopoliticien français Renaud GIRARD, « la guerre d’invasion anglo-saxonne de 2003 en Irak a provoqué une guerre civile entre les chiites et les sunnites, qui n’existait pas avant. ».
Dans le cadre de l’opération « Liberté irakienne », l’une des principales motivations invoquées pour justifier et légitimer la coalition conduite par les États-Unis à envahir l’Irak, était l’instauration de la démocratie dans la région. Dans le célèbre discours qu’il prononça lors du débat parlementaire deux jours avant l’invasion, Tony BLAIR, alors Premier ministre britannique, énonçait avec emphase cet objectif dans les termes suivants : « Donnons au prochain gouvernement irakien l’occasion d’amorcer l’unification des différents groupes de la nation, sur des bases démocratiques ».
Or force est de constater que les tensions entre les trois grandes communautés principales d’Irak (chiites, sunnites et kurdes) ont été ravivées et ont même permis l’arrivée du groupe islamiste Daech (État Islamique en Irak et au Levant), soutenu par les sunnites.
Aujourd’hui, l’IRAK est plus que jamais divisé. D’un côté, les chiites qui sont protégés par le gouvernement, la police et des milices paramilitaires ; de l’autre, une communauté sunnite exclue du pouvoir et marginalisée qui ne rêve que de revanche. Entre ces deux communautés religieuses rivales, DAECH [115] prospère sur les cendres de cette guerre de religion, en promettant aux sunnites la vengeance.
Selon Adel BAKAWAN, directeur du Centre français de recherche sur l’Irak (Cfri) et auteur de « L’Irak, un siècle de faillite, de 1921 à nos jours » (éd. Tallandier) [116], dans l’Irak post-Saddam Hussein, le pouvoir est partagé de manière informelle entre les différentes communautés du pays, dans un système confessionnel identique à celui en vigueur au Liban. La présidence revient ainsi à un Kurde, le poste de Premier ministre à un chiite – la confession majoritaire en Irak -, et la présidence du Parlement à la communauté sunnite.
CONCLUSION GENERALE
I/ Rapide radioscopie de l’OTAN aujourd’hui
Aujourd’hui, l’OTAN compte 30 membres qui sont les États suivants : France ; Portugal ; Italie ; Angleterre ; Norvège ; Belgique ; Pays-Bas ; Danemark ; Islande ; Luxembourg ; États-Unis ; Canada ; Grèce ; Turquie ; Allemagne ; Espagne ; Tchéquie ; Hongrie ; Pologne ; Bulgarie ; Estonie ; Lettonie ; Lituanie ; Roumanie ; Slovaquie ; Slovénie ; Albanie ; Croatie ; Monténégro ; Macédoine du Nord.
30 États…. C’est dire que l’OTAN ne représente qu’un peu plus de 15% des États de la planète (30 sur 194).
Son assise structurelle inter-étatique est plus étroite que son contenu, sa superficie et sa population…
L’ensemble des pays membres de l’OTAN couvre un territoire de 24,59 millions de km² et compte environ 946,59 millions d’habitants. Or si cet ensemble représente seulement 13 % de la population du globe, il représente, en revanche, 45 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et correspond aux pays riches accusant le clivage Nord/Sud par un déploiement d’armements qui crée un climat de tensions inutiles peu favorables à la paix internationale dont l’ONU, depuis 1945, est normalement la garante.
II/ La croissance de l’OTAN au risque du « consensus » au sein de l’organisation
Les nations membres de l’OTAN ont certes des intérêts mondiaux, mais il est clair que le consensus sera de plus en plus difficile à réaliser à 30 membres que lorsque l’OTAN, dans sa formation originelle, était confinée à l’Ouest européen oscillant entre 12 à 16 États membres, entre 1949 et 1982 [117]. Il reste que l’hégémonie américaine – qui fédère l’ensemble de ses composantes théoriquement souverainement étatiques – est toujours là, comme l’ont largement montré les différentes interventions de l’OTAN de ces vingt dernières années dans le monde (Balkans, Afghanistan, Irak) que nous avons analysées et qui étaient au service exclusif des intérêts américains et de ses alliés inconditionnels ou fusionnels (parfois hors OTAN comme Israël).
Mais, comme nous allons le voir, l’hégémonie américaine à l’intérieur de l’OTAN se vérifie à travers l’adoption de certaine doctrine de défense made in USA élaborée pour préserver la sécurité américaine et ensuite imposée aux partenaires européens des américains au sein de l’organisation.
III/ Un exemple du leadership américain au sein de l’OTAN : la docrine du bouclier « anti-missile »
Aujourd’hui encore, l’hégémonie américaine a imposé à l’OTAN la doctrine du « bouclier antimissile » telle que développée par G. BUSH en décembre 2001, annonçant que les États-Unis vont se retirer du Traité ABM pour se lancer dans la construction, en Europe centrale, d’un bouclier antimissile contre des missiles de longue portée.
Or la majorité des pays ouest-européens étant en désaccord avec la perception des Américains sur les menaces provenant de l’Iran et en conséquence n’étant guère acquis à l’implantation du système antimissile sur leur territoire, cela fit porter le choix des USA sur certains pays d’Europe centrale pour placer ce bouclier (dix intercepteurs en Pologne et un radar en République tchèque) car ces pays se trouvent assez proches de l’Iran, l’un des lieux éventuels d’attaques par missile selon les américains. Il a donc été plus facile de négocier leur implantation avec les pays d’Europe centrale, notamment avec la Pologne, toujours fidèle aux USA et qui a toujours exprimé son soutien au système de défense antimissile américain, soulignant que cela pourrait contribuer à la sécurité européenne…
Les autorités russes ont rapidement manifesté leur désaccord total avec la doctrine américaine du bouclier antimissile. Selon eux, le bouclier antimissile constitue une menace pour la sécurité européenne car il bouleverse la stabilité stratégique de la région et pourrait provoquer une nouvelle course aux armements. Les Russes seraient en effet contraints de répondre à une telle implantation en ciblant l’Europe occidentale avec des missiles nucléaires balistiques de type SS-20 et en se retirant du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (1987). De plus, Moscou n’a pas été suffisamment informé et consulté lors du lancement du projet de bouclier antimissile. Selon eux, les intercepteurs de défense peuvent être transformés en armes offensives avec un potentiel de première frappe contre la Russie. Enfin, les dirigeants russes accusent les Américains de ne pas respecter certains principes du droit international en prenant la décision de se retirer unilatéralement du Traité ABM. Ceci explique qu’en juin 2007, lors du Sommet du G8 en Allemagne, le président POUTINE a proposé aux Américains d’utiliser conjointement un radar russe situé en Azerbaïdjan, au lieu d’installer un système antimissile en Pologne et en République tchèque. Mais les Américains déclinèrent la proposition russe, considérant que ce radar pourrait seulement être envisagé comme un complément, et non comme une substitution.
Enfin, à l’instar de nombreux pays européens, MOSCOU émet également de sérieux doutes quant à la réalité de la menace iranienne et considère qu’avec le temps le nombre d’intercepteurs prévu va croître, créant ainsi un système de défense antimissile global. Cela va à terme conduire à un renforcement de la position hégémonique des États-Unis, l’OTAN étant vue comme une arme stratégique et politique aux mains des Américains pour accroître cette hégémonie.
Les américains, guère ouverts aux critiques lorsqu’ils considèrent que les questions traitées touchent à leur propre sécurité, ne continuèrent pas moins à avancer en faisant confirmer leur vision des choses les 20 et 21 mai 2012 à Chicago, lors du sommet de l’OTAN où fut annoncé que le système de défense antimissile balistique disposerait d’une capacité intérimaire, soit la première étape du développement du système antimissile décidé lors du sommet de Lisbonne en novembre 2010.
IV/ L’OTAN, une survivance anachronique du monde de la « guerre froide » et une bonne affaire pour le maintien sine die de la présence américaine en Europe après la fin du second conflit mondial
Comme on l’a vu, l’OTAN est une survivance anachronique du monde de la « guerre froide » alors que la supposée menace « soviétique » s’est effondrée avec la chute du bloc communiste doublée de la dissolution du pacte de Varsovie qui était la réplique de l’OTAN dans l’aire du glacis soviétique englobant les pays d’Europe centrale et orientale. Le regard posé sur la RUSSIE par les américains et une grande partie du bloc occidental réuni dans l’OTAN essaie d’accréditer l’idée que la RUSSIE serait l’héritière du bloc communiste parce qu’elle en fut le cœur et qu’elle serait mue par un esprit revanchard depuis la chute de l’URSS. Mais à lire ainsi le présent à travers le passé de la « guerre froide », si l’on remontait encore plus loin dans le temps, cela pourrait nous faire douter de la mutation démocratique de l’Allemagne, surtout depuis sa réunification, en invoquant ses vieux démons de puissance et d’impérialisme qui furent à l’œuvre dans le 3ème Reich et l’embrasement de l’Europe qui s’ensuivit lors du second conflit mondial, ce qui serait une thèse tout aussi excessive, absurde et anachronique, et surtout contraire à la recherche de la paix..
L’invasion de l’Ukraine par la Russie doit se lire comme un acte guerrier, certes tout à fait irrationnel, contre la souveraineté d’un Etat et le droit international en général. Elle a été produite par les causes géopolitiques que nous avons essayer d’analyser, à la suite d’une pratique de l’OTAN qui s’est écartée de la doctrine « Kennedy/Khrouchtchev » d’octobre 1962 au plus fort des années chaudes de la « guerre froide « . Mais cette faute politique et juridique de la Russie ne saurait être appréhendée comme l’amorce d’un processus expansionniste menaçant, avec comme arrière-pensée la reconstitution de l’ex URSS, ce qui serait une vision manichéenne occidentale relevant plus d’une manipulation de l’opinion pour sauver et justifier l’OTAN en même temps que la présence américaine en Europe.
La recherche d’une solution diplomatique et pacifique entre les deux parties doit emprunter d’autres canaux que la médiation de l’OTAN qui s’est discréditée en jouant la carte de la déstabilisation de la région d’Europe centrale et orientale jusqu’aux frontières de la RUSSIE avec sa conquête incessante de type « Far Est« …
V/ L’OTAN, la solution ou le problème?
Dès lors qu’on sait raison garder, l’attractivité actuelle de l’OTAN à des États réputés jusqu’alors neutres tels que la SUEDE [118] et la FINLANDE [119] possédant des frontières communes avec la RUSSIE ne doit pas faire illusion car la recherche de la sécurité dans une peur entretenue artificiellement par les occidentaux à l’occasion du conflit russo-ukrainien n’est pas meilleure conseillère que la séduction dans laquelle était vite tombée l’UKRAINE au lendemain de la chute du bloc soviétique, alors que sa population demeurait au moins réservée sur une perspective d’adhésion au bloc OTAN au moins jusqu’à l’invasion de l’UKRAINE (position inversée aujourd’hui après l’agression russe).
Contrairement à ce que croient la SUEDE et la FINLANDE, pays sous emprise américaine, l’OTAN n’est pas la solution mais bien au contraire le problème et, s’ils persistaient à vouloir sortir de leur neutralité, les États suédois et finlandais seraient alors frappés de cécité en voulant chercher leur sécurité dans un embrigadement dans l’OTAN limitant leur souveraineté du fait des clauses de solidarité du Traité de l’OTAN requérant une disponibilité permanente dès l’instant que l’un de ses membres entre en conflit avec un Etat non-membre de l’organisation, ce que le général de GAULLE avait très bien compris dès 1966.
De même, l’Homme du 18 juin avait bien compris que les sources des conflits dans le monde s’étaient déplacées hors d’Europe à la suite de l’impérialisme américain dans le monde et de la défense expansionniste par les USA de leurs propres intérêts de puissance dominante.
Les exemples des interventions de l’OTAN au Moyen Orient – Afghanistan et Irak – confortent une telle analyse.
Certes, il y eut aussi deux interventions en Europe (Bosnie-Herzégovine et Kosovo), mais celles-ci ne furent pas davantage jusifiées, comme on l’a vu, que les guerres d’Afghanistan et d’Irak.
VI/ Une inquiétante intervention en Europe en 1995 et 1999
En Europe, il y eut les guerres des Balkans (BOSNIE-HERZEGOVINE et KOSOVO) mais celles-ci relevaient a priori de la souveraineté interne de l’ex YOUGOSLAVIE. S’il est incontestable que la YOUGOSLAVIE était un Etat fédéral composé d’une mosaïque de nationalités et de langues, cela ne saurait être un argument en faveur de la justification de l’éclatement puis du démantèlement de cet Etat car certains grands États homogènes – nationaux ou fédérés – font eux-mêmes parfois l’amère expérience de tentatives de sécessions internes. C’est dire que l’uniformité de la langue et l’homogénéité nationale ne constituent pas, en elles-mêmes, des garanties préservant les Etats des forces centrifuges presque toujours à l’œuvre dans tous les pays, comme en firent la douloureuse expérience les USA eux-mêmes, entre 1861 et 1865, lorsqu’ils furent vite confrontés au conflit sécessionniste interne résultant de la tentative d’indépendance des États du sud esclavagistes. Les USA réglèrent néanmoins eux-mêmes ce conflit interne, en l’occurrence par le recours à la violence d’une guerre civile, sans aucune intervention extérieure, confortée par la célèbre doctrine de Monroë « L’Amérique aux américains » formulée un un peu moins de 40 ans avant…
VII/ Une faible légitimité internationale
Regardons le monde tel qu’il est aujourd’hui et non plus avec la lunette qui conduisit à la constitution de l’OTAN en 1949. En 1949, la jeune organisation des Nations-Unies – portée par 51 membres fondateurs en 1945 – n’en contenait toujours que 59, dont 12 d’entre eux créèrent l’OTAN un peu plus tard, ce qui pouvait être considéré comme relativement significatif par rapport à la société internationale de l’époque et l’avance de l’Occident sur les continents d’Asie et d’Afrique encore largement colonisés.
Aujourd’hui, après le vent de la décolonisation des années 1960/1970 et l’application du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la configuration du monde s’est totalement modifiée et n’est plus celle du lendemain de la seconde guerre mondiale, comme le montre la forte présence d’Etats indépendants et souverains au sein de l’ONU où l’on en compte pas moins de 194…
Alors, peut-on encore décemment considérer que l’OTAN, possède la légitimité géographique, juridique et politique pour vouloir s’ériger en « gendarme du monde » ?
Or, au regard des trois conflits que nous avons analysés et dans lesquels elle est intervenue soit directement soit indirectement [120], l’OTAN s’est arrogée ce droit d’intervention dans certains points chauds du monde et une nouvelle conception globale évolutive de son rôle – jetant aux orties la sphère géographique du Pacte initial comme les formes de belligérance classique avec la nouvelle inclusion du terrorisme et de nouvelles guerres non armées – l’y a conduit de manière radicale, et victorieuse parfois, mais pas nécessairement légitime, aux dépens de la diplomatie et de la recherche de solutions pacifiques dès lors que le monde était devenu unipolaire, c’est-à-dire sans risque pour l’organisation atlantique et le bloc occidental.
Mais a-t-elle la légitimité pour régenter le monde quand sont absents, de son sein, de nombreux États représentant parfois des continents : l’Inde, la Chine, les États d’Amérique du Sud, et, déjà, au sein même de l’Europe, comme on l’a vu, la vaste Russie.
Exclure de fait la RUSSIE de l’Europe, comme le fait l’OTAN, et faire comme si elle n’avait pas son mot à dire dans l’évolution des forces stationnées à ses frontières – États baltes aujourd’hui, et demain peut-être Ukraine ou la Finlande et la Suède -, comme si elle était quantité négligeable (résidu de la guerre froide), risque d’exacerber les tensions avec les États à ses frontières dont certains, comme on l’a vu, sont déjà intégrés dans le Pacte ATLANTIQUE de 1949.
Affirmer un peu vite comme le firent Bill CLINTON et ses successeurs que des États européens souverains peuvent librement entrer dans l’OTAN et que la liberté de choix des entrants dans l’Alliance atlantique n’appartient qu’à l’OTAN, si cette énonciation est vrai juridiquement, elle ne saurait occulter le caractère géopolitique des relations internationales.
En effet, comme on l’a vu, en 1962, lors de la crise de CUBA, ce n’est pas sur la base juridique du libre choix par Fidel CASTRO de son allié politique – l’URSS lui permettant, pour sa sécurité, d’installer des fusées à CUBA – que fut tranché le conflit entre les « deux Grands ». Ce n’est pas davantage sur l’intangibilité de la liberté de choix des soviétiques de pouvoir aider militairement CUBA en installant des fusées sur son territoire que la tension internationale entre les USA et l’URSS a été résolue.
C’est d’abord la doctrine de la sécurité américaine qui fut prise en compte et prévalut lors de la crise des missiles de CUBA, dès l’instant que les USA déclarèrent ne pouvoir accepter l’implantation de fusées à CUBA qui menaçaient les côtes de Floride distantes de plusieurs centaines de KMS de La Havane.
Aujourd’hui la situation se présente dans les mêmes termes, mais de manière inversée : le rôle de CUBA est détenu par l’UKRAINE voulant être protégée contre la RUSSIE, comme hier, CUBA voulait être protégé contre une invasion des USA (qui avaient déjà, comme on l’a vu, tenté de l’envahir).
Comme hier les USA pouvaient se sentir menacés par les fusées de CUBA, aujourd’hui la RUSSIE peut légitimement se considérer menacée par l’Alliance atlantique arrivant à nouveau encore plus près de ses frontières – après l’inclusion, déjà en 2002, des États baltes dans l’OTAN, ce qui, selon les russes, était déjà discutable – que ne l’étaient les fusées russes de CUBA des côtes américaines.
La solution qui prévalut, hier, dans le règlement du litige entre l’URSS et les USA – à savoir le retrait des fusées de CUBA – doit conduire aujourd’hui l’OTAN à ne pas déployer ses forces aux frontières de la RUSSIE par le jeu d’États membres de l’OTAN ayant des frontières communes avec la RUSSIE.
VIII/ La course aux armements encouragée par l’OTAN est contraire à la paix et au développement économique de pays dont le PIB est faible
La recommandation faite par l’OTAN à ses États membres de dépenser au moins 2% de leur PIB en armements militaires n’est pas un facteur de paix dans le monde et doit être dénoncée. La course aux armements menace parfois l’équilibre économique de certains de ces pays ou des pays aspirant à entrer dans l’OTAN, comme l’UKRAINE, laquelle consacre plus de 4% de son PIB à son armement miliaire alors que son économie est régulièrement décrite comme fragile, avec un déséquilibre chronique de ses échanges internationaux (6,1 milliards de dollars de déficit de son commerce extérieur en 2020) et un taux d’inflation de 18% en 2022.
IX/ Le réveil de l’Asie face à l’Occident
Souvenons-nous que, déjà, le réveil des peuples des pays décolonisés – du « tiers monde », d’Asie et d’Afrique adoptant une posture de « non-alignement » – se fit, hier, en Asie, lors de la conférence de Bandoung, en 1955, en Indonésie…
Aujourd’hui, face à l’OTAN, comme hier face aux « deux grands », l’Asie ne veut pas rester inactive et veut prendre sa part dans le rééquilibrage du monde. En effet, le 15 juin 2001, l’Organisation de Shanghai pour la coopération (OCS) a succédé au « groupe de Shanghai ».
L’OCS compte aujourd’hui 9 pays. Elle a été instituée en 2001 par la CHINE, la RUSSIE et quatre États d’Asie centrale, le KAZAKHSTAN, le KIRGHIZISTAN, l’OUZBÉKISTAN et le TADJIKISTAN. Elle s’est élargie à l’INDE et au PAKISTAN en 2016, puis à L’IRAN en 2021.
L’OCS vise d’abord à répondre aux bouleversements géopolitiques en Asie centrale, consécutifs à l’effondrement de l’URSS en 1991 et à l’instabilité que cela entraîne dans la région. Le groupe de Shanghai puis l’Organisation institutionnalisent peu à peu une coopération visant à assurer la sécurité collective de ses adhérents face aux menaces « du terrorisme, de l’extrémisme et du séparatisme ».
X/ L’OTAN n’a pas vocation à être une seconde ONU…
Si, dans un généreux mouvement de syncrétisme, l’OTAN mutait en voulant désormais représenter tous les États de la planète, elle deviendrait vite alors une ONU bis, mais avec, contrairement à l’ONU actuelle, un arsenal miliaire impressionnant et dangereux pour la paix dans le monde et un « conseil de sécurité » des 30 membres composant l’Alliance atlantique fonctionnant également selon la règle du consensus, non plus celui des « Cinq Grands » mais des « Trente » au sein desquels ne figurent ni la RUSSIE ni la CHINE…
Est-ce bien raisonnable et même souhaitable un tel fonctionnement du monde ?
Et notre monde a-t-il besoin d’un gendarme super-armé imposant une certaine conception de l’ordre libéral – en soi discutable – et aussi de la paix des occidentaux – alliant prospérité économique et puissance militaire – à une autre partie de lui-même ?
Louis SAISI
Paris, le 27 juin 2022
NOTES
[1] Le « Cercle de Réflexion Interarmées » est une structure formée par des hauts gradés de l’armée française qui ne sont plus en service et qui, par conséquent, ont le droit d’exprimer leurs opinions.
[2] Voir « OTAN 2030 » : “Il faut stopper ce train fou avant qu’il ne soit trop tard ” – Capital.fr. 11 mars 2021. Cette lettre ouverte a été également publiée sur le site « À gauche.org » du 31 MARS 2021 : OTAN 2030 : révolte d’une partie de l’armée française – Les néo-gaullistes de l’armée française s’opposent à la ligne d’intégration stratégique de la France à l’OTAN. OTAN 2030 : révolte d’une partie de l’armée française (agauche.org)
[3] Club certes très ouvert, mais surtout à l’Est, comme nous le verrons…
[4] On le désigne parfois aussi sous le nom de « traité de Washington ».
[5] Aujourd’hui, l’OTAN compte 30 membres qui sont : France ; Portugal ; Italie ; Angleterre ; Norvège ; Belgique ; Pays-Bas ; Danemark ; Islande ; Luxembourg ; États-Unis ; Canada ; Grèce ; Turquie ; Allemagne ; Espagne ; Tchéquie ; Hongrie ; Pologne ; Bulgarie ; Estonie ; Lettonie ; Lituanie ; Roumanie ; Slovaquie ; Slovénie ; Albanie ; Croatie ; Monténégro ; Macédoine du Nord.
[6] Signée lors de la 9e conférence internationale américaine du 30 avril 1948, dans la ville de Bogota elle est entrée en vigueur le 13 décembre 1951. Elle est dans la continuité de l’Union internationale des Républiques américaines qui lui préexistait depuis 1890. Initialement composée de 21 États et consacrée aux études économiques, l’OEA regroupe désormais la totalité des 35 États du continent. Elle s’est transformée en un forum de dialogue et de décision des pays de l’Hémisphère occidental sur les questions politiques, économiques, sociales et culturelles et en particulier, en matière de sécurité, de démocratie, de maintien de la paix et de prévention des conflits.
[7] Ce traité fut ensuite remplacé par le Traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et le Japon signé le 19 janvier 1960.
[8] L’OTASE était une alliance défensive conclue à Manille le 8 septembre 1954 entre l’Australie, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines et la Thaïlande et dont le siège était à Bangkok. Ayant perdu toute raison d’être depuis le désengagement américain au Viêt Nam en 1973, l’Organisation a été officiellement dissoute le 30 juin 1977.
[9] Ce budget militaire s’élevait à 1,29 milliard d’euros pour 2017. Il concerne « l’exploitation et la maintenance de la structure de commandement de l’OTAN ». Il est divisé en trente-cinq sous-budgets, qui peuvent être financés par certains pays spécifiquement, suivant l’intérêt stratégique suivi. Attention, il ne finance pas la mise à disposition de personnel ou d’équipement militaire par les pays membres pour une opération donnée. Le budget civil couvre les dépenses administratives liées aux programmes du Secrétariat international de l’OTAN : personnel, équipement civil. En 2014, l’Alliance employait 6000 civils dont 1000 au siège. Le fonctionnement du siège et les relations publiques dépendent aussi de ce budget qui atteint 235 millions d’euros en 2017.
Enfin, le programme d’investissement au service de la sécurité, le NSIP, sert à financer certains investissements militaires pour les pays membres, comme des mises à niveau de systèmes d’informations, des quartiers généraux et des infrastructures pour les opérations extérieures (aéroport, carburant…). Ce programme est financé à hauteur de 655 millions d’euros en 2017. La comptabilité de l’Otan reste opaque sur certains points, notamment les dépenses relatives aux opérations secrètes.
[10] Le 5 décembre 1995 marque le retour de la France dans le Conseil des Ministres et le Comité militaire. Lors de la Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’O.T.A.N., à Bruxelles, le Français Hervé de CHARETTE annonce que Paris est disposé à siéger à nouveau au comité militaire de l’OTAN. C’est que les guerres des Balkans, marquant la décennie 90, imposent aux armées françaises d’opérer en coordination avec les armées de l’OTAN.
[11] L’hôtel ASTORIA fut détruit par un incendie en 1972.
[12] Il s’agit de tourner la page de la brouille entre les deux pays depuis la guerre d’Irak (2003) dénoncée et condamnée à l’ONU par la France. Lors de sa tournée le président SARKOZY ne ménage pas ses éloges sur les USA louant de manière thuriféraire les bienfaits de la culture et de la civilisation américaine.
[13] « OTAN versus Russie en chiffres », Le Monde du 18 juillet 2018, par Véronique MALÉCOT, Audrey LAGADEC et Francesca FATTORI.
[14] Les têtes nucléaires sont des ogives nucléaires contenant une charge explosive. Elles sont tirées par des missiles et, comme leur nom l’indique, les têtes nucléaires sont situées à l’avant du missile
[15] L’unique porte-avions russe Amiral KOUZNETSOV va sur ses quarante ans et Moscou souhaite construire un nouveau navire de combat moderne par ses propres moyens.
Le porte-avions SHTORM fera partie du prochain programme d’armement russe pour la période 2019–2025. Le navire intégrera la Marine avant 2030 et pourrait être déployé sur la base de SEVEROMORSK (nord du pays). Moscou a clairement ressenti le besoin de construire ce navire au cours de la campagne syrienne. La Russie a pu envoyer le porte-avions Amiral KOUZNETSOV au large de la Syrie, mais le navire a déjà 30 ans et arrive en fin de vie.
[16] Comme la vétusté du porte-avions « Kousnetsov », la perte du croiseur russe « Moskva » – navire amiral de la flotte russe en mer Noire, endommagé soit par des tirs et missiles ukrainiens (destruction peu avouable pour les russes) soit victime de son mauvais entretien (sort funeste guère plus avouable), et qui a coulé, selon le ministère russe de la Défense – montre la faiblesse et la vulnérabilité de la flotte russe, l’armement naval n’ayant jamais fait partie des priorités russes en matière de défense. Avec le mouillage de certains navires de guerre russes en Méditerranée à la suite du conflit syrien, il semblerait que les russes, avec la construction annoncée du porte-avions SHTORM super géant de mers, reviennent aujourd’hui sur leurs fondamentaux initiaux.
[17] SIPRI Institut de Recherche sur la Paix de Stockholm créé le 6 mai 1966 (institut d’études stratégiques)
[18] Selon les révélations de Jake SULLIVAN, conseiller à la sécurité nationale de BIDEN, début avril 2022, WASHINGTON aurait élaboré avec KIEV un « plan » pour que les Ukrainiens obtiennent « tout ce dont ils ont besoin » des États-Unis ou de leurs alliés en Europe et ailleurs.
[19] Selon le « Courrier international » N° 1643 du 28 avril au 4 mai 2022, citant « The Wall Street Journal », p. 34
[20] Extraits du « Wall Street Journal », cités par le numéro précité Courrier international, notamment p. 34 (Dossier « DONBASS : UN TOURNANT DANS LA GUERRE, pp. 30-39)
[21] Bien que ce soit quelques années après les USA que l’URSS accédera à la bombe atomique A avec son essai réussi du 23 septembre 1949 mettant fin au monopole américain sur les armes nucléaires détenu depuis le 16 juillet 1945. L’équilibre de la terreur s’établira ensuite entre les deux superpuissances rivalisant dans la détention de l’arsenal nucléaire le plus sophistiqué et potentiellement destructeur.
[22] L’écrivain anglais George ORWELL est plus connu comme l’auteur de « 1984 » (publié le 8 juin 1949) – avec son fameux et inquiétant personnage « Big Brother » – qui est l’un des plus grands livres du 20ème siècle.
[23] Cf. le site Slate .fr, 26 octobre 2015 : L’expression « Guerre froide » a été inventée en 1945 par Orwell | Slate.fr
[24] Raymond ARON, les Articles du Figaro, tome 1 : la Guerre froide, Éditions de Fallois, Paris, 1990, relié, 1 418 pages.
[25] Raymond ARON : Le grand schisme, Ed. Gallimard, Collection Blanche, 348 pages, Paris,1948.
[26] Cf. SIRINELLI (Jean-François) : « Un intellectuel libéral en guerre froide : Raymond ARON », Mélanges de l’École française de Rome/Année 2002/ 114-2/ pp. 723-729.
[27] La revue Esprit dans son numéro de février 1949 consacrera un commentaire critique très sévère à son ouvrage et notamment à sa prise de position sommaire.
[28] Cf. SIRINELLI (Jean-François) : Deux intellectuels dans le siècle, SARTRE et ARON, Ed. Fayard, 396 pages, Paris, octobre 1995.
[29] Cf. SIRINELLI (Jean-François), « Un intellectuel libéral en guerre froide : Raymond ARON », article op. cit, p. 727.
[30] J. MORDAL, G.A CHEVALLEZ, R. GHEYSENS, J. de LAUNAY : dossiers de la guerre froide, ED. Marabout-Université, Gérard & C° , Verviers (Belgique), 1969, 386 pages, notamment pp.312-313.
[31] Ibid, pp. 307-311
[32] Cf. ELLENSTEIN (Jean) : Histoire de l’URSS (4 tomes), notamment tome 3, pp. 224-228 « L’URSS en guerre (1939-1946) », Éditions sociales, Paris, 1974, notamment. p. 224.
[33] Ibid., pp. 224-225.
[34] Ibid., p. 225.
[35] Ibid. p. 225.
[36] Henri MÉNUDIER (direction) : L’Allemagne occupée (1945-1949), Ed. Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 1989 ; Ed. Complexe, Paris, 1990, 352 pages ; Henri MENUDIER : « La rupture Est-Ouest et ses conséquences pour l’Allemagne », in L’Allemagne occupée, op. cit., pp. 28-55.
[37] En riposte à la création du Deutch Mark, les soviétiques organisent, à partir du 24 juin 1948, le blocus de Berlin qui cessera le 12 mai 1949.
[38] Du 17 au 25 février 1948, le coup de Prague – avec la prise de contrôle de la Tchécoslovaquie par le Parti communiste tchécoslovaque, avec le soutien de l’Union soviétique, aboutissant au remplacement de la Troisième République par un régime communiste – en constitue un temps fort important.
[39] Au mois de mai 1949 les trois zones occidentales forment la RFA (25 mai 1949) et, au mois d’octobre 1949, la RDA (7 octobre 1949) naît dans la zone d’occupation soviétique.
[40] Maître Roland WEYL, avocat au Barreau de Paris : « L’OTAN et la légalité internationale », Ideesaisies, https://ideesaisies.deploie.com/lotan-et-la-lega…barreau-de-paris
[41] Jean VALLUY (1899-1970) fut un général et un historien français. Il devint chef d’état-major du général DE LATTRE DE TASSIGNY à la 1re armée française en 1944. À ce titre, Il débarqua le 15 août 1944 en Provence et participa ensuite à la bataille des Vosges et à la bataille d’Alsace. En 1945, il prit le commandement de la 9e division d’infanterie coloniale qui, la première, franchira le Rhin à Leimersheim, prit Karlsruhe, Baden-Baden, Rastatt et Kehl, avant de pousser vers le Haut-Danube et la frontière suisse. Débarqué en décembre 1945 avec la 9e division d’infanterie coloniale, il est nommé commandant supérieur des troupes d’Indochine en 1946 en remplacement du général LECLERC. En 1952, il entama une carrière interalliée comme adjoint du général GRUENTHER au SHAPE. Il fut ensuite le représentant de la France au groupe permanent de l’OTAN à Washington en 1953. Trois ans plus tard, il devint commandant en chef de centre-Europe à Fontainebleau. Ainsi il alterna au cours de sa carrière les séjours métropolitains avec les expéditions et les séjours Outre-mer et à l’étranger, totalisant sept ans en Asie, neuf en Afrique et trois en Amérique. Il prit sa retraite en mai 1960. Il fut nommé secrétaire général de l’Association internationale du traité de l’Atlantique (ATA) et président de la Saint-Cyrienne en 1961 et le restera jusqu’en 1965. Grièvement blessé lors d’un accident de chemin de fer près de Vallorbe en juillet 1964, il consacra ses années de retraite à l’histoire et à la pensée militaire.
[42] Cité par la Revue des deux Mondes du 4 avril 2016 : « 4 avril 1949 : Fondation de l’OTAN ».
[43] L’UEO devait être dissoute en 2010.
[44] Lors du référendum consultatif du 12 mars 1986 organisé par le PSOE, alors au pouvoir, l’adhésion de l’Espagne à l’OTAN est approuvée mais, au début au moins, sans sa participation aux structures militaires de l’Alliance qu’elle n’intégrera totalement que le 1er janvier 1999.
[45] Le Sommet débuta le 2 décembre 1989 sur le paquebot soviétique Maxime GORKI. Le 3, à la suite de deux jours d’entretiens, les deux présidents tinrent une conférence de presse commune. Annonçant l’avènement d’une « ère nouvelle », George BUSH assura Mikhaïl GORBATCHEV de son « respect » et de son « soutien » pour son action en faveur des changements en Europe de l’Est. Il affirma son intention de faciliter l’intégration de l’U.R.S.S. à la communauté internationale, en prévoyant d’accorder à MOSCOU la clause de la nation la plus favorisée, en soutenant son entrée au sein du G.A.T.T. en tant qu’observateur et en incitant les hommes d’affaires américains à « aider » Mikhaïl GORBATCHEV. « Le monde quitte une époque de guerre froide […] pour une période de paix de longue durée », lui répondit ce dernier qui liait l’avenir de ce nouveau partenariat politico-économique au succès des réformes en U.R.S.S. Le président américain approuva la réunion d’un sommet des pays membres de l’O.T.A.N. et du pacte de Varsovie à Vienne, à la fin de 1990, après la conclusion d’un accord sur la réduction des armes conventionnelles. Mission fut donnée par ailleurs à Edouard CHEVARDNADZE et James BAKER de relancer les négociations en cours sur la réduction des armements. La prudence caractérisa de part et d’autre les déclarations concernant la réunification de l’Allemagne. La position de l’U.R.S.S. vis-à-vis de ses alliés cubain et nicaraguayen constitua la seule source de critiques de George BUSH envers son homologue soviétique.
[46] Quatre ans auparavant, le sommet de Genève de 1985 s’était déroulé dans le contexte de la guerre froide. Il avait eu lieu à Genève, en Suisse, du 19 au 20 novembre 1985, entre le président des États-Unis Ronald REAGAN et le Secrétaire général de l’Union des républiques socialistes soviétiques Mikhaïl GORBATCHEV. Les deux dirigeants se rencontraient pour la première fois afin de parler de diplomatie internationale et de la course aux armements. « Le premier sommet Reagan-Gorbatchev devait être finalement beaucoup plus important par sa signification symbolique que par ses résultats concrets ». La rencontre entre Ronald REAGAN et Mikhaïl GORBATCHEV à Genève, en novembre 1985, aboutira à la signature, deux ans plus tard, du traité sur l’élimination des missiles à moyenne portée.
[47] Le 4 décembre 1989, BUSH et GORBATCHEV informent leurs alliés respectifs des résultats de leurs entretiens. Les dirigeants du pacte de Varsovie se réunissent à Moscou, tandis qu’à Bruxelles le président américain assure à ses partenaires atlantiques que « les États-Unis resteront une puissance européenne ».
[48] La glasnost signifie en russe la « publicité » (des débats). Elle est le plus souvent traduite par le terme « transparence ». Il s’agit d’une politique de liberté d’expression et de publication d’informations qui émergea et s’imposa comme une nécessité suite à l’accident nucléaire de TCHERNOBYL. Comme la « pérestroïka » (voir ci-dessous), elle fut portée en URSS par Mikhaïl GORBATCHEV à partir de 1986.
[49] La « Pérestroïka » est le nom donné aux réformes économiques et sociales conduites par le président de l’URSS Mikhaïl GORBATCHEV. Ces réformes importantes furent portées, d’avril 1985 à décembre 1991, selon trois axes prioritaires : économique, social et éthique. Elles furent également traduites par le triptyque suivant : l’accélération, la démocratisation et la transparence.
[50] Pour sa part, ROH TAE-WOO avait annoncé, dès son discours d’investiture en 1988, sa volonté de poursuivre la politique de normalisation des relations diplomatiques avec les démocraties populaires, tout en proposant une conférence pour la paix réunissant, outre les deux Corée, les Etats-Unis, la Chine, l’URSS et le Japon. En avril 1991, Mikhaïl GORBATCHEV rencontre à nouveau ROH TAE-WOO, mais cette fois en Corée du Sud, et en novembre 1992 Boris ELSTINE se rend à son tour à Séoul.
[51] Le Conseil d’assistance économique mutuelle ou Conseil d’aide économique mutuelle (CAEM, également désigné par l’acronyme anglais Comecon) était une organisation d’entraide économique entre différents pays communistes créé par Staline en 1949 en réponse au plan Marshall de 1947. Il fut dissout le 28 juin 1991, suite à la chute du bloc soviétique.
[52] La présidence de Bill CLINTON, en tant que 42e président des États-Unis, débute le 20 janvier 1993, date de l’investiture de Bill CLINTON et prend fin le 20 janvier 2001. Membre du Parti démocrate, CLINTON entre en fonction après avoir remporté l’élection présidentielle de 1992 face au président sortant George H. W. BUSH et au milliardaire Ross PEROT. Quatre ans plus tard, CLINTON triomphe à nouveau de PEROT et du candidat républicain Bob DOLE ce qui lui permet d’être élu pour un second mandat.
[53] Duty: Memoirs of a Secretary at War by Robert M. GATES (Author), January 2014 (by Alfred A. Knopf).
[54] La fidélité de GATES est attestée par le fait qu’il fut officier dans the United States Air Force et par la suite ne servit pas moins de six présidents à la fois au sein de la CIA et du « National Security Council ».
[55] Le rapport du 26 septembre 2006 de la Commission européenne sur le degré de préparation à l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et la Roumanie soulignait que ces deux pays avaient réalisé de grands progrès dans le domaine politique, grâce à la réforme de leur système judiciaire, en particulier en matière de lutte contre la corruption. Les mesures économiques prises avaient également été saluées par la Commission. À ce rythme, les deux pays devaient être en mesure de faire face à la pression concurrentielle communautaire dans un avenir proche.
[56] Cf. supra I/ L’OTAN, un traité.
[57] BONIFACE Pascal, Les relations internationales de 1945 à nos jours, Paris, Eyrolles, 2017
[58] BONIFACE Pascal, Les relations internationales de 1945 à nos jours, Paris, Eyrolles, 2017 ; KIEN Anaïs, « Épisode 29 : 24 juin 1948 : le blocus de Berlin », France Culture, 2016 (https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-29-24-juin-1948-le-blocus-de-berlin).
[59] Le Parti socialiste unifié d’Allemagne (en allemand : Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED) était un parti politique de la zone d’occupation soviétique de l’Allemagne de l’Est d’obédience communiste. Il résultait lui-même de la fusion du Parti social–démocrate (SPD) et du Parti communiste (KPD), ces deux partis étant en activité dans la zone d’occupation soviétique de l’Allemagne. Le SED fruit d’une telle fusion au sein d’un seul et unique parti marxiste-léniniste (dans les zones occidentales d’occupation, les instances de ces mêmes partis en activité n’étaient donc pas concernées par cette fusion) était alors fondé, son organisation étant conçue selon le modèle du Parti communiste de l’Union soviétique.
[60] J. MORDAL, G.A CHEVALLEZ, R. GHEYSENS, J. de LAUNAY : dossiers de la guerre froide, ED. Marabout-Université, Gérard & C° , Verviers (Belgique), 1969, 386 pages, notamment pp.380-381.
[61] Op. cit., p. 380. Voir aussi I. SIRNOV : Histoire de l’URSS, Moscou, 1967 ; voir aussi LEMMER : Manches war doch aurtnders, Frankfurt, 1968.
[62] Professeur émérite de civilisation allemande contemporaine de l’Université de Lille SHS et directeur de la revue Allemagne d’aujourd’hui (Lille), Jérôme VAILLANT participe aujourd’hui à l’expertise sur l’Allemagne pour des publications en ligne telles que The conversation (France) et Atlantico ainsi que pour des stations de radio telles que France culture, Rfi, Deutsch Welle, etc.
[63] J. MORDAL, G.A CHEVALLEZ, R. GHEYSENS, J. de LAUNAY : dossiers de la guerre froide, ED. Marabout-Université, Gérard & C° , Verviers (Belgique), 1969, 386 pages, notamment p. 381.
[64] Fondée en 1899, la United Fruit Compagny (ou UFCo) est une ancienne entreprise bananière américaine rebaptisée Chiquita Brands International en 1989. Elle possède de nombreux intérêts en Amérique du Sud (GUATÉMALA, COLOMBIE, HONDURAS, COSTA-RICA, NICARAGUA) mais aussi dans les Caraïbes : JAMAÏQUE, HAÎTI, CUBA. Sa technique d’acquisition des terres dans tous ces pays était parfaitement rodée : signature avec les gouvernements en place de contrats de construction de lignes de chemin de fer contre laquelle la compagnie demandait, en guise de paiement, d’immenses superficies de terres converties au début en bananeraies avant qu’elle ne diversifie ensuite ses activités agricoles (sucre à CUBA par exemple). Elle s’appropria également de nombreux services publics tels que l’électricité, l’eau, les transports municipaux, etc. et possédait même une flotte de 38 navires de grand tonnage. Pesant sur l’économie de ces pays, il ne lui était pas difficile, ensuite, d’influencer les gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes pour les inciter à limiter les réformes et les redistributions de terres en faveur des paysans propriétaires de de minifundio ou sans terres.
[65] C’est l’attaque le 26 juillet 1953 de la caserne de Moncada à Santiago de Cuba par une centaine de guérilleros, mal préparés et peu armés qui est généralement considéré comme le point de départ de la révolution cubaine. Arrêté, Fidel CASTRO qui, avec son frère Raoul, avait participé au coup de main – plaidant pendant près de quatre heures pour assurer sa propre défense – fit de ce procès une véritable tribune politique pour conclure par ces mots : « Peu importe que je sois condamné, l’Histoire m’acquittera ». Il fut condamné à 15 ans de prison sur l’île de la Jeunesse, et son frère à 13 ans de prison. Mais sous la pression de personnalités civiles, des jésuites et de l’opposition politique, les deux frères furent libérés par BATISTA en 1955. Les deux frères CASTRO s’exilèrent au Mexique, mais bien résolus à revenir libérer leur pays par la Révolution.
[66] La United Fruit Compagny a compté dans ses rangs de Hauts dirigeants des USA : :John Foster DULLES, ex-secrétaire d’État des États-Unis, ancien avocat de la société ; Allen DULLES, ex-directeur de la CIA, cadre dirigeant ; Walter BEDELL-SMITH, ex-directeur de la CIA, cadre dirigeant.
[67] Le 21 octobre 1959 un avion bimoteur mitrailla La Havane, provoquant deux morts et une cinquantaine de blessés. Un autre avion largua de la propagande anti castriste.
[68] Le matin du samedi 15 avril 1961, huit bombardiers américains B-26 peints aux couleurs cubaines (dans l’intention de faire croire qu’il s’agissait d’une rébellion cubaine et non d’une attaque américaine), en violation des conventions internationales, décollèrent du NICARAGUA et attaquèrent les bases aériennes de La Havane et de Santiago (sud). Les avions américains bombardèrent les aéroports et aérodromes du pays, détruisant une grande partie des avions au sol (civils et militaires). Les principaux bombardements touchèrent Ciudad Libertad, La Havane, San Antonio et Santiago de Cuba. La moitié des appareils de l’aviation militaire cubaine ainsi que des avions civils sont détruits au sol. Sept victimes cubaines sont également relevées
[69] La participation financière des USA à l’expédition de la baie des cochons est mise en place par le président EISENHOWER qui, en août 1960, approuva un budget de treize millions de dollars pour financer l’opération paramilitaire contre le régime castriste, mais de manière discrète car il avait demandé qu’aucun membre de l’armée américaine n’y soit impliqué.
[70] La CIA fut mise en cause à la fois pour son incapacité technique dans la préparation de l’opération d’invasion de l’Île, mais aussi pour la place politique trop longtemps usurpée au sein de la société américaine. En effet, outre la mise en cause pour sa déficience et sa légèreté dans la préparation technique de l’invasion de CUBA, la CIA était également dénoncée pour la place anormalement excessive qu’elle avait prise en se substituant aux politiques. Dans un premier temps, le président KENNEDY lui retira la gestion des opérations spéciales au profit de l’armée américaine et réduisit son budget à hauteur de 20 %. Parallèlement pour contenir et empêcher durablement toute nouvelle interférence future de la CIA dans le déroulement de la politique étrangère des États-Unis, une lettre du 29 mai 1961 émanant du Président comportait une mise en garde adressée à tous les ambassadeurs américains en poste à l’étranger les invitait à se considérer comme les seuls responsables et représentants non seulement des activités diplomatiques des USA mais aussi de tous les services et agences américaines à l’étranger : « Vous êtes en charge de toute l’action diplomatique des États-Unis, et j’attends de votre part de superviser l’ensemble des opérations. Cette mission inclut non seulement le personnel du Département d’État du Foreign Office, mais également de tous les représentants de tous les services des autres agences des États-Unis ». Dans un second temps, le 28 novembre 1961, Allen DULLES fut congédié de son poste historique de directeur de la CIA et remplacé par le républicain John MCCONE. Dans un troisième temps, le président étudia très sérieusement la possibilité de réduire sensiblement pour l’avenir les possibilités de l’Agence qui avait outrepassé ses pouvoirs et qui était à la fois si peu ou si mal contrôlée par l’exécutif et pas davantage soumise au contrôle du Congrès des Etats-Unis. Il caressa même le projet, lors de son second éventuel mandat, de fusionner le FBI et la CIA sous la direction de l’attorney général (l’équivalent du ministre de la Justice en France), à l’époque détenu par son frère Robert KENNEDY. Mais son assassinat, le 22 novembre 1963, à Dallas, mit fin à l’épilogue de reprise en mains de la CIA par le Chef de l’Exécutif américain.
[71] Pour une analyse plus développée et très critique de la culture politique des Etats-Unis vis-à-vis de CUBA, voir l’excellente analyse de Michaël PARENTI : « Pourquoi cette hostilité incessante des USA contre Cuba ? » in INVESTIG’ACTION, 16 juin 2005.
[72] Claire LAGONOTTE : « L’URSS et Cuba, 1959-1972. Des relations opportunistes et conflictuelles », in Outre-Mers. Revue d’histoire Année 2007 354-355 pp. 23-36.
[73] La ville américaine de KEY WEST est située est encore plus proche de CUBA. à l’extrémité occidentale de l’archipel des Keys, au sud de la FLORIDE. L’îlot n’est séparé de CUBA que par un peu moins de 145 km.
[74] Avant la crise, la France joua un rôle non négligeable dans l’information des services américains concernant l’implantation des missiles soviétiques à Cuba. Le cinéaste Alfred HITCKOCK dans le film américain L’Étau (titre original en anglais : Topaz) – réalisé en 1969, à partir de l’adaptation du roman de Leon URIS, TOPAZ, qui est à son tour librement inspiré de la véritable affaire MARTEL ou SAPHIR de 1962 -.a d’ailleurs relaté avec brio le rôle d’alerte joué par les services secrets français auprès des américains.
[75] Lors de son voyage en Amérique du Sud, du 21 septembre au 16 octobre 1964, le général.de Gaulle visite les 10 pays suivants : le VENEZUELA, la COLOMBIE, l’ÉQUATEUR, le PÉROU, la BOLIVIE, le CHILI, l’ARGENTINE, le PARAGUAY, l’URUGUAY et le BRÉSIL.
[76] Sami MAKKI : « La stratégie américaine en Méditerranée », Confluences Méditerranée, 2002/1 (N°40), pages 125 à 140
[77] VENSTRE est appréhendé comme un parti libéral de centre-droit, issu de la tradition agraire scandinave. Sa doctrine libérale est assez classique, puisque Anders Fogh RASMUSSEN – qui fut à sa tête de 1998 à 2009 – est l’auteur du livre From Social State to Minimal State dans lequel il préconise une réforme approfondie de l’État providence danois conformément à la doxa libérale classique, avec une baisse des impôts et moins d’intervention du gouvernement dans les affaires corporatives et individuelles.
[78] Sauf qu’une telle vision classique des choses n’est guère compatible avec le point qui suit consistant à préconiser de nouvelles relations avec la RUSSIE lesquelles se sont précisément détériorées à la faveur des nouvelles adhésions et de l’extension de l’OTAN à l’Est.
[79] Mais ici le Secrétaire général de l’OTAN enfonce des portes ouvertes car ces points relativement consensuels avec la RUSSIE ne sauraient constituer les seuls points d’accord car ils sont insuffisants et ne peuvent effacer la conquête de l’Est par l’OTAN.
[80] La YOUGOSLAVIE fut créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elle résultait de la dislocation des empires ottomans et austro-hongrois. Le 1er décembre 1918, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes fut proclamé à Belgrade. Il regroupait Serbie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Slovénie et Macédoine, unis par le Serbo-Croate. Entre les deux guerres mondiales, des tensions entre Serbes et Croates provoquèrent de nombreux conflits internes jusqu’à son démantèlement en 1941 par l’Allemagne nazie.
[81] Cf. [83] J. MORDAL, G.A CHEVALLEZ, R. GHEYSENS, J. de LAUNAY : dossiers de la guerre froide, ED. Marabout-Université, Gérard & C° , Verviers (Belgique), 1969, 386 pages, notamment pp. 158-159.
[82] Ainsi, en 1971, lors du « Printemps croate », les cadres du Parti s’allient avec les nationalistes locaux pour obtenir une plus grande autonomie croate. Mais ce mouvement fut aussitôt associé par Tito au mouvement oustachi et réprimé comme tel.
[83] Après la conférence de BANDOUNG (qui sonna le réveil du Tiers Monde en avril 1955), l’idée d’une troisième voie indépendante fit son chemin. Et un an plus tard, à BRIONI (en Yougoslavie), se tint la première conférence entre NASSER, NEHRU et le maréchal TITO qui sera le prélude à la création, en 1961, du mouvement des non-alignés.
[84] La déclaration d’indépendance de la SLOVÉNIE fut suivie d’une guerre d’indépendance contre le pouvoir fédéral yougoslave de Belgrade. Elle fut aussi appelée « guerre des Dix Jours ». Les accords de BRIONI, signés sur les îles croates de Brion, mirent fin à la guerre le 7 juillet 1991. Bien qu’un moratoire de 3 mois sur l’indépendance de la SLOVÉNIE était accordé, en fait, très vite le gouvernement slovène œuvra à la création des institutions nécessaires pour faire fonctionner le futur nouvel État. C’est ainsi que la souveraineté de la police et de l’armée slovènes fut reconnue sur le territoire de la Slovénie. Quant aux unités militaires yougoslaves (JNA), elles devaient quitter la Slovénie avant la fin d’octobre 1991. La JNA devait en outre abandonner derrière elle la plupart de ses armes lourdes lesquelles restèrent en Slovénie pour être revendues plus tard aux autres républiques de Yougoslavie. Dans les faits, le retrait yougoslave se termina totalement le 26 octobre 1991.
[85] Malgré les cessez-le-feu imposés par les Nations unies aux protagonistes (janvier 1992) et le retrait de l’armée de la République Fédérale socialiste de Yougoslavie (JNA) de la CROATIE, le conflit armé en Croatie reste intermittent et essentiellement à faible échelle jusqu’en 1995. Début août, la CROATIE lance l’Opération Tempête et prend rapidement possession de la plus grande partie de la République serbe autoproclamée de Krajina en territoire croate, causant un exode massif de la population serbe. Quelques mois plus tard, à la suite des négociations des Accords de Dayton, la guerre cessa.
[86] Rappelons qu’après le 21 décembre 1991 et la fin de l’URSS, la Russie a repris la place de l’URSS dans les institutions internationales, notamment au niveau de l’attribution du siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Elle a assumé également le passif financier de l’URSS et a pris en charge l’armement nucléaire soviétique. La RUSSIE avait, dès le 12 juin 1990, avec Boris ELTSINE, proclamé sa souveraineté en revendiquant son droit à faire sécession de l’Union soviétique. La Fédération de Russie, qui englobait les trois quarts du territoire de l’URSS, avait ainsi entamé une émancipation progressive conduite par ELTSINE. Un mois plus tard, en juillet 1990, Boris ELTSINE quitta le Parti communiste. Ce fut le premier haut dignitaire à franchir ce pas, lourd de sens. Le PCUS n’était désormais plus au pouvoir en Russie. Le 12 juin fut, depuis, inscrit comme Fête nationale en Russie.
[87] Au nombre des exactions odieuses, beaucoup de viols de femmes et de jeunes filles furent perpétrés. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie considéra que le « viol systématique » et « l’esclavage sexuel, en temps de guerre, était un crime contre l’humanité, juste après celui de génocide (purification ethnique).
[88] À plusieurs reprises, ces crimes furent qualifiés de « génocide » par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ainsi que par la Cour internationale de justice. Mais une telle qualification est contestée par certains historiens spécialisés, ainsi que par beaucoup de Serbes
[89] En 1993, les Croates firent des camps de détentions pour Serbes et violèrent des milliers de femmes serbes. Ceci explique qu’en marge des accords de DAYTON, dans une résolution du 9 novembre 1995, le Conseil de sécurité de l’ONU demanda aux belligérants la cessation de toutes les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, avec la « fermeture immédiate » de tous les camps de détention en Bosnie-Herzégovine. La résolution visait les serbes de Bosnie mais aussi les croates coupables des exactions commises à l’encontre des Serbes de KRAJINA pendant et après l’offensive croate de l’été (cf. Le Monde du 11 novembre 1995 : « Le Conseil de sécurité de l’ONU dénonce les exactions commises par des Serbes de Bosnie et par des Croates » par FLORENCE HARTMANN)
[90] L’armée de la république serbe de Bosnie était une dépendance de l’Armée de Yougoslavie créée le 12 mai 1992 sous la direction du général Ratko MLADIĆ par une « Assemblée serbe de Bosnie » à l’instigation de Slobodan MILOŠEVIĆ pour soutenir la République serbe.
[91] Emeric ROGIER : « La diplomatie préventive au Kosovo : retour sur un échec retentissant (1989-1998) », in « Balkanologie » (revue d’études pluridisciplinaires), Volume VIII Numéro 1, 2004 Preventive diplomacy in Kosovo: 1989-1999.
[92] En déclarant le 17 février 2008 cet État indépendant de la Serbie, lors d’une session extraordinaire du parlement des institutions provisoires du KOSOVO, l’indépendance de ce pays fut ainsi proclamée unilatéralement contre la volonté de Belgrade. Selon Le Monde diplomatique, en 2012, quatre années après la déclaration d’indépendance, « la reconnaissance de cet État ne fait toujours pas l’objet du moindre consensus » au sein de la société internationale.
[93] Renaud GIRARD : « Balkans : le Kosovo n’est pas le dernier conflit territorial », in FigaroVox, 19 mars 2008 : Selon lui, « Enivrés par la chute inattendue du communisme européen en novembre 1989, les Occidentaux ont imprudemment laissé s’ouvrir la boîte de Pandore des revendications territoriales et des irrédentismes dans les Balkans. »
[94] Serge SUR : « Le recours à la force dans l’affaire du Kosovo et le droit international », les notes de l’ifri – n° 22, Septembre 2000, Institut français des relations internationales.
[95] Michel COLLON est un Journaliste belge indépendant, spécialiste des » média-mensonges « . Il fut boycotté pendant la guerre du KOSOVO par une grande partie de la presse occidentale qui l’avait pourtant encensé pour ses précédents ouvrages – Michel COLLON dévoile la formidable manipulation de l’OTAN.
[96] Aycha FLEURY : « La guerre en Afghanistan : portée, forces et faiblesses du concept de culture de guerre appliqué aux guerres modernes », cf. AMNIS, Revue d’’études des sociétés et cultures contemporaines, 10/2011 : Culture de guerre. Représenter et penser l’affrontement (XIXème siècle à nos jours)
[97] ARAB NEWS COM, 2 juin 2022 : « Quels sont exactement les liens entre les talibans et Al-Qaida ? » www.arabnews.fr/node/139161.
[98] Gérard FUSSMAN (professeur honoraire du Collège de France, Chaire de l’Histoire du monde indien, 1984-2011) : « Pour les Afghans, les forces de l’OTAN sont une armée d’occupation » [Le Monde du 30 août 2008]. Cet éminent historien nous a quittés le 14 mai 2022.
[99] Cf. Notre Histoire : « Saddam Hussein : l’exécution qui abrège un procès gênant ». Selon ce site : « Si les juges étaient irakiens, le reste était made in USA. Partout, on trouve des traces de la présence américaine. Ce sont des troupes américaines qui ont arrêté Saddam. Il était détenu à Camp Cropper, une base des forces aériennes américaines. Les Etats-Unis ne l’ont remis aux Irakiens que quelques heures avant l’exécution. Le tribunal spécial qui a condamné Saddam est l’œuvre de Paul Bremer, anciennement à la tête de l’occupation américaine en Irak et ce sont des avocats américains qui ont rédigé les statuts du tribunal en question. Les Etats-Unis ont injecté plus de 100 millions de dollars dans ce tribunal et sont intervenus directement dans le déroulement du procès. »
[100] Selon des sondages menés entre 2005 et 2013, le soutien public ukrainien à l’adhésion à l’OTAN était encore faible. Cependant, depuis la guerre russo-ukrainienne et l’annexion de la Crimée, le soutien public à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN a considérablement augmenté. Assez paradoxalement, les russes ont donné du crédit à l’adhésion à l’OTAN, alors que celle-ci n’était ni majoritairement souhaité ni encore moins guère populaire avant le conflit
[101] En France, cette critique a été reprise par Michel CARLIER dans son ouvrage : Irak-Le mensonge, Ed. L’Harmattan, Paris, 22 janvier 2009, 290 pages. Il y recense toutes les critiques contre cette guerre.
[102] « Le mea culpa de Tony Blair pour la guerre en Irak », Courrier international, 25 octobre 2015. Entretien donné le 24 octobre 2015 à la chaîne CNN.
[103] Le Monde.fr : « La guerre d’Irak était BIEN une guerre du pétrole (cette fois, c’est prouvé ! » – Oil Man (lemonde.fr) : 14 JUIN 2011, PAR MATTHIEU AUZANNEAU. Voir également de Matthieu AUZANNEAU, avec Hortense CHAUVIN Pétrole. Le déclin est proche., Seuil / Reporterre, 2021
[104] La baronne SYMONS de Vernham Dean PC était aussi, de 2001 à 2005, ministre d’État aux Affaires étrangères chargée du Moyen-Orient, de la sécurité internationale, des affaires consulaires et personnelles,
[105] Jean-François SOULET : « L’indépendance des États Baltes (1989-1991) », dans Histoire de l’Europe de l’Est (2011), pages 181 à 200.
[106] Cf. HERODOTE.net : 24 août 1991 : « Ukraine Une «petite Russie» en quête d’identité ».
[107] Sami NAIR : « Le pétrole, véritable enjeu de la guerre américaine en Irak », in Libération, 13 janvier 2003
[108] L’Agence d’information sur l’énergie (Energy Information Administration ou EIA) a été créée par le Congrès des États-Unis en 1977. Elle est une agence indépendante de la statistique au sein du ministère de l’énergie des États-Unis.
[109] C’est à BAGDAD que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) voit le jour en 1960. Elle est fondée par l’Arabie Saoudite, l’Irak, l’Iran, le Koweït et le Venezuela, mais d’autres pays vont vite la rejoindre (Libye, Algérie, Émirats arabes unis, etc.). L’objectif des pays membres est de se mettre d’accord sur la production et les prix du pétrole, mais aussi de réduire leur dépendance vis-à-vis des compagnies pétrolières occidentales. Très rapidement, au cours des années 70, l’OPEP va s’imposer et acquérir une notoriété internationale, notamment à la faveur du conflit israélo-palestinien. En effet, le 6 octobre 1973, la coalition des pays arabes conduite par l’Égypte et la Syrie lance une offensive contre Israël. C’est le début de la Guerre du Kippour. Mais, dès le 14 octobre, les États-Unis créent un pont aérien et livrent des armes à Israël. La coalition des pays arabes est repoussée et le cours de la guerre sur le terrain est inversé. C’est alors qu’en réaction contre ce soutien américain à Israël, les pays arabes membres de l’OPEP se réunissent le 16 et 17 octobre et décident d’une hausse de 70 % des prix du pétrole et d’une réduction progressive de 5 % par mois de la production. Le 20 octobre, l’Arabie saoudite proclame même un embargo sur les États-Unis, lequel sera levé 5 mois après. Les pays membres de l’OPEP prennent le contrôle de leurs industries pétrolières nationales et commencent à jouer un rôle plus important – qui ne se démentira plus – sur les marchés pétroliers mondiaux.
[110] En cas de chute du cours du pétrole, comme en 2016, cela permet au FMI, comme le fit le 2 mai 2017, Jihad AZOUR, son directeur régional, de délivrer aux monarchies pétrolières, son fameux cours d’économie politique inchangé sur la dette publique : « Nous croyons qu’ils (= les États pétroliers) doivent continuer à réduire leurs déficits budgétaires, développer de nouvelles sources de recettes et aussi poursuivre des réformes structurelles qui leur permettront de se diversifier. » Mais de telles « leçons » trouvent parfois leurs limites dès lors qu’elles se heurtent à la colère populaire. C’est ainsi que selon Le Monde du 9 mai 2017, les pétromonarchies – qui avaient habitué leurs populations à un généreux Etat-providence – avaient réduit les subventions au carburant et à l’électricité, tandis que de nombreux services publics étaient rendus payants. Mais, face à la colère populaire, en Arabie saoudite, le prince Ben Salman dut faire volte-face sur la compression des dépenses publiques, fin avril 2017, en revenant sur l’une des mesures d’austérité les plus significatives et sensibles prises à l’automne 2016 : le gel d’indemnités diverses jusqu’alors accordées aux fonctionnaires et au personnel de l’armée. Celles-ci ont finalement été réinstaurées par décret royal.
[111] STEPHEN J. SNIEGOSKI : La guerre d’Irak, 2003
[112] Paul Craig Roberts : « La véritable raison de la guerre d’Irak en 2003 », in Arrêt sur Info – un autre regard sur l’actualité, 5 avril 2016.
[113] Paul Craig Roberts : « La véritable raison de la guerre d’Irak en 2003 », in Arrêt sur Info – un autre regard sur l’actualité, 5 avril 2016.
[114] La guerre du Golfe est un conflit qui opposa, du 2 août 1990 au 28 février 1991, l’Irak à une coalition de 35 États dirigée par les États-Unis à la suite de l’invasion et l’annexion du Koweït par l’Irak.
[115] Profitant d’un vide sécuritaire dans les territoires disputés entre l’État central irakien et le Gouvernement régional du Kurdistan, d’une situation socio-économique largement dégradée et des rancœurs provoquées par la toute-puissance des milices chiites, l’Organisation de l’État islamique (Daech) renaît de ses cendres, et sa guérilla s’amplifie dans le centre de l’Irak.
[116] Entretien donné à France 24 le 8 février 2022 à la veille du report du scrutin présidentiel en IRAK.
[117] Cf. supra, p. 22. V/ Où va l’OTAN, ; A/ L’extension de l’OTAN ; 1/ Des membres originaires à l’extension des années 50 et 80.
[118] Intégralement située en mer Baltique, dans la baie de Gdańsk, la frontière entre la Russie et la Suède est entièrement maritime, Rappelons que c’est la RUSSIE qui fit perdre à la SUEDE pendant la guerre dite de Finlande (1808-1809) sa parie finlandaise au profit de l’Empire russe. La Suède perdait un tiers de son territoire et un quart de sa population.
[119] La frontière terrestre entre la FINLANDE et la RUSSIE s’étire sur une longueur de 1 340 kilomètres. Elle sépare la FINLANDE de la FÉDÉRATION DE RUSSIE. Cette frontière résulte des traités signés à la fin de la Seconde Guerre mondiale aux termes desquels la Finlande renonçait à une partie de la Carélie et à la bande de Petsamo au profit de l’URSS. À la suite de l’invasion de l’Ukraine, la Finlande prévoit de construire de nouvelles clôtures sur certaines portions de sa frontière avec la Russie.
[120] Cf. supra, VIII/ L’hyperactivité de l’OTAN et ses interventions au sortir de la guerre froide.



